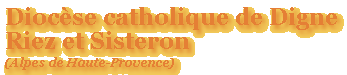| |
La vie ! La recevoir, la donner font partie, sauf exception, de ce que désire l’être humain. C’est inscrit au plus profond de notre être. C’est en tout cas ce que désirent ceux qui fondent un couple. Mais je n’oublie pas, nous le verrons, que la fécondité biologique, n’est pas le tout de la fécondité humaine.
Ce désir de transmettre la vie est parfois empêché par la nature et c’est souvent l’objet d’une grande souffrance. Cette souffrance est bien manifestée par le cri de Rachel, Gn 30,1 : « Fais-moi aussi avoir des enfants ou je meurs », dit-elle à Jacob.
Le désir d’enfant, comme tout désir humain, est un désir extrêmement fort et complexe et il comporte différents aspects ? Qu’est ce qui est désiré et voulu dans un enfant ?...
Le désir crée t’il un droit ?
Le désir d’enfant peut aujourd’hui être satisfait par les techniques d’AMP. De quels ordres sont-elles ? Les pratiques concernant les débuts de la vie sont nombreuses et fascinantes. Toutes ces techniques supposent une réflexion sur ce qu’est un être vivant, sur les conditions de son avènement à l’existence et sur les actes aptes à respecter à la fois ce qu’il est et les personnes qui participent à sa venue au monde. La résolution des problèmes médicaux ne doit pas empêcher d’aborder les autres questions sous-jacentes.
Notamment, celle la plus fondamentale de savoir qui est l’embryon, son statut. La réponse à cette question est fondamentale pour savoir quel(s) comportement(s) développer à son endroit apte à respecter ce qu’il est et doit devenir.
Toutes ces questions et bien d’autres résonnent dans l’actualité et sont exposées aussi aux croyants que nous sommes.
Ce que je vais pouvoir vous dire, vous l’imaginez sans peine, ne pourra pas ne pas être habité par ma foi en Jésus, Fils de Dieu, chemin, vérité et vie de ma vie ; lui qui projette sa lumière et sa vérité sur l’homme ; mais ce que je vais pouvoir vous dire peut-être entendu et compris, sinon partagé, par tout homme usant de sa raison, qu’il soit croyant ou non. Rien de ce que nous croyons sur l’homme, rien de la vérité que nous vient du Christ, ne s’opposent à la raison car, si tel était le cas, ce message ne serait pas chrétien. Saint Pierre dans sa première épître dit explicitement : « Vous devez toujours être prêts à rendre raison de votre espérance… Mais faites le avec respect et douceur » (1 Pi 3, 13-15). Le verbe grec traduit par « rendre raison », « apologein », signifie que le chrétien doit toujours être prêt à démontrer le sens profondément rationnel de ses convictions. Tout cela doit se faire dans le respect et la liberté des autres. On doit toujours et seulement faire appel à la conscience et à la raison ; jamais aux menaces et à la force. Nous ne devons jamais imposer ce que nous croyons mais nous adresser à la liberté du cœur et de la raison de nos interlocuteurs.
Mes propos vont être habités par ma foi en Dieu, qui nous a créés, homme et femme, à son image et à sa ressemblance, mais ils pourraient être entendus, et s’il y en a dans cette salle je les salue respectueusement, par tout homme ou femme qui ont foi en l’Homme c'est-à-dire qui ont la passion de certaines valeurs capables de donner du sens à notre existence et à notre relation avec les autres.
« Nous autres croyants pensons avoir quelque chose à dire au monde, aux autres, nous pensons que la question de Dieu n’est pas quelque chose de privé, ce n’est pas une question entre nous, à l’intérieur d’un club qui a ses intérêts et qui joue son jeu. Nous sommes au contraire convaincus que l’homme a besoin de connaître Dieu, nous sommes convaincus qu’en Jésus est apparue la vérité, et la vérité n’est pas la propriété de tel ou tel, elle doit être partagée, elle doit être connue. C’est pourquoi nous sommes convaincus que, justement, à ce moment de l’histoire, un moment de crise de la religiosité, de crise aussi des grandes cultures, il est important que nous ne vivions pas seulement à l’intérieur de nos certitudes et de nos identités mais que nous nous exposions réellement aux questions des autres. C’est avec cette disponibilité et cette franchise que, dans la rencontre, nous essayons de faire comprendre ce qui nous semble à nous raisonnable ou, mieux encore nécessaire pour l’homme ».
C’est ce que je vais essayer de faire sur un sujet difficile, car existentiel, comme tout ce qui touche à la vie, à l’amour, à la souffrance.
1. Le désir d’enfant :
Après quelques définitions, nous examinerons les divers aspects du désir d’enfant et nous nous interrogerons sur la notion du « droit » à l’enfant.
A. Qu'est-ce que la stérilité?
La stérilité est l'impossibilité d'avoir des enfants. Elle peut être soit d'origine féminine soit d'origine masculine, soit, le plus souvent, due à l'addition de déficiences partielles chez les deux conjoints. Certaines de ces déficiences sont clairement diagnostiquées sur le plan médical (problèmes ovariens, tubaires, anomalies du sperme ...); parmi elles, on range des troubles conduisant à une stérilité qui restera définitive si elle n'est pas traitée; d'autres, conduisant à une hypofertilité plus ou moins durable. D'autres déficiences ne peuvent être expliquées, on parle alors de stérilité idiopathique, voire psychosomatique.
Selon l'Organisation mondiale de la santé (1976), on doit parler de stérilité lorsqu'il n'y a pas grossesse après 2 ans de rapports sexuels réguliers. Cette définition est loin d'épouser le sentiment spontané des couples, pour lesquels il y a, souvent, stérilité à partir du moment où l'enfant « commandé» n'arrive pas. La contraception peut donner l'impression d'une maîtrise absolue de la procréation, ce qui est un leurre. Paradoxalement, une tentative de grossesse infructueuse, nullement irrémédiable en soi, peut conduire à un trouble psychosomatique débouchant sur une stérilité temporaire ou définitive.
La stérilité et l'hypofertilité peuvent être considérées non comme une maladie, mais comme un handicap, un dysfonctionnement empêchant le couple de répondre à une vocation procréatrice qui fait partie de son identité même. Si l'on se place d'un point de vue psychologique, on peut dire qu'il s'agit d'une très grande souffrance pour le couple, laquelle peut engendrer chez lui des réactions de fuite, d'agressivité ou de fatalisme, voire, chez certains croyants, le sentiment d'une «punition divine». En outre, lorsque la cause de la stérilité est imputable à l'un des conjoints, la souffrance change de visage, le partenaire stérile pouvant se sentir coupable, voire humilié. Pire, l’autre pouvant le rendre responsable de leur malheur. Le couple peut se sentir anormal, exclu de la vie sociale; soumis à des tensions internes, il est en butte aux réactions plus ou moins gênantes de son entourage. Dans ces circonstances, la pratique médicale peut apporter, sinon un remède qui guérit, du moins un palliatif à la stérilité.
La stérilité peut aussi être l'occasion pour le couple, grâce à une longue maturation, d'une épreuve positive: regarder la réalité en face pour mieux l'assumer et l'accepter ou, au contraire, essayer de la transformer, avec espoir, mais sans précipitation ni illusions excessives.
B. Fécondité, parentalité et stérilité
Une réflexion anthropologique et théologique peut nous permettre d'éclairer les rapports complexes entre ces trois notions.
La paternité et la maternité se jouent normalement dans une fécondité à la fois biologique, affective, éducative et spirituelle. Dans l'Ancien Testament, cette fécondité, mais aussi une éventuelle stérilité, sont ressenties comme l'expression de la volonté de Dieu.
Cependant, l'expérience humaine comme la parole de Dieu dans la Bible nous font saisir que la fécondité humaine ne se réduit pas à la fécondité biologique, ou, autrement dit, que la stérilité biologique n'est pas forcément inféconde.
La paternité et la maternité biologiques ne débouchent pas automatiquement sur la parentalité affective, éducative et spirituelle. Il y faut aussi une véritable «adoption» à l'image, pour les chrétiens, de l'adoption de l'homme par Dieu. Le vœu de la fécondité biologique, qui est de «se continuer», de «laisser une trace», demande aussi de vivre des relations affectives, éducatives, spirituelles, d'avoir une attitude de service, de donner du temps à l'enfant, etc.
La paternité et la maternité affectives et éducatives peuvent se construire dans une certaine autonomie vis-à-vis du lien biologique, voire en l'absence de celui-ci. La «fécondité» d'un couple peut s'exprimer en dehors de la naissance de l'enfant :
- Dans l'adoption, le père et la mère deviennent parents. Dans cette «parentalité», la mère et le père assument pleinement leur rôle de parents. La mère, bien qu'elle n'accouche pas, a des contacts physiques privilégiés avec l'enfant. Le père, bien qu'il ne soit pas le géniteur, donne son nom à l'enfant, tous deux l'accompagnent dans toutes les étapes de son développement, établissent avec lui une alliance, une relation sur le registre de la parole, et, parfois, ils l'aident à intégrer sa double filiation.
- La fécondité peut se jouer sur d'autres registres que la paternité et la maternité biologique ou adoptive, même s'il s'agit d'un chemin difficile: La première fécondité du couple est la fécondité interpersonnelle : Le premier fruit de l’amour c’est ce que celui-ci permet entre les personnes et en chacune d’entre elles. L’amour est comme une vie nouvelle qui jaillit entre les sujets, vie en laquelle chacun pourra naître ou renaître à toute une part de lui-même, manifester les richesses cachées, guérir de certaines blessures. L’amour authentique est comme un engendrement mutuel.
La fécondité doit être aussi sociale. C’est la fécondité extérieure du couple. J’aime ce beau mot pour désigner le couple : foyer. Ce terme et cette réalité évoquent l’accueil et le rayonnement. Le foyer est un lieu d’intériorité, de chaleur, de douceur face à un monde extérieur qui est trop souvent le monde de la compétition, du combat. Le couple a une mission, une vocation prophétique attestant qu’une communauté peut vivre selon d’autres principes que la lutte pour le pouvoir ou le conflit. Le couple peut devenir un foyer de sens, une figure, le sacrement (signe et réalité) d’une humanité réconciliée, un élément de la paix sociale. Le couple est une Eglise domestique : signe et moyen d’opérer l’unité du genre humain.
La fécondité spirituelle : Dans le sacrement du mariage le premier don (la grâce) que le Seigneur offre à chacun des époux c’est son conjoint. Chacun veut accueillir ce don comme venant de Dieu, comme un signe privilégié de son amour. En s’accueillant et en se donnant mutuellement les époux peuvent être sûrs d’accueillir et de se donner à Dieu lui-même : celui qui vous accueille m’accueille dit le Seigneur. Dans le couple chacun a la certitude sacramentelle d’être un signe unique et privilégié pour l’autre de Dieu et du visage de Jésus-Christ. Chacun a la mission de dire Jésus-Christ à l’autre par toute sa vie. Moi, prêtre, je suis fécond en ce sens.
La fécondité éducative : Elle est le prolongement, voire le substitut de la fécondité charnelle. Mettre un enfant au monde ce n’est pas seulement lui donner le jour, mais le lancer et l’accompagner sur le chemin de la vie. Pour cela le couple est nécessaire tout comme la solidité de son lien. Un enfant pour grandir a besoin d’amour : à la verticale, certes, amour des parents pour lui, mais à l’horizontale, tout autant, l’amour des parents entre eux : roc solide et sécurisant.
C. Désir d'enfant et droit à l'enfant
Aux sources de la venue au monde d'un enfant il y a, indissociablement enchevêtrés, les lois de la nature, le désir de chacun des parents et celui du couple, les attentes et les représentations sociales.
La dimension biologique ne doit pas être occultée. Il arrive bien souvent que la nature contrecarre ou surprenne les volontés humaines. On n'a pas forcément un enfant quand on le veut, et, parfois, il arrive quand on ne le veut pas! Sur ce plan, l'enfant est à la fois, d'une certaine façon, le fruit du hasard (de la rencontre de deux gamètes et des aléas qui aboutissent ou non à l'embryon) et de la nécessité: l'instinct sexuel, l'instinct de vie de l'enfant à naître. L'individu est habité par la force de vie présente au cœur de la nature, quelle qu'en soit l'origine. La perpétuation de l'espèce est loi de la nature.
La dimension sociale n'est pas moins importante : la famille exerce une pression affective en faveur de l'enfant qui va assurer la lignée et perpétuer la descendance. C'est «l'enfant-maillon» ou « héritier».
Toutefois, il paraît évident qu'aujourd'hui, dans les pays dits développés, le désir des individus et des couples est prédominant, avec ses grandeurs et ses ambiguïtés. Avec la contraception et les traitements de la stérilité, la naissance est de moins en moins un hasard. Elle est de plus en plus programmée.
Le désir d'enfant correspond normalement au désir du couple, même s'il arrive que l'un impose son désir à l'autre. Parfois, il est inconscient, ce qui ne diminue en rien, bien au contraire, son importance. Parfois, il serait le travestissement d'un besoin interne au couple: l'enfant serait une « solution» à la désagrégation du couple, la béquille qui l'aiderait à marcher, ou encore le petit miracle qui réaliserait tout ce que le couple est incapable de vivre lui-même. Cela peut être dommageable pour l'avenir de l'enfant.
Le plus souvent, cependant, l'enfant est voulu pour lui-même, non comme celui qui comble un manque, mais comme celui qui est le signe et le fruit d'un amour créateur, le projet de vie de deux êtres qui font accéder à l'humanité un troisième être dont la vocation est d'exister pour lui-même.
Enfin, la naissance d'un enfant comporte une dimension spirituelle et/ou religieuse. Le désir d'enfant est porté par un sens qui le dépasse : « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même», chante le poète Khalil Gibran.
Pour l'agnostique ou le panthéiste, il s'agit d'une force de vie transcendant le désir individuel et le précédant. Pour celui qui croit en un Dieu distinct de l'univers, il s'agit de l'action du Créateur à l'origine de tout être.
Le désir d'enfant n'est pas un droit! à l'enfant.
Toute cette analyse montre les richesses, mais aussi les limites, les ambiguïtés, les paradoxes et les illusions du désir individuel d'enfant, présenté aujourd'hui souvent comme un absolu. Ce désir est profondément légitime sur le plan personnel, comme fruit de l'amour conjugal et projet de vie lié à cet amour, mais il présente aussi de nombreuses ambiguïtés qui consistent toutes, d'une manière ou d'une autre, à faire de l'enfant un objet: un remède, une thérapeutique, une compensation (le plus souvent illusoires).
Certes, on doit admettre que ces ambiguïtés ne sont pas liées seulement aux situations d'infertilité: les naissances «naturelles» n'y échappent pas. La maîtrise de la fécondité et sa médicalisation ont, déjà, accentué le risque de « faire» les enfants plutôt que de les accueillir. La «programmation» de l'enfant à venir, qui n'est pas en soi illégitime, va aussi dans ce sens.
Il reste que les procréations médicalement assistées renforcent encore l'emprise de l'homme sur le processus de la vie et le risque techniciste de produire des enfants comme on produit des objets. Les PMA, à cet égard, constituent une occasion, et même une chance, de se poser la question : « Un enfant, pourquoi ?». Elles accroissent aussi le risque de « l'enfant pour moi, quand et comme je veux ».
Pour nous, répétons-le, l'enfant est un don: il est l'autre qui interpelle la liberté de ses parents.
C'est pourquoi nous ne pouvons accepter que le désir d'enfant justifie un droit à l'enfant.
Sur le plan juridique d'abord, cette notion n'a pas de sens. Le droit des uns à avoir des enfants supposerait le devoir des autres (les médecins, la société, les donneurs de sperme dans les PMA hétérologues, etc.) de les leur « fournir» ou de les leur « garantir ». Ce qui est à la fois abusif et impossible.
Mais surtout, sur le plan éthique ou même anthropologique, parler de droit à l'enfant laisse supposer que la stérilité physique priverait les parents d'un élément constitutif de leur humanité même, et que l'enfant serait le remède, l'objet destiné à guérir cette humanité soi-disant tronquée ... Alors que l'enfant est une personne, à accueillir dans son altérité et à vouloir pour elle-même et non pas pour ce qu'elle apporte. Roselyne Bachelot s'élève contre le "droit à l'enfant" : Le « droit à l'enfant » est un terme qui me choque profondément. Cela n'existe pas. Il n'existe qu'un droit de l'enfant. Le « désir d'enfant », en revanche, me paraît légitime, on peut le comprendre, quelle que soit la situation des personnes qui l'expriment. Maintenant, est-ce à la société d'y répondre ? Là est toute la question ».
II. L’Aide Médicale à la Procréation (AMP)
Actuellement, peuvent bénéficier de l’AMP, un homme et une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou vivant ensemble depuis 2 ans, souffrant d’une infertilité médicalement constatée ou risquant de transmettre à l’enfant ou de se transmettre entre eux une maladie particulièrement grave. Il est enfin exigé que le lien des demandeurs n’ait pas été détruit par la mort ou le divorce et que les partenaires soient tous les deux d’accord pour faire la démarche.
Le don des gamètes est gratuit et anonyme. C’est la question de la connaissance de ses origines. Leur histoire est dans leur père et dans leur mère et non dans celui ou ceux qui ont fait don de leurs gamètes. La question est de savoir comment j’ai été voulu, pourquoi ? Et comment mes parents, ceux qui m’ont élevé, n’ont pas pu m’avoir naturellement, ont réussi à trouver un moyen médical pour arriver à la femme, l’homme que je suis aujourd’hui qui est un humain plus le fruit d’un amour et d’une éducation que de la biologie et de la génétique
A/ Les techniques d’AMP sont au nombre de deux : IA et la FIV.
L’IA homologue (IAC) ou hétérologue (IAD) : Le sperme recueilli par masturbation est déposé dans le col ou l’utérus de la femme. Méthode préconisée lorsque les spermatozoïdes sont trop peu nombreux ou trop peu mobiles pour être fécondants. Peut-être aussi utilisée préventivement pour conserver (par congélation) le sperme d’un homme devant subir une intervention ou un traitement entraînant une stérilité. IAD quand le sperme du conjoint ne contient pas de spermatozoïde.
FIV : Elle est destinée à résoudre l’infertilité féminine résultant d’une obstruction des trompes qui rend la rencontre entre ovocyte et spermatozoïde impossible. On y recourt aussi en cas de stérilité inexpliquée. La fécondation (rencontre des gamètes) se fait en laboratoire dans un milieu biologique adapté (in vitro). L’ovocyte est recueilli par coelioscopie (ponction folliculaire sous anesthésie générale à travers la paroi abdominale sous échographie par sonde intra vaginale). Pour augmenter les chances de succès les ovaires sont stimulés par traitements hormonaux. On recueille et féconde plusieurs ovocytes (4-8).
Le sperme et recueilli par masturbation, les spermatozoïdes sont préparés pour être rendus fécondants puis mis en contact avec les ovocytes. S’il y a fécondation des ovocytes l’embryon (3 au maximum) (on parle d’embryon jusqu’au 3ème mois de grossesse après on parle de fœtus) est réintroduit dans l’utérus au bout de 48 heures. Les embryons surnuméraires (ceux qui n’ont pas été réimplantés) sont congelés dans de l’azote liquide à - 196°. Le CECOS les conserve durant 5 ans et demande chaque année par lettre le souhait des parents. Quid au bout de 5 ans ?
Différentes méthodes d’AMP sont proposées en fonction des pathologies du couple.
Il existe aujourd’hui une autre méthode interdite en France, même si des enfants sont nés d’elle : la MPA
La maternité pour autrui ou maternité de substitution :
C’est le terme générique pour désigner 2 pratiques différentes :
-La gestation pour autrui : la femme qui porte l’enfant n’est que la gestatrice, puisque l’enfant qu’elle porte n’est pas issu de ses propres gamètes mais de l’ovocyte de la mère intentionnelle, voire d’une tierce femme. La GPA nécessite donc une FIV avec les spermatozoïdes du père intentionnel (voire d’un donneur) avant transfert dans l’utérus de la mère porteuse.
-La procréation pour autrui : la femme qui porte l’enfant est aussi sa mère génétique. Le bébé est issu de la fécondation de son propre ovocyte par les spermatozoïdes du père intentionnel (ou d’un 1/3 donneur), de façon naturelle ou par IA.
Ces deux pratiques sont interdites en France. La loi bioéthique interdit toute convention portant sur la gestation ou la procréation pour autrui. Ces pratiques ont punies de 1500 euros d’amende et un an d’emprisonnement. Les peines sont doublées si ces pratiques ont un but lucratif.
B/ Les questions médicales et éthiques posées par les techniques d’AMP :
Les problèmes bioéthiques liés à la FIV sont nombreux :
- Contraintes physiques et psychologiques : il s’agit de traitements nécessitant une forte disponibilité pour assumer les inséminations et les dopages hormonaux : tensions nerveuses, angoisses, anxiété obsessionnelle, masturbation : absence de dimension relationnelle. Tout cela peut parfois porter atteinte à l’unité du couple voire la briser surtout si le recours à l’AMP n’est pas véritablement un choix libre des deux membres du couple.
- Risque de naissances multiples, donc de prématurité.
- « Jumeaux », enfants conçus le même jour mais nés à plusieurs années de distance :
-Devenir des embryons congelés (surnuméraires) : réimplantation, don, destruction, expérimentation : possible avec la nouvelle loi de bioéthique. Certes les PMA permettent à des couples d’avoir des enfants et constitue un remède à la souffrance mais elles engendrent «d’autres souffrances. Beaucoup de couples sont mal à l’aise d’avoir des embryons congelés dans l’armoire. Cette congélation est un manque de respect pour l’être humain. Il y a une contradiction fondamentale dont on ne peut se satisfaire: les PMA sont faites pour donner la vie, or elles aboutissent souvent à la destruction de la vie des embryons. L’Allemagne et l’Italie interdisent la congélation d’embryons, pourquoi pas la France »? (Mgr d’Ornellas).
- Transfert d’embryon post-mortem.
- Réduction embryonnaire, posant les mêmes problèmes éthiques que l'avortement.
- Possibilité pour une femme très âgée de mettre au monde : responsabilité de la vie.
- Confusion de la notion de paternité/maternité : femme portant l'enfant de sa fille, donneur de sperme, donneuse d'ovule : Qui est le père ? Qui est la mère ?
- Possibilité de trafic d'embryons.
-« A-t-on suffisamment réfléchi à ce que cela signifiait, au pouvoir que l’homme se donnait en fabriquant un être humain dans une éprouvette? Aujourd’hui, ce pouvoir est un lieu de fantasmes. On va choisir les caractères génétiques de son enfant: les yeux bleus ou les cheveux bruns. Le risque de dérive eugéniste et de marchandisation est considérable. Il y a des pays où l’on vend des gamètes ! »
- Dissociation entre procréation et acte sexuel : Cette dissociation pose question. Certains époux le ressentent intuitivement. Ça peut compromettre l’harmonie et l’unité du couple. Pour l’Eglise catholique (position réaffirmée en 68 avec Humanae Vitae et par Donum Vitae en 1987) la procréation doit être le fruit de l’acte conjugal c'est-à-dire du geste spécifique de l’union charnelle des époux. Les techniques d’AMP sont opérées en dehors du corps des conjoints par les gestes de personnes extérieures au couple dont la compétence et l’activité déterminent le succès de l’opération.
L’acte sexuel comporte deux aspects : une signification d’amour et une efficacité en rapport au désir d’enfant. Les deux sont liés sauf à certaines périodes du cycle féminin. Or, dans le cas de l’AMP, aucun des gestes décisifs n’a lieu dans l’intimité du couple. Par geste décisif on entend un geste qui provient d’une décision et il est nécessaire pour que se produise un effet attendu.
Dans la procréation naturelle il n’y a qu’un seul geste décisif : l’union charnelle des époux : voulu il est en mesure de produire la conception d’un enfant. Dans la
Procréation médicalement assistée il y en a 3 :
-Le recueil du sperme et la ponction d’ovocytes.
-Le rapprochement des gamètes in vitro.
-Transfert d’embryon dans le corps de la femme.
Or, aucun de ces gestes décisifs ne se fait dans l’intimité conjugale. Ils sont fait à distance dans le temps et nécessitent l’intervention de tiers. Ces pratiques instaurent une relation de type médical. Des pesanteurs psychologiques s’ajoutent aux pesanteurs médicales. La place de l’homme, du médecin pose question : Cf. Jacques Testard appelé le père d’Amandine.
Un enfant a le droit (on parle trop exclusivement du droit des parents à avoir un enfant) d’être conçu dans un acte personnel d’amour. L’union des corps est le berceau naturel de la vie. L’enfant est une personne destinée à aimer, créé pour aimer. Le berceau de sa vie ne peut pas être n’importe quel acte. Notre force d’être, notre identité de personne aimée et aimante provient en grande partie de ce qu’à l’origine de ce que nous sommes il y a eu un acte personnel d’union entre deux personnes. Il n’est pas bon d’enlever à l’enfant cet acte fondateur et de lui substituer un acte technique. Seul l’acte d’union amoureuse d’un homme et d’une femme pourra donner à un enfant la certitude qu’il est aimé gratuitement, pour lui-même.
Tout cela : embryons surnuméraires, expérimentation, prélèvement de cellules pose fondamentalement une question : Qui est l’embryon humain ?
III. Le statut de l’embryon et son respect
Quelle est la position de l’Eglise catholique ? S’appuyant sur des données d’ordre scientifique ( l’œuf fécondé est différent des cellules à partir desquelles il s’est constitué, il est différent de la mère qui le porte, il y a en lui capacité autonome à se développer, tout son patrimoine génétique est présent dès le premier instant) et sur la Révélation (l’inviolabilité de la vie humaine, Dieu nous connaît dès le sein maternel : J’étais encore inachevé, tes yeux me voyaient (Ps 139, Jr 1, 4-5, Ps 70, IS 46, 3, Job 10, 8-12…) l’Eglise catholique considère que l’embryon doit être respecté comme une personne humaine dès sa conception.
Elle ne dit pas qu’il est une personne. Il y a personne par la présence d’une âme spirituelle. Quand l’âme apparaît-elle dans l’être humain ? Vieux débat philosophique qui remonte au Vème siècle avant Jésus-Christ.
Partisans de l’animation précoce et partisans de l’animation tardive se sont opposés avec des arguments valables de part et d’autres. L’Eglise n’a jamais tranché ce débat. Dès lors, comme on ne peut déterminer à quel moment l’âme, immédiatement créée par Dieu, vient animer le corps, l’embryon doit être respecté comme une personne et ce dès sa conception. Argument du chasseur : quand on ne sait pas en face de qui ou de quoi on se trouve on ne tire pas de risque de tuer une personne : l’être humain doit être respecté et traité comme une personne dès sa conception, et donc dès ce moment on doit lui reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels, en premier lieu, le droit inviolable de tout être humain innocent à la vie : Cf. Donum Vitae (87), Evangelium Vitae (95).
Nous sommes par là conduit à la question du statut de l’embryon et du respect de la vie :
Jusqu’à un certain nombre de jours, le fruit de la conception ne serait pas une vie humaine personnelle mais seulement un amas de cellules : Cf. René Frydmann : un grumeau de cellules qui ne prend d’importance qu’en fonction du désir de ceux qui l’ont engendré.
Pour d’autres l’embryon humain est une personne humaine et ce dès sa conception.
« La loi garantit le respect de la vie depuis le commencement » (art. 1, loi du 17/1/1975).
Que l’embryon soit reconnu ou non comme une personne, hors de toute option philosophique ou religieuse, la science génétique a montré que dès la fécondation se trouve fixé le programme génétique de ce nouvel être. A partir du moment où se réalise la fusion des noyaux des gamètes (ovocyte et spermatozoïde), juste après la fécondation, est constitué un être nouveau. Son patrimoine génétique est constitué et achevé, il ne variera jamais. Certes il a besoin de recevoir d’un autre, sa mère, ce qui lui est nécessaire pour survivre (oxygène, sang, amour) mais il se développe à partir de lui-même. De la fusion des gamètes à la puberté, son organisme s’enrichira par lui-même, sans connaître des ruptures ou des seuils qualitatifs. Il ne devient pas homme ; il jouit pleinement de la nature humaine. Dès lors conférer le statut d’humanité à l’un ou l’autre des moments de la croissance de l’embryon relève de l’arbitraire. Dès la fécondation est commencée l’aventure d’une nouvelle vie qui n’est celle ni du père ni de la mère et qui si on la laisse se développer, deviendra de plus en plus personnelle. Je n’entre pas ici dans le débat philosophique et théologique, que le Magistère de l’Eglise, n’a jamais tranché, sur le moment de l’apparition d’une âme spirituelle. Très vieux débat antérieur au christianisme. Les partisans de l’animation précoce ou tardive ont des arguments. L’Eglise catholique affirme seulement : « L’être humain doit être respecté et traité comme une personne dès sa conception, et donc dès ce moment ont doit lui reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels en premier lieu le droit inviolable de tout être humain innocent la vie » (EV, n°60).
Hier, un « sage » du Palais du Luxembourg m'a étiqueté d'un étrange nom : « bébé-thalys». J'en suis tout remué ! Quel avenir me préparez-vous par vos noms ? Pour vous, qui suis-je ?
En 1994 et 2004, j'étais le « grand absent » des lois de bioéthique qui, pourtant, statuaient sur les conditions de ma conception. Tout le monde me désirait. Aucun ne parlait de moi. Étais-je leur rêve ou un mythe ? Aujourd'hui, certains m'imaginent de tel sexe ou avec tel trait. D'autres me veulent « zéro défaut ». Votre diagnostic prénatal est en vue de me guérir in utero. Pourquoi donc vouloir me dépister systématiquement ? Mon nom serait-il « bébé-problème » ? Dois-je être traqué ? Faites donc confiance au soignant qui aide ma mère, surtout s'il me croit vulnérable !
Les grands, à New York, dans une belle Convention, ont estimé que mon « intérêt supérieur » devait être la « considération primordiale » de vos décisions d'adultes. C'était en 1989. Y pensez-vous ? Ils ont établi mon droit à connaître mes « parents ». Mais vous, vous vous êtes mis dans un grand embarras. Vous estimez que mes parents sont ceux qui me font grandir avec amour. C'est bien. Mais pourquoi, à votre gré, m'avoir assigné une origine génétique inconnue ? Certains de mes frères et sœurs en souffrent. D'autres sont satisfaits de cet anonymat.
Puis-je faire une remarque de bon sens ? Vous avez en votre corps des cellules destinées à me donner la vie. Par égard pour moi, n'en faites pas n'importe quoi. Elles vous engagent à une responsabilité infiniment plus belle et grave que le don d'organes, de tissus ou de cellules. Savez-vous ? Je suis « moi » grâce à ma filiation. J'ai besoin de cette origine filiale. Ne la brouillez pas ! La trafiquer mène à des impasses, à des violences rentrées. D'ailleurs, pour choisir ma lignée génétique, m'avez-vous demandé mon avis ?
De même, vous avez décidé sans moi de m'utiliser pour guérir. Pour vous justifier, vous me cherchez le meilleur nom. « Bébé-médicament » ! Ce nom choque car il me désigne comme objet pour guérir. Alors vous dites : « bébé du double espoir », « bébé-docteur », « bébé-sauveur ». Comme vous, j'ai l'espoir que ma sœur ou mon frère aîné guérira. Vos représentants ont enfin compris que mon cordon ombilical est une « ressource thérapeutique ». Dépêchez-vous d'en organiser très largement la collecte. Cela vous évitera de m'utiliser. D'ailleurs, vous saviez que je mérite le respect puisque vos lois statuent encore que le « bébé sauveur » n'est qu'« expérimental ». Mais alors, pourquoi vos « sages » ont-ils voté la banalisation de mon utilisation pour guérir ? Instrumentaliser ma conception est si blessant pour moi ! Chercher la guérison suffit-il à faire de moi un moyen ?
Sous prétexte que deux femmes prennent le Thalys pour se faire faire un bébé comme moi en Belgique, vos « sages » ont voté que cela se réalise en France. Suis-je donc un simple objet de fantasmes ? Et mon intérêt supérieur, qu'en font-ils ? Apparemment, ils le défendent puisqu'ils maintiennent le refus de la gestation pour autrui où moi, je subis un abandon, et ma « mère », une sorte d'esclavage. Mais ont-ils songé à mes droits, au moins celui d'avoir un père et une mère ? Ce qui, selon 90% des Français, est le mieux pour moi ! Pourquoi m'infliger une filiation incohérente ? En France, mes droits ne pèsent-ils donc plus rien face à ces désirs d'adultes, qui ne sont pas des droits ?
Les noms que vous m'infligez ne reflètent-ils pas vos rêves d'adultes ? Ni sauveur ni docteur, ni objet ni moyen, je suis une « personne ». Tel est mon nom. Unique est mon visage. Je vous en prie, aimez-moi pour moi-même ! J'apprécie les cathos qui disent : « la personne est la seule créature que Dieu a voulue pour elle-même. » Leur regard profond rejoint nombre de vos penseurs qui reconnaissent que, bébé, j'ai le droit d'exister pour moi-même.
Reste un nom, celui du plus petit d'entre les miens : « embryon humain », mon frère en humanité. Pourquoi donc vos « sages » manquent-ils de confiance en la science en autorisant sa destruction ? L'interdire est loin d'être hypocrite ! Au contraire, j'y vois votre cohérence. Elle me donne confiance en vous, les adultes, qui portez les choix de l'avenir.
J'attends beaucoup de la science. Elle ira loin en respectant mon frère en humanité. Respectez aussi ma filiation, et accueillez-moi avec joie, en m'adoptant si besoin. Je n'y peux rien d'être petit, entièrement confié à votre responsabilité d'adultes. Pardon d'être une personne ! Mgr Pierre d'Ornellas, Archevêque de Rennes, Chargé de la bioéthique au sein de la Conférence des évêques de France
L’Eglise n’est pas contre la science. Elle encourage les chercheurs, les médecins. Mais son rôle est un rôle de veilleur. Elle réagit contre tout ce qui peut porter atteinte à la dignité de l’homme, à sa vie. Elle cherche ce qui est le plus humanisant pour l’homme. L’Eglise est dépositaire de l’Evangile de la Vie. La vie de l’homme, créé à l’image et à la ressemblance de Dieu est précieuse ; elle doit être respectée de son commencement à son terme.
Chacun de nous devons être les gardiens et les défenseurs de la vie, avec humilité, en collaboration avec tout homme de bonne volonté, même non croyant, et qui défend la vie.
« Les positions que prend l’Eglise dans un certain nombre de domaines touchant la vie, l’amour ou la mort, paraissent à ce point en décalage par rapport à l’opinion majoritaire que des chrétiens seraient tentés de réagir sur le mode : « Si seulement l’Eglise cessait de prêcher la morale, on pourrait enfin annoncer l’Evangile. » Mais ce n’est évidemment pas si simple. Comment les disciples du Fils de Dieu fait homme se désintéresseraient-ils de l’homme, de sa vie, de son avenir ? Comment ne se préoccuperaient-ils pas de l’humanité de l’homme, de sa manière de se comporter on non en être humain ?... Nous n’avons certes pas à faire comme si en tout domaine il nous fallait forcément prendre le contre-pied de notre société. Mais il y a des moments où il faut savoir dire : « Au contraire… » Proposer la Foi en France au XXIème siècle implique que devant certains comportements, certaines opinions, certaines législations, on sache dire : « au contraire… » Cela n’exclut ni la patience, ni le temps de l’accompagnement, ni le respect dû au cheminement de la conscience, cela exclut encore moins la miséricorde, mais cela appelle la clarté, la liberté intérieure, la charité pastorale, le sens vrai des personnes. Cardinal Louis-Marie Billé ». |
|