
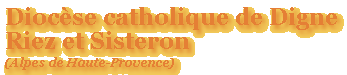
| |
||||
|
|
 |
dialoguer... | ||
l'actualité diocésaine. |
||||
|
|
||||
|
http://www.ndganagobie.com/ | |||
|
Compte rendu sur le colloque tenu à Ganagobie
Les 3, 4 et 5 juin s'est tenu le 6° Colloque interreligieux sur «la Famille, un Trésor fragile ». Précédemment nous avions déjà parlé de la famille, quant à la transmission de la Foi (2005) et quant au respect de la vie à naître (2006). Il nous a paru important de continuer à réfléchir sur le trésor qu'est la famille, lorsqu'elle offre à tous ses membres un lieu d'amour vrai et stable, enraciné dans la spiritualité en même temps qu'ouvert sur le monde d'aujourd'hui pour en affronter sereinement les difficultés. On peut regrouper en trois étapes les divers exposés qui ont été donnés: l'évolution de la famille en Europe dans les 25 dernières années ; l'impact sur les comportements des jeunes ; les témoignages vécus.
. Les évolutions de la Famille. Le P. Abbé ouvre le colloque en présentant les résultats d'une étude réalisée par l'Agence vaticane «FIDES » sur l'évolution de la famille dans l'Union Européenne depuis 1980. Les données réunies dans ce document montrent combien, en un quart de siècle, les comportements touchant la famille se sont considérablement modifiés ! Mentionnons seulement deux ou trois points : une famille sur deux seulement reste unie la vie durant (et ceci sans prendre en compte les unions libres, qui échappent aux statistiques). Un enfant sur deux seulement vit avec ses deux vrais parents. Toutes les 25 secondes il y a un avortement ! Il apparaît clairement que la prédominance est accordée à l'individu plus qu'à la cellule familiale dans son ensemble. Au plan juridique présenté par MM. Pierre LANGERON et Joseph GIAIME, on constate généralement que la loi suit les comportements majoritaires, mais cela entraîne chez beaucoup la confusion entre ce qui est permis par la loi, et ce qui est juste au plan éthique. La multiplicité des cultures dans nos sociétés fait resurgir la question délicate du rapport entre Droit et Religion.
On commence pourtant à sentir le besoin de faire retrouver aux parents le sens de leur responsabilité envers leurs enfants, qui ont besoin d'un milieu stable et uni pour se structurer psychologiquement et affectivement.
. L'impact sur les Jeunes. Les témoignages venus du monde médical (Dr. Daniel DEJARDIN, psychiatre, et Dr Chantal MEUNIER, médecin scolaire) mettaient en lumière la gravité des conséquences des carences affectives depuis la première enfance. On constate que les premières années forgent chez l'enfant une histoire qui va conditionner la suite de son existence. M. Guillaume WROBLEWSKI, en responsabilité au Lycée de la Nativité à Aix, souligne que l'enfant a besoin de cohérence pour se repérer : en particulier, il a besoin que le couple procréateur soit aussi le couple éducateur. M. Dominique TISSERAND, du diocèse du Var, est en contact fréquent avec les adolescents de l'enseignement secondaire, pour lesquels il a créé le «CD-ROM Missionnaire EMOI». C'est un parcours proposé à leur réflexion sur ce qu'ils vivent et sur les valeurs qu'ils veulent donner comme fondement à leur vie d'adulte. De ses contacts avec eux il perçoit que les adolescents ont besoin dans leur milieu familial d'une autorité structurante, faute de quoi il leur est difficile d'accepter une quelconque autorité à l'école ou dans la société. De même ils ont besoin d'être aimés, et s'ils ne trouvent pas cet amour chez leurs parents, ils vont le chercher ailleurs, dans une quête tous azimuts qui les fragilise.
.Témoignages vécus. Les diverses Traditions religieuses représentées au colloque ont eu leurs porte-parole, qui se sont largement retrouvés en accord sur l'essentiel : - un solide enracinement spirituel, - une fidélité mutuelle indéfectible des parents associée à un amour profond pour l'accueil de la vie à naître et à faire grandir, - une ouverture de la famille sur la solidarité humaine y compris envers les anciens qui sont témoins d'une sagesse à transmettre. M. Yves BAUDRON a mis en lumière le fort contraste entre famille occidentale et famille indienne. Celle-ci s'appuie sur l'autorité du chef de famille à qui il revient de transmettre la connaissance spirituelle. Le respect envers les anciens est inné, ce qui explique qu'il y ait très peu de maisons de retraite pour personnes âgées. M. Marcel GOLDENBERG a montré comment dans le Judaïsme la famille est travail, service et prière. Elle n'est pas statique, mais une histoire toujours en devenir, marquée par l'épreuve, condition pour « renaître ». Mme Mahjouba EL-KHALFI raconta ce que furent son enfance et sa jeunesse dans une famille marocaine traditionnelle, où les liens étaient très forts entre tous ses membres. Chacun avait une fonction bien précise dans le vaste ensemble familial, mais le souci du quotidien restait toujours subordonné à la quête spirituelle. Aussi sa venue en France pour rejoindre son mari qui y travaillait fut-elle un événement difficile, en raison de la rencontre avec une culture si différente de la sienne. Elle voulut s'efforcer de garder le meilleur des traditions familiales, tout en s'ouvrant à la réalité de ce monde si nouveau pour elle. Et elle se rend compte combien est délicat à trouver pour soi-même l'équilibre entre le meilleur de sa Tradition et les valeurs authentiques de la société occidentale, et plus délicate encore sa transmission aux plus jeunes. Ceux-ci ou bien sont séduits par la modernité et ils s'y plongent au point de perdre leurs racines, ou bien ils se replient dans un état d'esprit qui frise l'intégrisme en rendant difficile le dialogue paisible avec ceux qui ne partagent pas leur position. Mme Marie-Thérèse FONTANIER a présenté son expérience de mère de famille qui chercha à analyser les dysfonctionnements avec ses outils préférés : la psychologie (à l'école de Karlfried von Durkheim), l'écriture et la mise en scène. Elle apprit à se dépouiller du «trop agir» pour écouter le silence, ce qui lui fit percevoir l'appel au «que suis-je ?» et au «comment m'insérer de façon plus juste dans le plan divin, afin d'être humainement plus conforme à ce plan ? » Quatre mères de familles nombreuses d'Aix, Mmes DUPORT, LEMARQUIER, BALANDA et BLIN, ont présenté un témoignage commun sur la joie qu'apporte, encore aujourd'hui, une famille nombreuse. Face aux caractéristiques bien connues de la société moderne (individualisme, matérialisme, hédonisme, qui engendrent la solitude, l'ennui, l'insatisfaction), elles montrèrent les qualités qui sous-tendent ce type de famille : le don de soi (accueil de la vie, service, entraide), la sobriété de vie (moins d'Avoir) qui fait goûter les joies simples (Plus d'Etre), plus d'imprévus, plus d'émotions, qui ne laissent pas de place à l'ennui ! M. Cornélis KOEN, parlant d'expérience, établit un parallèle entre le travail de la mine dans le désert austral et la situation de la famille moderne dans le désert spirituel qui gagne de proche en proche. Qui veut descendre au fond de la mine expérimente l'impérieuse nécessité d'une solidarité de tous les instants, car le danger est continuel ! Qui veut traverser le désert et en sortir vivant a aussi un besoin impérieux d'eau et d'une étoile pour le guider ! Il en va de même pour la famille dans sa fragilité : elle ne peut tenir durablement que grâce à une très forte solidarité, la vie durant, entre ses membres qui, en creusant ensemble leur puits, y découvrent l'Eau vive de l'Esprit.
***
On peut se demander si les structures de la famille, telles qu'elles sont encore vécues dans les sociétés traditionnelles, pourront résister à la pression de la mondialisation qui va dans le sens d'une profond remaniement socio-économique (urbanisation rapide, travail de la femme à l'extérieur, accès par Internet à l'information sur les autres cultures du monde, érosion du sens religieux par le matérialisme ambiant). Puisqu'aujourd'hui on est à même de mesurer l'impact négatif de ces évolutions issues du siècle des Lumières et de la Révolution industrielle, n'est-il pas temps de chercher une autre voie qui, s'appuyant sur les racines spirituelles, permette un développement plus respectueux de la personne humaine et du monde qu'elle habite ?
|
||||
© 2002 Diocèse catholique de Digne, Riez et Sisteron - Réalisation Sudway Internet
