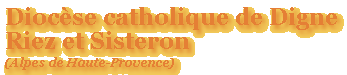|
Cet été,
le feu a ravagé les forêts du Var et
de tout le sud de l'Europe.
À Cancun pour la conférence mondiale
de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'aide
aux agriculteurs a été au centre des
affrontements. La canicule et les catastrophes naturelles
posent la question de savoir si elles ne résultent
pas du changement climatique que nous provoquons.
Tous ces événements touchent notre relation
à la nature. En même temps, des milliers
de personnes avaient choisi de venir, de toute l'Europe,
dans les Alpes-de-Haute-Provence, chez nous, pour
y profiter, un moment, d'un environnement de nature.
Depuis quelques mois, la société française
est traversée par des débats autour
de la relation à la nature et ces débats
vont se poursuivre dans les mois à venir. Les
chrétiens peuvent y apporter une contribution
précieuse, car leur foi en un Dieu créateur
éclaire la relation entre l'homme, créature,
et ie reste de la création. Inversement, ia
nature peut être, pour nos contemporains, un
chemin pour admirer et rencontrer le Créateur.
Cet article propose une lecture des rapports de la
société avec ia nature, à partir
des débats actuels en France et il cherche
à montrer sur quel registre l'apport de l'Église
catholique peut contribuer à donner du sens
à ces rapports. Dans une première partie,
c'est le projet de charte de l'environnement qui sera
au centre, avec son interpellation vers le développement
durable. Un article abordera ultérieurement
la réforme de la politique agricole commune
(PAC), le développement rural et les incendies
de forêts. Enfin nous réfléchirons
sur la contribution spécifique que les chrétiens
peuvent apporter.
Le projet de
charte sur l'environnement
Un débat est actuellement lancé, en
France, autour de la charte de l'environnement. Celle-ci
a pour vocation de rejoindre, en annexe de la constitution
française, les droits de l'homme (clairement
compatibles avec le message évangélique,
même si leur expression historique a été
conflictuelle), et les droits sociaux de 1946 (trouvant
un écho dans la doctrine sociale de l'Église).
Dans ce domaine de l'environnement, il y a une première
question qui concerne les effets néfastes de
ce que l'homme « fabrique »
(pollutions, déchets, nuisances) et l'enjeu
est de savoir fabriquer des remèdes ou des
solutions non polluantes.
Mais il se pose aussi la question de notre relation
avec la nature et l'enjeu y est plus profond car il
s'agit de choisir le mode de cette relation.
- Un premier mode consiste à détruire
la nature pour satisfaire nos besoins immédiats.
Cette attitude est de plus en plus refusée,
en France, mais elle reste encore répandue
dans le monde.
- Dans le second mode, la nature est considérée
comme une « chose » pour l'adapter
à ce que l'homme veut faire, dans une vision
anthropocentrique.
C'est l'exemple de l'agriculture industrielle, des
espaces verts urbains, des organismes génétiquement
modifiés (OGM) et même des réserves
naturelles intégrales, sanctuaires où
l'on isole des reliques de nature, à l'abri
des actions de l'homme (comme des exceptions qui
confirment la règle). C'est la nature à
consommer avec modération. L'homme est le
maître et il s'agit de maîtriser l'altération
de la nature.
- Avec le troisième mode, nous reconnaissons
dans la nature la manifestation d'un déroulement
et d'une vie qui nous dépassent, une altérité,
l'ouverture à un « autre »
qui nous décentre. Notre charte de l'environnement
peut alors devenir un partenariat avec la nature,
comme certaines civilisations en ont vécu
dans l'histoire et comme certaines cultures indigènes
tentent encore d'en vivre. La théologie chrétienne
de la création peut être précieuse
pour éclairer et nourrir une telle attitude
(même si elle est un peu en veilleuse dans
l'Église de France). Elle peut l'être
aussi pour conjurer la tentation inverse de diviniser
la nature en évacuant la dimension triangulaire
entre Dieu créateur, l'homme créé
à l'image de Dieu et la nature confiée
à l'homme pour la garder, ia cultiver et
l'accompagner vers son achèvement. Certains
opposants à la charte voient d'ailleurs dans
celle-ci le risque de faire de l'écologisme
une religion d'État.
Ce mode de relation est ressenti intuitivement par
une partie de nos contemporains qui expriment leur
désir d'aller dans la nature, pas seulement
pour se « faire » du bien,
mais pour « être » bien.
Dans les quelques mots sur la charte de l'environnement
de son intervention du 14 juillet 2003, Jacques Chirac
a parlé de « l'évolution
de notre propre culture pour y intégrer un
plus grand respect de ce qui est notre environnement
c'est-à-dire de la nature au sens ie plus large
du terme. »
Cette intervention montre d'ailleurs qu'une telle
évolution n'est pas gagnée : le président
est obligé d'aborder le sujet à l'intérieur
d'une réponse sur une autre question, car les
journalistes n'ont pas questionné sur ce point
; il souligne lui-même qu'on n'en « parle
pas assez dans le monde » ; le journal
Le Monde qui rend compte de l'interview le
16 juillet sur une double page et en soulignant quinze
points, n'y fait aucune allusion. Ce désintérêt
est encore plus frappant quand on constate que dix
jours après, la presse était pleine
d'articles sur la nature dévastée par
les incendies de forêts !
Le débat sur le développement
durable
Porteur d'une solidarité, à la fois
planétaire et entre les générations,
le débat sur le développement durable
est prometteur pour l'humanité et pour la construction
du royaume de Dieu.
Défini en 1987, « le développement
durable répond aux besoins du présent
sans compromettre les capacités des générations
futures de répondre aux leurs ».
Le sommet de la terre de Rio, en 1992, a reconnu,
pour l'ensemble de la planète, que ce développement
durable devait concilier trois principes : l'efficacité
économique, l'équité sociale
et entre sociétés, la protection de
l'environnement. Ménager la planète
et la partager, quel beau chemin vers le royaume de
Dieu !
Malheureusement, au niveau des décideurs politico-économiques,
i! apparaît une dérive. Les programmes
globaux sont tentés de prendre pour objectif
la « croissance durable », c'est-à-dire
un produit intérieur brut qui augmente sans
s'arrêter, le développement durable étant
renvoyé à des actions spécifiques,
pour atténuer les inconvénients sociaux
ou environnementaux d'une telle croissance. C'était
très net au colloque « Croissance
durable » tenu à la Bourse de Paris
le 14 mai 2003.
Toutefois, le Forum européen « Développement
durable et entreprise responsable », tenu
à Paris les 25 et 26 mars 2003, a montré
que certaines entreprises s'engageaient réellement
dans des actions de développement durable.
Mais de telles actions demandent une régulation
à l'échelle mondiale, que les structures
politiques actuelles n'assurent pas.
L'enracinement progressif du concept de développement
durable est une chance. Mais le monde politique peine
à faire les choix qu'appelle le respect envers
la nature. Il y a donc encore du chemin pour passer
de l'attitude d'utilisateur des ressources de la nature
à celle de responsable d'accompagner la création
vers son achèvement. La charte de l'environnement
pourrait y aider.
Agriculture,
espace rural, forêt.
Dieu donna à Salomon une sagesse et une
intelligence extrèmement grandes et un cœur
aussi vaste que le sable qui est au bord de la mer.
Salomon parla des plantes, depuis le cèdre
qui est au Liban jusqu’à l’hysope
qui croît sur les murs ; il parla aussi des
quadrupèdes, des oiseaux, des reptiles et des
poissons.
( 1 Rois 5, 9 & 13)
Dans un article précédent, le projet
de charte de l’environnement nous a permis de
réfléchir à notre relation avec
la nature et à notre implication pour un développement
durable. D’autres débats actuels viennent
éclairer cette question et nous allons en parler
aujourd’hui.
Le débat sur la politique
agricole commune (PAC)
La réforme de la PAC, qui vient d’être
adoptée par l’Union européenne,
fait bouger l’attitude agricole vis-à-vis
de la nature. Mais cette réforme heurte profondément
la profession agricole française et provoque,
pour elle, une révision culturelle déchirante.
L’aide européenne n’est plus apportée
aux aliments produits mais à l’activité
de l’agriculteur. Or, celui-ci avait comme éthique
de maîtriser la nature pour la mettre au service
des besoins alimentaires de l’homme. La société
européenne lui dit aujourd’hui que sa
noblesse est de contribuer aux équilibres naturels.
Les nombreuses structures agricoles françaises
et leurs dirigeants ont été très
marqués par la Jeunesse agricole chrétienne
(JAC) et probablement par une spiritualité
qui invitait à produire du pain pour son prochain,
avec en arrière fond les restrictions dues
à la dernière guerre et le problème
de la faim dans le monde. Au delà de certains
intérêts financiers réels qui
cherchent à maintenir des avantages acquis,
il y a, pour beaucoup d’agriculteurs, une révision
déchirante de leur échelle de valeurs.
L'Église ne peut se désinteresser de
cette crise car elle avait, elle-même, contribué
à ce que les agriculteurs appuient leur activité
de production sur des valeurs professionnelles fortes.
Il est maintenant reconnu que l'aide à l'exportation
des produits agricoles des pays développés
(plus que l'aide aux agriculteurs eux-mêmes)
nuit à l'agriculture des pays en développement.
Il faut donc aider les agriculteurs français
à comprendre qu'il est plus « noble »
(ou plus évangélique) de gérer
la création en participant au fonctionnement
des équilibres naturels et en permettant à
leurs frères citadins d'en bénéficier,
que de produire intensivement des denrées au
détriment de la nature et d'autres producteurs
moins favorisés dans d’autres pays. Cette
prise de conscience va s'accélérer par
l'évolution des aides financières. Il
est important que les chrétiens puissent mettre
en lumière combien cette modification peut
aider à une meilleure gérance de la
Création, afin que l’adhésion
des agriculteurs s’appuie sur des valeurs renouvelées
et pas seulement sur l’intérêt
financier. L’apport du mouvement des chrétiens
en monde rural (MCR) peut être précieux.
Les agriculteurs vont donc redevenir, dans les années
qui viennent, des acteurs attentifs et professionnels
de la gestion de la nature, renforçant le petit
noyau des forestiers et des écologues. Dans
les Alpes-de-Haute-Provence, nos agriculteurs y sont
peut-être mieux préparés qu’ailleurs.
L’obtention récente de l’appellation
d’origine contrôlée pour le fromage
de Banon est un exemple où la qualité
de la production s’appuie sur le respect du
terroir et sur le savoir-faire.
Le projet de loi sur les affaires
rurales
Mais cette révolution culturelle
des agriculteurs va intervenir trop tard pour pouvoir
entraîner la société. Les agriculteurs
sont maintenant largement minoritaires et leur influence
n'est plus déterminante dans le monde rural
qui était leur fief. Ce qui était autrefois
le ministère de l’agriculture en prend
acte avec sa nouvelle appellation « Ministère
de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche
et des affaires rurales », montrant que l'agriculture
ne suffit plus à représenter à
elle seule les affaires rurales. Justement, un projet
de loi sur le monde rural est en cours de préparation,
pour donner un nouveau contenu et un nouvel élan
à la ruralité. Une des mesures envisagées
consiste à créer des « zones d’agriculture
protégée », pour éviter
que, là où elle est nécessaire,
l’activité agricole ne soit remplacée
par l’urbanisation, la friche ou la forêt.
C’est maintenant l’espace rural qui va
protéger l’agriculture, plus que l’agriculture
n’entraînera le rural.
D’ailleurs, en France, la majorité des
ruraux est maintenant constituée de
« citadins » résidant à
la campagne ou dans des localités rurales.
Il y a là aussi un phénomène
mondial : depuis trois ans, l'ensemble du monde comporte
plus de 50 % d'urbains. C’est donc à
travers une mentalité de citadins que la ruralité
choisira son visage : l'espace rural ne sera-t-il
qu'une zone de détente ou d'extension des activités
citadines, dans un cadre plus verdoyant, bien que
bénéficiant moins des services fournis
par la société ?
Ou bien la redécouverte de relations profondes
avec la nature fera-t-elle de cet espace rural un
lieu privilégié pour développer
des modes de vie plus
« humains » ? J’ai rencontré
dernièrement plusieurs familles qui ont réalisé
leur décision de quitter de grandes métropoles
pour venir, cette année, s’installer
dans les Alpes-de-Haute-Provence. Un des éléments
qui a compté dans leur choix est le désir
de vivre et d’éduquer leurs enfants dans
une relation quotidienne avec la nature. L'espace
rural, par le rôle qu’il joue pour l'eau,
l'air, l’alimentation, l’équilibre
personnel se redécouvrirait alors comme le
berceau, l'écrin, la source des activités
humaines. Plus profondément, cet espace pourrait
être le révélateur que ces activités
s'inscrivent dans une dynamique plus grande qu'elles
même. Il nous rappelle que l’homme n’est
pas le centre du monde.
Le débat sur les incendies
de forêt
J'avais commencé à écrire
ces lignes en me disant que ces débats risquaient
fort d'être éclipsés, à
la rentrée, par les problèmes sociaux
et économiques. Et puis, malheureusement, la
canicule et les incendies de forêt sont venus
remettre le projecteur sur la nature. Nous sommes
confrontés à la question : pourquoi
tant de forêts ont brûlé ?
- C’est peut-être parce que notre dispositif
de prévention et de lutte est insuffisant
pour que, sans risques, nous puissions nous permettre
de faire n'importe quoi, n’importe où,
n'importe quand.
- Les incendies ne révèlent-ils pas
la vulnérabilité de la nature à
des comportements peu respectueux de sa «
vie » propre, ayant perdu le souci de gérer
la création ?
Le débat, d'assez bonne tenue, qui a eu lieu
dans la presse, reflète les réflexions
des autorités publiques. Au delà de
ce qu'une sécheresse exceptionnelle rend inévitable,
comment la collectivité peut-elle gérer
activement les espaces naturels, agricoles et forestiers,
en continuant à les protéger de la pression
des constructions légales ou illégales
et en rendant l’ensemble du territoire moins
sensible au feu ?
L'idée se fait jour que la nature fait partie
de la richesse de ces territoires (d'ailleurs, sa
disparition par le feu appauvrit les agents économiques
qui vivent du tourisme). Comme certaines stations
de ski financent des plantations pour se protéger
des avalanches, ceux qui tirent bénéfice
de la présence de la forêt méditerranéenne
n’auraient-ils pas tout intérêt
à en financer une bonne gestion ? Et les agriculteurs,
dans le cadre de la nouvelle PAC, devraient pouvoir
restaurer de grands pare-feux agricoles, aidés
par des financements pour ce qui n'est plus directement
rentable. Quand on voit se multiplier la publicité
pour l'huile d’olive, on peut penser qu'il ne
serait pas idiot de replanter des zones d'oliviers
bien entretenues.
Une autre particularité du débat actuel
est la progression du concept de « résilience »
diffusé à l'occasion des tempêtes
de 1999. La résilience est la capacité
de la nature à se reconstituer après
un traumatisme grave. Face à une catastrophe,
la nature n'est pas seulement un objet à protéger
ou à reconstituer, c'est un organisme vivant
dont on accueille et favorise la reprise de vie.
On peut y trouver une dimension pascale de la création.
Je reviens de parcourir professionnellement le massif
des Maures. Dans une immensité de cendres,
où les troncs noircis des chênes-lièges
dressent vers le ciel des branches à l’écorce
calcinée, il est impressionnant de voir, sur
celles-ci, repousser déjà des rameaux
vert tendre. Mais il faudra accueillir ce don de la
nature et le compléter par le travail des hommes
afin de faire à nouveau un territoire harmonieux
et utile.
Les incendies de forêts, qui ont meurtri la
Californie, l’état le plus riche du pays
le plus riche du monde, ont été éteints
par la pluie tombant du ciel ! Il me semble que notre
relation avec la nature est encore loin de devenir
un sujet mineur.
Quelle contribution l’Église
peut-elle apporter pour donner du sens ?
Vous toutes, œuvres du Seigneur,
bénissez le Seigneur :
chantez-le, exaltez-le éternellement !
Et vous, océans et rivières, bénissez
le Seigneur !
Baleines et bêtes de la mer, bénissez
le Seigneur !
Vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez
le Seigneur !
Vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le
Seigneur !
(Daniel 3, 57 & 78-81)
Dans deux articles précédents,
l’analyse des débats, en cours dans la
société française, a mis en lumière
les questions de notre relation avec la nature. Il
me semble que ces questions se cristallisent dans
l’alternative suivante (forcément caricaturale
pour permettre de mieux cerner la question) :
Ou bien : une nature à maîtriser
pour notre bien-être
Un premier choix s’offre à nous. Il consiste,
sous l’influence de la mentalité citadine
majoritaire et des pressions économiques, à
considérer la nature comme un simple «
instrument » qui produit des ressources renouvelables.
Ce serait alors se limiter à réintégrer
la nature dans les schémas utilitaires habituels.
Un éventail très ouvert de ressources
s’offre effectivement à nous : depuis
la qualité de vie ou certains services (tels
que la protection des sols ou de l’air), jusqu’aux
matières premières ou aux médicaments,
en passant par les sensations ou les émotions.
Cela justifie alors, bien entendu, de maîtriser
cette nature pour qu’elle satisfasse nos besoins.
Nous conserverons néanmoins un œil sur
la nature sauvage, chaque soir, par la petite lucarne
de la météo à la télévision
et certains jours nous constaterons qu’elle
nous échappe encore lorsque nous seront montrés
les effets d’une catastrophe naturelle. La canicule
de cet été a prouvé que la France
entière pouvait être dramatiquement plongée
dans la surprise d’une nature non maîtrisée.
Ou bien : une nature à respecter, avec
laquelle nous sommes partenaires.
Un autre choix est possible, celui de réintégrer
la nature, comme un partenaire, dans les fondements
culturels de la société ; un partenaire
que l’on respecte, qui a sa propre raison d’être
et pour lequel nous pouvons avoir à ajuster
nos comportements. Des intuitions fortes se manifestent
dans ce sens, mais elles reposent trop souvent sur
des principes encore flous.
Dans ce contexte français, ce dernier article
voudrait aider à regarder la contribution de
l’Église.
L’apport des courants religieux
Les religions, dont l’Église
catholique, dépositaires de théologies
de la création, ont leur place dans le débat.
Ainsi, Florence Eibl, plaidant pour une écologie
chrétienne, écrivait dans La France
catholique : il faut « approfondir le trésor
qu’est la révélation de Dieu créateur
» . Les incendies de forêt de l’été
dernier, dans le Sud-Est de la France m’ont
conduit, professionnellement, à évaluer
les conséquences de ce qu’ils ont produit.
Revenant de l’une de ces missions, j’ai
rencontré Bruno Frappat, rédacteur en
chef de La Croix, et nous avons évoqué
ces questions, relatives au respect de la nature.
Il m’a confié qu’il lui paraissait
primordial que le message de l’Église
puisse se faire entendre, à l’heure actuelle,
sur deux points particuliers : le respect de l’homme-créature
et le respect de la création. Cela me conforte
à essayer de clarifier ce qui est en jeu du
point de vue de notre foi chrétienne.
Un certain nombre de réalisations ont déjà
commencé en ce sens, en voici quelques exemples
:
Les évêques de France ont souhaité
créer une antenne « Environnement et
modes de vie », en lien avec la Commission sociale
de l’épiscopat et s’appuyant sur
l’expérience de Pax Christi. Cette antenne
prépare actuellement un document afin de présenter
des repères bibliques, théologiques
et spirituels sur la Création, ainsi que des
pistes en vue d’aider à préparer
des actions concrètes et des célébrations
liturgiques. Il sera destiné aux assemblées
paroissiales et aux chrétiens.
J’avais déjà rencontré
le mouvement Pax Christi en 1995, au colloque de Klingenthal
sur la forêt, rassemblant des scientifiques,
des représentants des principales religions
et des membres de populations indigènes familières
de la forêt. Depuis une quinzaine d’années,
ce mouvement a créé une commission «
Sauvegarde et gérance de la création
» pour informer, organiser des rencontres et
animer des liturgies autour du thème de la
création.
C’est déjà commencer à
répondre à la demande de Jean-Paul II,
dans sa lettre « Pastorem gregis » qui
nous a été présentée dans
le précédent numéro d’
Église de Digne : « Le sens profond
de l’appel à mondialiser la solidarité
concerne également, et de manière urgente,
la question de la sauvegarde de la création
et celle des ressources de la terre. » Le Pape
conclut : « Il faut donc une conversion écologique,
à laquelle les évêques apporteront
leur contribution en enseignant le rapport correct
de l’homme avec la nature. »
Plus largement, des représentants de différentes
religions se sont retrouvés cette année,
autour du thème « écologie et
spiritualité », au Mont-Saint-Michel
à l’invitation du W.W.F. J’y participais.
Il y a été exprimé que la sauvegarde
de l’environnement avait besoin de l’apport
des religions. Le directeur de cabinet de la ministre
de l’écologie et du développement
durable, a désiré se rendre présent
de bout en bout, car, au moment de rédiger
une charte nationale de l’environnement, il
estimait que les religions étaient dépositaires
de valeurs et de sens en ce domaine.
Les Églises peuvent s’intégrer
au débat parce qu’elles sont porteuses
de richesses. C’est une bonne illustration de
la laïcité. Effectivement, les religions
représentées ont montré qu’elles
pouvaient apporter des contributions à ce combat
pour mieux gérer la création. Un mois
après, des représentants de l’Église
catholique des différents pays d’Europe
se rassemblaient à Wroclaw, en Pologne, pour
échanger sur l’éducation au respect
de l’environnement. J’y ai constaté
que les catholiques avaient la capacité de
contribuer à un tel apport de sens et que certains
pays avaient déjà une expérience
élargie dans ce domaine : formation scolaire
et universitaire sur « foi et environnement
», manuels pour l’action des paroisses,
célébrations œcuméniques.
Et nous, comment pouvons-nous faire avancer les choses
à notre niveau ?
L’existence d’un Dieu créateur
qui a désiré et créé la
nature avec toutes ses lois, place l’homme dans
une relation triangulaire « Dieu –
homme – nature ». Cet homme, lui-même
créature mais, plus encore, créé
à l’image de Dieu. Et cette relation
peut éclairer les comportements de notre société
vis-à-vis de son environnement. Je ne citerai
que quelques exemples :
- L’admiration à l’égard
de Dieu pour les merveilles de sa création
peut favoriser un meilleur respect de la nature.
- Lorsqu’on évoque les changements
fondamentaux qui ont lieu dans l’histoire
des hommes, la tradition biblique du « germe »
qui pousse lentement, comme dans la nature, peut
être précieuse pour conjurer la tentation
mécaniste de chercher à fabriquer
une solution technique immédiate.
- La tradition du pèlerinage qui conduit
à marcher dans la nature vers un but est
souvent une expérience spirituelle forte
et pas seulement lorsque l’on arrive à
destination.
- La recherche d’exemples de « développement
durable » a amené récemment
un cabinet de consultants à faire une étude
sur un certain nombre de monastères en France.
Il a constaté que l’ensemble de ces
monastères répondait exactement aux
critères du « développement
durable » sous ses trois angles : économique,
social et environnemental.
On sent bien que, de partout, des initiatives surgissent
pour l’environnement. Le diocèse de Digne,
particulièrement rural, riche d’un patrimoine
de tant de chapelles et d’églises enchâssées
dans la nature, ainsi que d’habitants attachés
à une relation étroite avec elle, peut
certainement avoir un rôle à y jouer.
Jean-Hugues Bartet, diacre |