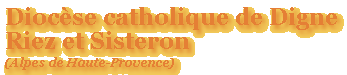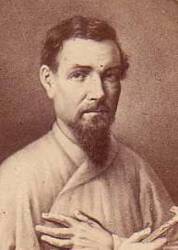|
Il n’est pas facile de parler de
façon significative de Jacques Chastan en une demi-heure,
tellement sa vie est riche en évènements et
en enseignements. Je vais essayer de dire l’essentiel
en divisant cette intervention en deux parties, un rappel
de sa vie que beaucoup d’entre vous connaissent déjà,
mais qui est encore un peu étrangère à
certains, et une mise en relief des principaux traits de sa
personnalité spirituelle qui peuvent, sinon nous servir
de modèle, du moins nous inspirer dans notre propre
cheminement.
Mais avant de commencer je voudrais que nous
ayons une pensée pour deux personnes absentes physiquement,
mais reliées à nous par la prière et
par le cœur : le père Thierry Cazes, curé
de Sisteron, qui a redécouvert Jacques Chastan il y
a douze ans, mais qui n’a pas pu venir parce qu’il
est souffrant ; et le père Charles Lee, notre interprète
coréen des célébrations de 2003, l’une
des principales chevilles ouvrières de tous les échanges
franco-coréens, qui après plus vingt années
de ministère et d’études en France, vient
d’être rappelé en Corée par son
évêque. Sans eux, nous ne serions pas rassemblés
ici aujourd’hui.
I. La vie
Enfance
Jacques Chastan est né le 7 octobre
1803, à Marcoux, dont son père, André
Chastan, était originaire. Sa mère, Marie-Anne
Rougon était de Pompierry, dans la région de
Seyne-les-Alpes. La famille était relativement aisée
pour l'époque, puisqu’elle possédait une
maison (qui existe toujours), un troupeau d'une cinquantaine
de bêtes, deux mules et suffisamment de terre pour nourrir
huit enfants. Jacques, l'aîné, aura quatre frères
et trois sœurs. Très jeune il se voit confier
la garde du troupeau. Cette formation de bon pasteur, cette
familiarité avec la nature et les animaux, cette capacité
à assumer seul des responsabilités trop lourdes
pour lui resteront ancrées dans sa personnalité
missionnaire. Jacques deviendra un homme solide physiquement
et moralement, résistant à la fatigue et à
la souffrance, habitué à l'effort et à
la discipline du travail collectif.
Mais dans sa famille très unie et très
pieuse, il trouve aussi une grande sécurité
affective, beaucoup de sollicitude et de rigueur morale. Ce
sera donc un homme bon, tendre, attentif aux autres, honnête,
scrupuleux, et extrêmement chaleureux dans ses relations.
À mesure qu’il grandit, sa gentillesse,
sa docilité et sa vertu d’enfant bien élevé
attirent l’attention du curé qui persuade sa
famille de l’orienter vers la carrière ecclésiastique.
Aussi, après qu'il ait appris à lire et à
écrire auprès de ses parents et reçu
les premiers rudiments de latin de la part du curé,
le met-on au collège de Digne à quinze ans ;
puis deux ans plus tard on l'envoie au petit séminaire
d'Embrun. Ce garçon de plein vent, habitué à
l'exercice et au grand air, mais timide et ignorant du monde,
a beaucoup de mal à s'adapter à l'univers confiné
du séminaire, et à vivre loin de sa famille.
Il se soumet sans enthousiasme à la volonté
de ses parents et de ses supérieurs, et s'enferme dans
l'obéissance laborieuse d'un élève médiocre.
Vocation
Sa vie commence à basculer le 3 décembre
1820, quand il entend au réfectoire le récit
de la vie de saint François-Xavier, le grand apôtre
de l’Asie et le patron des Missions. Le jeune bas-alpin
de dix-sept ans découvre soudain que le monde ne se
limite pas aux murs du séminaire ni aux montagnes de
Marcoux. Et il comprend en même temps que s'il doit
être prêtre, ce n'est pas pour s'assurer une situation
honorable au milieu de gens bien installés dans une
religion confortable, mais pour porter la Bonne Nouvelle jusqu'aux
extrémités de la terre. Comme saint François-Xavier,
il rêve donc d’être missionnaire.
L’année d’après,
un nouveau choc va irrémédiablement bouleverser
l'existence de ce modeste fils de paysan promis à une
tranquille carrière de vicaire de campagne. En se plongeant
dans la lecture des revues missionnaires très répandues
dans les séminaires de l’époque, Jacques
Chastan découvre en 1821 une histoire extraordinaire,
celle de l’Église de Corée.
L’Église de Corée
La Corée est à cette époque
le pays le plus fermé d'Asie. C'est le Royaume Ermite
dont aucun habitant ne doit sortir et dans lequel aucun étranger
n'a le droit de pénétrer sous peine de mort.
Les seuls Coréens autorisés à
sortir du pays sont les ambassadeurs qui chaque année
portent le tribut à l'Empereur de Chine. Au dix-huitième
siècle, ils ont ramené chez eux des livres de
théologie chrétienne traduits en chinois, leur
langue administrative, par les jésuites de Pékin.
Ces livres soulèvent l'enthousiasme
d’un groupe de jeunes intellectuels coréens qui,
en1784, envoient l'un des leurs à Pékin par
l'intermédiaire de l'ambassade. Le jeune homme, Yi
Seung Hoon, se fait baptiser en secret sous le nom de Jean-Baptiste
et, à son retour, il baptise ses compagnons. Une première
communauté, très dynamique, se constitue autour
d'eux. Mais le gouvernement, inquiet de ces nouvelles tendances,
réagit rapidement en déclenchant une première
persécution contre les sectateurs d'une doctrine étrangère
jugée dangereuse pour la sécurité de
l'État.
Les chrétiens coréens résistent,
s'organisent dans la clandestinité et prennent peu
à peu conscience du besoin fondamental de toute Église
: la nécessité d'obtenir des sacrements et donc
la présence de prêtres. Sur leur demande, transmise
par des chrétiens clandestinement infiltrés
dans l'ambassade, l'évêque de Pékin leur
envoie un jeune lazariste chinois, Jacques Chu, qui réussit
à se maintenir pendant six ans dans le pays, mais est
arrêté et exécuté lors d’une
grande persécution en 1801 de même que des centaines
de Coréens. Les survivants privés de leurs biens
s'exilent dans des endroits retirés, et en 1811 réussissent
à faire parvenir une lettre au pape Pie VII, lui demandant
de leur envoyer des prêtres. Mais le pape n'est pas
à Rome, et n'a plus aucun pouvoir, car l'Empereur des
Français, Napoléon 1er le retient prisonnier
à Fontainebleau. Malgré leur héroïque
résistance, les chrétiens coréens ne
recevront aucun secours.
Telle est l’histoire que Jacques Chastan
découvre à Embrun, en 1821. Désormais,
le timide séminariste n'aura plus qu'un but, répondre
à la demande de cette Église persécutée
qui réclame en vain de l'aide depuis vingt ans et qui
devient l'objet de tous ses désirs et de tous ses rêves.
Sa décision, encore secrète, sera irrévocable.
En 1822 Jacques Chastan entre à dix-neuf
ans au grand séminaire de Digne. Il lui faudra quatre
ans de sollicitations assidues, à temps et à
contre-temps, pour obtenir de son évêque, Mgr
de Miollis, l'autorisation de partir en mission, autorisation
qui ne lui sera accordée que quelques jours à
peine avant son ordination, en décembre 1826.
Le 1° janvier 1827, une semaine après
son ordination, Jacques vient faire ses adieux à sa
famille qui n'a jamais voulu prendre au sérieux ses
projets missionnaires. La réaction de désespoir
de sa mère est terrible. Jacques gardera toute sa vie
le remord de cette séparation.
Le lendemain, il part pour le séminaire
des missions des Missions étrangères de Paris
qui forme des prêtres séculiers pour les pays
d’Asie. Il a vingt-trois ans.
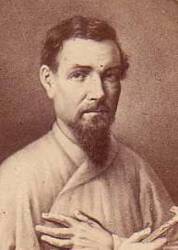
Paris-Pinang
Trois mois plus tard, il s'embarque à
Bordeaux à bord d'un voilier, le Navigateur, à
destination de Macao, le comptoir portugais qui est le centre
des missions d’Extrême-Orient. Ses supérieurs
l’ont affecté à la mission chinoise du
Setchoan. Son voyage, retardé par une tempête
et un naufrage, va durer quinze mois au lieu de six.
Quand il arrive à Macao, en juillet
1828, une surprise l'attend, bonne et mauvaise à la
fois. Car pendant son voyage, une nouvelle lettre d'appel
au secours des chrétiens coréens est arrivée
à Rome et le pape a demandé aux Missions étrangères
d'envoyer quelques missionnaires en Corée. Les directeurs
ont tout d'abord refusé estimant que leurs effectifs
étaient déjà insuffisants et qu'un tel
projet n'avait aucune chance de réussir. Mais, sur
l'insistance de Rome, ils ont accepté d'organiser une
consultation auprès de tous leurs missionnaires pour
voir s'il s'y trouverait quelques volontaires pour tenter
cette expédition impossible.
Ainsi contre toute attente Jacques Chastan,
en débarquant à Macao, retrouve la mission de
ses rêves qu'il n'osait plus espérer, sa chère
Corée. Évidemment, il se porte aussitôt
volontaire. Mais le procureur, inquiet de sa naïveté,
de son inexpérience et de son trop grand enthousiasme,
l'envoie s'accoutumer aux usages asiatiques dans le collège
de Pinang, en Malaisie, où il est chargé d'apprendre
le latin et la théologie à de jeunes séminaristes
chinois. La déception est immense et Jacques doit faire,
une nouvelle fois, la dure expérience de la soumission.
Quand, au bout de deux ans, on s'aperçoit
enfin qu'il n'est vraiment pas fait pour l'enseignement, et
qu'entre-temps il a appris le chinois, on l'affecte au service
de la communauté chinoise d'une île voisine,
Poulo-Tikus où se révèlent des qualités
pastorales qui ne se démentiront jamais. Il est très
aimé des chrétiens.
Cependant il n'a pas oublié la Corée
et pour une fois, la chance va lui sourire. Car il a pour
supérieur un jeune évêque, Mgr Bruguière,
qui travaille avec lui à Pinang et s'est lui aussi
porté volontaire pour la Corée. En 1831, le
nouveau pape, Grégoire XVI, nomme Mgr Bruguière
vicaire apostolique de Corée et le charge de recruter
les collaborateurs de son choix.
La nouvelle arrive à Pinang en 1832.
Mgr Bruguière part aussitôt, dans la plus parfaite
incertitude, à la conquête de sa nouvelle mission
et promet à Jacques de l'appeler dès que la
voie sera tracée. Il leur faudra plus de quatre ans
pour trouver le moyen d'entrer en Corée
Chine
Jacques quitte Pinang en juin 1833, un an après
Mgr Bruguière qu'il doit rejoindre à Pékin
mais qu'il ne reverra jamais. Il passe par Macao, puis s'embarque
pour Fougan, où il rencontre Pierre Maubant, le deuxième
volontaire recruté par Mgr Bruguière. Pour plus
de sécurité les deux hommes décident
de voyager séparément car la Chine est toujours
interdite aux étrangers.
Pierre Maubant, après une halte secrète
à Pékin, se réfugie en Mongolie, au-delà
de la grande muraille, où Mgr Bruguière, retardé
par la maladie, viendra le rejoindre en 1835. Jacques lui,
après de multiples péripéties, accepte
de l'évêque portugais de Pékin, un poste
provisoire dans la province chinoise du Chan Tong une presqu’île
située en face de la Corée sur la mer jaune.
Au bout d'un an il attrape la dysenterie en administrant des
malades et échappe de peu à la mort.
En 1836, il reçoit des nouvelles de
Corée. Mgr Bruguière est mort à quelques
jours de marche de la frontière coréenne, mais
Pierre Maubant a réussi à entrer à sa
place et lui envoie des guides pour le mois de décembre
suivant. Cette fois, la Corée lui tend les bras.
Au mois de novembre Jacques Chastan se met
en route. Il évite Pékin, franchit en cachette
la grande muraille et arrive le jour de Noël à
Pien Men, la dernière ville chinoise, en Mandchourie,
où il rencontre les quatre catéchistes coréens
chargés de le conduire. Il change son costume chinois
pour celui d'un pauvre homme coréen puis, en compagnie
de ses guides, traverse à pied le fleuve gelé
et franchit la frontière par un trou percé dans
les fortifications. C'est le 2 janvier 1837, dix ans jour
pour jour après son départ de Digne. Il a trente-trois
ans.

Corée
La vie en Corée est pour les chrétiens,
et plus encore pour leurs missionnaires, extrêmement
dangereuse et pénible. Jacques Chastan et ses deux
confrères, Pierre Maubant et Laurent Imbert, le nouveau
vicaire apostolique qui entre un an après lui, doivent
vivre dans la clandestinité la plus totale, ne se déplaçant
que la nuit et toujours sous l'habit de deuil qui les tient
à l'écart du monde. Pour ne pas faire repérer
leur présence, ils changent presque chaque jour de
maison et vivent dans la hantise que leur arrivée dans
un village ne provoque une dénonciation et une persécution.
Ils parcourent des centaines de kilomètres, à
pied, à cheval ou à dos de bœuf, par des
sentiers à peine praticables, souvent dans la neige
et la glace. Ils dorment très peu, à même
le sol, et mangent encore moins car les Coréens eux-mêmes
qui les hébergent sont pour la plupart réduits
à la misère. Et régulièrement
ils reçoivent des nouvelles d'arrestations, d'apostasies,
de tortures, d'exécutions frappant leurs fidèles.
Pourtant les conversions continuent à
se multiplier : en trois ans le nombre de chrétiens
passe de trois mille à neuf mille.
Mais, après deux années de harcèlements
sporadiques, une nouvelle persécution générale
contre les chrétiens est déclanchée au
début de l'année 1839. Au fur et à mesure
que se multiplient les arrestations, les procès et
les exécutions, l'étau se resserre autour des
missionnaires dénoncés par des apostats mais
héroïquement protégés par des chrétiens
fidèles. La prise en juin des trois principaux chefs
de la chrétienté coréenne, Paul Chong,
Charles Cho et Augustin Yu, suivie en août par celle
de Laurent Imbert, va précipiter les évènements.
Confronté à la cruauté des interrogatoires
dont sont victimes, avec et devant lui, les chrétiens
emprisonnés, l'évêque prend la décision,
exceptionnelle dans l'histoire de l'Église, de demander
à ses confrères de se livrer dans l'espoir que
leur capture fera cesser les poursuites. Les deux missionnaires
obéissent, sans tergiverser, le 6 septembre, ayant
seulement pris le temps d'écrire le dernier rapport
de la mission et quelques lettres d'adieux.
Le procès des missionnaires a duré
près de deux semaines pendant lesquelles on a essayé
par tous les moyens de leur faire dénoncer les chrétiens
qu'ils avaient administrés. Les Annales officielles
de la cour de Corée attestent que ni les juges ni les
bourreaux n'ont réussi à les faire parler. Ils
ont été décapités à l'issue
d'un grand cérémonial public, le 21 septembre
1839.
II. Le modèle missionnaire
Désir
Jacques Chastan a un projet de vie. Il est,
dès l’âge de dix-sept ans, habité
par un désir profond, celui de rejoindre les chrétiens
de Corée. Au départ ce désir s’apparente
à un rêve, à une folie, et c’est
ainsi que le perçoit son entourage : sa famille, ses
amis et même son évêque. Mais derrière
la part inévitable et bien humaine d’enthousiasme
juvénile et d’illusion, il y a chez Jacques Chastan
le sentiment intime d’une nécessité spirituelle
qui s’impose à lui, et à laquelle il ne
peut pas se dérober parce qu’elle vient de plus
haut que lui. Toutes ses années de séminaire
sont marquées par ce qu’il perçoit non
seulement comme un appel (le propre de toute vocation) mais
plus encore, et de façon assez mystérieuse,
comme le pressentiment d’un destin à accomplir
coûte que coûte. C’est cette certitude intérieure,
modelée, éprouvée par des années
d’oppositions extérieures et de contrariétés,
qui lui donnera la persévérance et le courage
nécessaires pour franchir tous les obstacles qui le
séparent de son but. Ces obstacles, et Dieu sait comme
ils furent nombreux et variés, apparaissent comme autant
d’épreuves nécessaires pour purifier son
désir de toute projection personnelle. Quand il entre
enfin en Corée, Jacques Chastan n’est plus le
jeune exalté qui rêve d’une mission impossible,
mais le serviteur dépouillé de tout qui peut
reprendre à son compte la parole du prophète
: Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté.
Générosité, écoute et
respect de l’autre
Jacques Chastan n’est pas parti en mission
par goût de l’aventure, ou pour imposer ses idées,
mais bien pour répondre à la demande des chrétiens
coréens. Son désir n’est donc pas motivé
par la satisfaction d’une envie personnelle mais par
un mouvement de solidarité et de sympathie (souffrir
avec) envers ceux qu’il perçoit, en tant que
prêtre, comme les plus déshérités.
Pourtant cette générosité radicale (en
entrant en Corée, il sait qu’il en mourra) ne
s’accompagne d’aucun sentiment de supériorité
ou de condescendance, car chez lui amour de Dieu et amour
de prochain coulent de la même source. Ils sont de la
même qualité. Voici ce que disaient de lui les
chrétiens coréens :
« Il répandait au loin la bonne
odeur du Christ (…) On ne pouvait approcher de lui sans
se sentir tout échauffé de l'amour de Dieu.
Les chrétiens trouvaient en lui l'amour d'un père
et la tendresse d'une mère. »(Actes des Martyrs
de Corée)
C’est bien cette sollicitude à
la fois tendre et protectrice, maternelle et paternelle, qui
transparaît dans la lettre qu’il écrit
à ses fidèles au moment de se livrer :
« En présence des évènements,
je désirais de tout mon cœur souffrir en votre
place les maux de la persécution ; hélas !,
c’était impossible. Me cachant donc à
grand peine, je voulais d’une part attendre l’ordre
de la Providence, le commandement de mon évêque,
et de l’autre prendre en pitié l’état
d’abandon où vous réduirait le mort de
vos pasteurs. »
Jusqu’à son dernier acte pastoral,
celui de se livrer, Jacques Chastan fera passer l’intérêt
de ses fidèles avant ses envies ou ses préférences
personnelles.
Persévérance.
Il en a fallu beaucoup à Jacques Chastan,
puisqu’il a mis dix ans pour accomplir son projet. L’épreuve
a été particulièrement difficile à
Pinang où il a dû remplir une fonction, celle
de professeur, pour laquelle il n’était pas fait.
Il s’y est soumis, mais il ne s’est pas résigné.
Il a conservé intact son ressort intérieur :
la foi, l’espérance et le courage qui lui ont
permis de rebondir. Il aurait pu se décourager et sombrer
dans la dépression. L’histoire des missions ne
manque pas d’exemples de jeunes missionnaires enthousiastes
et bien intentionnés au départ qui craquent
devant la déception, le choc d’une réalité
qui ne correspond pas à ce qu’ils attendaient.
Il faut un solide équilibre humain et une grande fermeté
spirituelle pour résister à la désillusion,
surtout quand on a tout quitté sans espoir de retour.
Au collège de Pinang, Jacques Chastan a dû constater
ses limites. Il a accepté humblement, sans se braquer,
les remontrances de ses supérieurs et le chahut de
ses élèves, alors qu’il ressentait durement
l’isolement affectif puisqu’il n’avait pas
reçu la moindre nouvelle de sa famille depuis son départ,
plus de deux ans. Voici ce que pensait de lui le supérieur
du collège :
« Monsieur Chastan, qui les juge (les
élèves) meilleurs qu’ils ne sont, tout
occupé à étudier la langue, ne les surveille
point. Il n’a pas l’art de gouverner les jeunes
gens. On se plaint aussi qu’il prononce fort mal le
latin et qu’il est mal entendu par les écoliers,
ce qui ne m’étonne pas car il a l’accent
du midi très prononcé. »
Malgré les difficultés quotidiennes
de son travail de professeur, malgré la fatigue et
les divers malaises dus à l’acclimatation, il
a tenu, passant tout son temps disponible et une partie de
ses nuits à combler ses lacunes en apprenant le Chinois.
S’il a réussi, c’est moins grâce
à ses compétences que grâce à sa
persévérance et son humilité.
Humilité
Cette humilité est une humilité
authentique, sincère, dénuée d’affectation
ou de fausse modestie ; une humilité au sens étymologique
du terme : le sens de la terre (humus), c’est-à-dire
le sens des réalités et des limites de la condition
terrestre.
Jacques Chastan ne se prend pas pour plus qu’il
n’est, mais pas pour moins non plus. Il sait parfaitement
que parmi des confrères plus intellectuels et plus
expérimentés que lui, il passe un peu pour un
paysan, pour un naïf. Il ne s’en offusque pas,
mais il ne se laisse pas non plus rabaisser. Humilité
n’est pas synonyme d’humiliation. Jacques Chastan
connaît ses faiblesses, mais il connaît aussi
ses atouts. Il a confiance en lui parce qu’il a confiance
en Dieu. Il sait que Dieu a confiance en lui et attend de
lui des choses difficiles qu’il l’aidera à
accomplir. Aussi son humilité est-elle indissociable
d’un sens aigu de l’humour, d’une finesse
spirituelle (au double sens de spiritualité et d’ironie)
dont il ne se départira jamais. En 1830, il écrivait
ainsi au procureur de Macao :
« La dure Corée a pour moi bien
des charmes, mais lorsque je réfléchis sérieusement
que je ne suis qu’un ignorant, un stupide, un lourdaud
de Provençal, je suis bien forcé de convenir
que c’est être bien téméraire que
d’entreprendre dans de telles dispositions une œuvre
qui demande des hommes accomplis en vertus et en science,
en un mot un apôtre (…) (Pourtant), si l’on
veut mettre sur mes épaules le fardeau, on trouvera
toujours en moi un bon âne de Provence qui ne refusera
pas la charge pourvu que l’avoine ne manque pas. »
Ce sens de l’humour se manifestera jusqu’au
bout, jusque dans la lettre d’adieu qu’il écrit
le 6 septembre 1839 aux directeurs des Missions étrangères
pour leur demander de ne pas abandonner la chrétienté
de Corée après son exécution et celle
de ses confrères :
« Pour encourager nos chers confrères
qui seront destinés à venir nous remplacer j'ai
l'honneur de leur annoncer que le ministre Yi, actuellement
grand persécuteur, a fait faire trois grands sabres
pour couper des têtes. »
Comment a-t-il pu parvenir à une telle
sérénité dans des circonstances humaines
aussi catastrophiques ? Nous touchons ici au dernier trait
remarquable de sa personnalité spirituelle, sa capacité
d’abandon.
Abandon
L’abandon n’est pas la même
chose que l’obéissance, même si l’obéissance
en fait partie. C’est un état de disponibilité
intérieure qui lui permet d’accepter les contrariétés
et de résister aux moments les plus difficiles. Une
soumission non seulement à l’autorité
de ses supérieurs, mais à ce qu’il interprète,
dans les évènements qui adviennent sur sa route,
comme la volonté de Dieu. En 1834, alors qu’il
est complètement perdu et isolé en Chine, ne
sachant de quel côté se tourner, il explique
dans une lettre écrite à son cousin, M. Allemand,
professeur au collège de Digne, la méthode qui
lui permet de sombrer dans le découragement :
« Quand je sens naître en moi quelque
sentiment de tristesse à la vue des obstacles que le
démon suscite (…) pour me faire perdre courage,
je le rejette aussi promptement que je puis ; j’ai éprouvé
bien des fois qu’au moment où tout paraît
perdu, un acte de soumission au bon plaisir de Dieu n’et
pas plutôt formé que tout change tant Dieu semble
vouloir faire notre volonté. »
Jacques laisse Dieu guider sa vie, mener la
danse de son existence. Cet abandon intérieur n’est
cependant pas synonyme de passivité, d’inertie.
Au contraire, il lui permet une grande souplesse extérieure.
D’un côté Jacques Chastan ne désobéit
jamais, ne cherche pas à s’imposer, ni à
imposer ses idées. Aussi est-ce un homme de paix qui
ne se braque pas devant les oppositions, qui ne cherche pas
à avoir raison à tout prix ou à dominer
les autres. Mais, dans son for intérieur, il se maintient
dans un état de disponibilité et de vigilance
qui lui permet de profiter des moindres occasions d’avancer
vers ce qu’il pressent être l’accomplissement
de son destin. Dès qu’il perçoit une brèche,
par exemple dans le désaccord hiérarchique entre
Mgr Bruguières et les directeurs des Missions étrangères,
il s’engage sans tergiverser dans la voie qui a sa préférence.
Bref, il sait travailler en équipe, à sa place
parmi les hommes et à sa place sous le regard de Dieu
qui finira par le conduire là où il désirait
aller.
Cet abandon atteint son plus haut point lors
de son entrée en Corée. En effet, contrairement
à ses prévisions, au lieu de se réjouir
d’avoir enfin atteint son but, Jacques est terrassé
par l’angoisse. Quelques mois plus tard, il avouait
dans une lettre aux directeurs des Missions étrangères
:
« Le récit des tourments qu’on
faisait endurer à cinq confesseurs de la foi (…)
l’appréhension continuelle où j’étais
qu’on vînt se saisir de nous et nous en faire
subir de pareils ou de plus cruels encore me fit impression
pendant quelques jours. Je compris alors que le martyre considéré
dans l’oraison à quelques mille lieues de l’endroit
où l’on peut le subir, et dans l’endroit
même où l’on est exposé à
un danger prochain de le subir, produit un effet bien différent.
» (Cette lettre sera par la suite donnée en exemple
par les professeurs des Missions étrangères
à tous les aspirants missionnaires un peu trop exaltés
par la tentation du martyre).
Seul l’abandon intérieur permettra
à Jacques de surmonter cette peur bien légitime
sur le plan humain. En évoquant cette crise dans la
lettre d’adieux à sa famille, il écrira
:
« Depuis Dieu m’a fait la grâce
de ne plus craindre. »
À partir de ce moment-là, Jacques
Chastan a atteint ce que les grands spirituels, comme François
d’Assise, appellent la joie parfaite, la joie inaltérable
de ceux qui ont atteint un état d’intime union
avec Dieu, une joie qui transcende toutes les circonstances.
Cette joie transparaît dans toutes ses lettres écrites
de Corée.
« Qu’il est bon d’être
ici. Vous ne sauriez croire comme il est doux de mener une
vie dure et laborieuse au milieu de grands dangers auxquels
on s’est exposé librement pour la gloire de Dieu
et le salut des âmes. » (à son cousin M.
Allemand, octobre 1838)
« Je m’estime heureux de me trouver
dans ce pays-ci et je vous avoue franchement que je ne changerai
pas pour la meilleure cure du diocèse de Digne. »
(à ses parents, octobre 1838)
« Je jouis d’une bonne santé,
très content de me trouver ici au milieu des dangers.
» (aux directeurs, octobre 1838)
Elle culmine dans la lettre d’adieu à
ses confrères, alors que la chrétienté
coréenne semble ruinée et qu’il s’avance
vers une mort épouvantable :
« Si quelque chose pouvait diminuer la
joie que nous éprouvons en ce moment du départ,
ce serait de quitter ces chers néophytes que nous avons
eu le bonheur d'administrer pendant trois ans et qui nous
aiment comme les Galates aimaient saint Paul. Mais nous allons
à une trop grande fête pour qu'il soit permis
de laisser entrer un sentiment de tristesse dans son cœur.
Nous avons l'honneur de recommander ces chers néophytes
à votre ardente charité. » (confrères,
6 septembre 1839).
C’est à cette joie, inexplicable
sur le plan humain, que l’on reconnaît la sainteté,
la sainteté qui n’est sans doute pas autre chose
que le fait, pour un individu à priori comme les autres,
d’avoir su percevoir et réaliser le dessein que
Dieu avait sur lui, d’avoir su répondre à
sa vocation et accomplir sa mission. Que cette mission soit
extraordinaire, comme celle de Jacques Chastan, ou beaucoup
plus anodine, comme celle de la plupart d’entre nous.
Pour moi, la découverte de Jacques
Chastan a été une rencontre fondamentale qui
a totalement renouvelé ma vie intérieure. Il
est devenu et demeure un compagnon de route très proche
auquel je peux me référer dans les bons comme
dans les mauvais jours. Je souhaite sincèrement qu’il
en soit de même pour chacun d’entre vous. Je peux
vous assurer que c’est une excellente fréquentation
!
|