
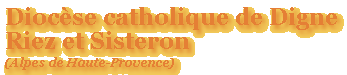

Recherchez votre paroisse
| |
|||||
|
|
 |
dialoguer... |
|||
|
Mgr Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux et président de la Conférence des évêques de France, a très bien exprimé l’actualité de la vie de notre Église, lors de ses deux discours (d’ouverture et de clôture) à l’assemblée des évêques de France, à Lourdes. Voici de larges extraits de ces deux discours. + François-Xavier Loizeau, évêque de Digne
Le 8 décembre prochain, nous fêterons le quarantième anniversaire de la clôture du concile Vatican II. À quarante ans de distance, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour tout le dynamisme apostolique qu’il a suscité dans notre Église. Son enseignement reste une lumière sur notre route. La veille de la célébration finale, le 7 décembre, était promulguée la Constitution pastorale Gaudium et spes dont nous connaissons bien les premières lignes : « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. » (n° 1) Cette conviction reste profondément la nôtre aujourd’hui. C’est parce que nous nous sentons pleinement solidaires des hommes de ce temps que nous avons voulu donner toute leur place dans la prière et la réflexion de notre assemblée aux événements qui marquent dramatiquement, ces jours-ci, la vie sociale de notre pays. Une actualité préoccupante La déclaration que j’ai publiée samedi dernier au nom de notre assemblée a exprimé la vive préoccupation qui est la nôtre devant la multiplication des actes de violence et de destruction que connaissent nombre de grandes agglomérations. Deux d’entre nous ont regagné dès lundi leur diocèse, manifestant ainsi le souci de l’ensemble des évêques devant cette situation. Nous ne pouvons, une nouvelle fois, que condamner l’usage de la violence et marquer notre compassion auprès de ceux qui en sont les victimes, en particulier les plus modestes qui ont perdu leur outil de travail ou leur moyen de déplacement. Nous voulons aussi souligner la difficulté du travail des forces de l’ordre, des pompiers, des services publics et des élus locaux pour accomplir leur mission avec le sang froid nécessaire dans ces circonstances. L’ordre doit être rétabli. Mais nous avons aussi rappelé que la seule répression et l’incitation à la peur collective n’étaient pas une « réponse à la hauteur de ces tensions dramatiques de notre société » et qu’il « était vital d’ouvrir à ces nouvelles générations, souvent en mal d’espoir, un avenir de liberté, de dignité et de respect de l’autre. » Si « beaucoup ne baissent pas les bras », nous avons un devoir impérieux de soutenir tous ceux – parents, éducateurs, enseignants, animateurs sociaux, associations, prêtres, religieux et religieuses – qui œuvrent, patiemment et souvent dans la discrétion, pour un vivre ensemble fraternel. Il n’en demeure pas moins que les événements de ces jours-ci doivent tous nous interroger. Nos choix, individuels et collectifs, concernant l’organisation de la vie en société peuvent nous conduire, de fait, à créer ou entériner des situations d’exclusion ou de ghetto. La responsabilité collective est du ressort des décideurs politiques et économiques. Mais elle interpelle aussi la conscience de chacun. L’égalité et la fraternité, conditions effectives de la liberté, sont dans les mains de tous. La collaboration de tous : pour une laïcité de participation C’est dans ce contexte que va être commémoré, le 9 décembre prochain, le centenaire de la loi de séparation des Èglises et de l’Ètat. Cent ans après, quel changement de situation ! Il y a un siècle, les politiques, fiers d’un idéal républicain, formaient le dessein de libérer le domaine public, et même la société, de ce qui leur apparaissait comme une mainmise de l’Èglise catholique. Aujourd’hui, c’est cette même société qui est fissurée et les valeurs républicaines fragilisées. Le vivre ensemble de populations diverses sur notre sol français n’est plus évident. On a besoin de la participation de tous et de toutes les composantes de notre pays pour renforcer ce vivre ensemble. Les Èglises et les religions, à partir des traditions qui leur sont propres, ont un rôle important à jouer pour rapprocher les cœurs et les esprits, pour inviter à la paix, au respect de la dignité de chacun, à la conversion des styles de vie. La dernière rencontre interreligieuse organisée par la Communauté Sant’Egidio à Lyon en septembre dernier en a été une expression particulièrement significative. Ceux qui veulent écarter les religions de l’espace social et les enfermer dans le seul domaine des convictions privées se trompent de siècle. Sans remettre en question les grands équilibres trouvés au cours d’un siècle d’application de la loi de 1905, nous voulons, comme catholiques, apporter notre pierre à l’édification, sans cesse à reprendre, de notre unité nationale. Nous ne pouvons que rappeler les convictions que nous exprimions le 15 juin dernier : « [l’Église] ne souhaite pas s’enfermer dans la défense de ses intérêts communautaires mais contribuer à promouvoir la dignité intégrale de chaque personne humaine dans notre vie sociale, ainsi que la paix et la justice dans notre société. Elle apporte avec d’autres sa participation dans les domaines divers : la solidarité, la culture, le vivre ensemble dans les cités, la participation à de multiples associations, la présence dans le domaine de la santé, de l’éducation, de la politique, le soutien aux familles, la consolidation des liens avec l’ensemble des Églises chrétiennes et les autres religions… Mais elle offre surtout ce qu’elle a en propre et qui est sa raison d’être : faire connaître le Christ, source de renouvellement intérieur et de fraternité ouverte à tous. » (Déclaration des évêques de France : L’Église catholique et la loi du 9 décembre 1905, cent ans après, n° 16).
La catéchèse Nous avons voté et adopté le Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France qui précise les grandes convictions et les points d’attention qui doivent guider la proposition catéchétique aujourd’hui. Ce texte se veut une mise en application, dans la situation française actuelle, du Directoire général pour la catéchèse, publié à Rome en 1997. Il souligne la situation d’évangélisation, et souvent de première évangélisation, dans laquelle se fait aujourd’hui la catéchèse. Sans ignorer l’importance qu’a l’éducation permanente de la foi pour tous les baptisés, il promeut une pédagogie qui soit vraiment au service de l’initiation, c’est-à-dire de l’entrée dans l’expérience chrétienne. Il propose d’accompagner pas à pas ceux qui la découvrent et qui sont invités à intégrer dans leur propre démarche de foi ces éléments structurants de toute expérience chrétienne :
Ce Texte national sera soumis, comme il se doit (cf. Directoire général n° 282), à l’approbation de la congrégation du clergé avant d’être promulgué par la Conférence des évêques de France. Sa version officielle ne sera publiée qu’après sa promulgation. Mais les réflexions qui sont sous-jacentes à son élaboration peuvent nourrir dès maintenant notre propre réflexion comme évêques diocésains. En effet, c’est dans les diocèses
que doit se poursuivre dorénavant le travail. Le Directoire
général demande à chaque évêque
d’« établir dans le diocèse un projet
global de catéchèse, articulé et cohérent,
qui réponde aux vrais besoins des fidèles et soit
convenablement situé dans les plans pastoraux diocésains.
» (n° 223) Si le travail n’a pas été
fait, ou si ayant été fait il a besoin d’être
actualisé, un chantier peut s’ouvrir au niveau de
nos diocèses, celui de l’élaboration d’orientations
diocésaines. Celles-ci gagneront à être travaillées
avec l’équipe diocésaine de catéchèse,
les curés, les prêtres, les catéchistes, les
différents animateurs ou animatrices d’aumôneries
scolaires. Il sera bon d’y associer aussi des conseils du
diocèse et les communautés chrétiennes. Je
pense tout particulièrement à celles qui se sont
mobilisées dans la réflexion : « Aller au
cœur de la foi ». La réalisation prendra des
formes diverses. Certains diocèses, par exemple, préfèreront
se mettre ensemble dans le cadre d’une province pour mener
à bien une telle opération. Alors, bon travail à
tous ! La catéchèse nécessite organisation, documents, acteurs, politique pastorale. Mais elle a surtout besoin d’être traversée par une passion, celle d’annoncer le Christ, de conduire à lui, de le faire découvrir afin que se forme en chacun cette profession de foi qui faisait dire à l’apôtre Pierre : « À qui irions-nous, Seigneur ? C’est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » (Jn 6, 68) Merci à tous ceux et celles qui œuvrent dans ce grand champ de la catéchèse et qui partagent avec nous cette passion du Christ et de son Évangile.
« L’eucharistie comme
source
Vivant dans un environnement où le dimanche
s’est effacé devant le week-end et où la participation
à la messe reste fort tributaire du rythme de vie, de l’envie
ou du besoin qu’on en a, il est important de faire redécouvrir,
et à certains tout simplement découvrir, l’importance
de l’eucharistie dominicale. Dans son homélie, lors
de la messe de clôture des vingtièmes Journées
mondiales de la jeunesse, à Marienfeld, le 21 août
dernier, le pape Benoît XVI s’adressait ainsi aux
jeunes : De son côté, dans sa proposition n° 30, le synode souligne combien cette nécessité du rassemblement dominical concerne tout à la fois le baptisé, le Christ et l’Église. L’eucharistie est vitale pour le baptisé. Elle est pour lui une rencontre avec le Christ ressuscité qui vient vers lui et lui offre sa vie : « Je suis le pain vivant qui descend du ciel, dit Jésus, celui qui mangera de ce pain vivra pour l’éternité. » (Jn 6, 51) Elle est nécessaire aussi pour le Christ qui, dans la célébration de l’eucharistie, rassemble son peuple et en fait son Corps dans le monde. En étant unis au sacrifice du Christ, nous devenons les membres de son Corps et ses témoins dans notre vie quotidienne. On comprend que la Didascalie des Apôtres demande « que personne ne diminue l’Église en n’allant pas à l’assemblée et ne prive d’un membre le corps du Christ. » (59, 1) L’eucharistie est nécessaire enfin pour l’Église. Car c’est l’eucharistie qui la fait Église, c’est-à-dire Corps du Christ, communauté fraternelle qui se reçoit sans cesse de Dieu et qui est appelée à témoigner de son amour dans le monde. Cette nécessité du rassemblement eucharistique était une conviction forte des chrétiens des premiers siècles. En 304, l’empereur Dioclétien interdit aux chrétiens de se réunir le dimanche pour célébrer l’eucharistie. Arrêtés à Abitène, petite localité de la Tunisie actuelle, et conduits à Carthage, des chrétiens répondirent au proconsul qui les interrogeait et qui devait les condamner à mort : « Sans le dimanche nous ne pouvons pas vivre. » Il nous faut méditer cette réponse, vivre intensément cette foi eucharistique et la partager avec conviction. Rassemblement dominical et foi dans la présence du Ressuscité sont profondément liés. Oui, au cœur de l’évangélisation aujourd’hui doit retentir cette invitation que nous lançons dans chacune de nos célébrations eucharistiques : « Heureux les invités au repas du Seigneur ! » 2. Développer une pédagogie qui introduise au sens du mystère eucharistique Dans le récit des disciples d’Emmaüs, saint Luc nous dit : « Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent. » (Lc 24, 30-31) Cette ouverture des yeux n’est pas de l’ordre du simple regard, du constat ou de la pure observation. Elle est de l’ordre de la foi : les disciples s’ouvrent à la présence mystérieuse du Ressuscité, comprennent la signification de son sacrifice, de cette vie donnée, livrée par amour pour le salut de la multitude. Cette perception les transforme et c’est dans la joie qu’ils vont retourner à Jérusalem pour partager leur expérience avec les autres disciples. Il est important aujourd’hui d’aider à cette ouverture des yeux de la foi qui, à travers des gestes, des paroles, des rites, des chants, de la musique et du silence, permet de percevoir dans la célébration la présence du Ressuscité et de s’émerveiller du don de son amour. Cela implique une catéchèse mystagogique mais appelle aussi une qualité de célébration qui cultive le regard intérieur, la simplicité, l’invitation à l’écoute, à l’accueil d’un autre, à la joie, à l’adoration et à l’admiration devant le don qui nous est fait (cf. Jean-Paul II, Lettre apostolique Reste avec nous, Seigneur, n° 17 et n° 18). Tout dans la célébration doit conduire à cette rencontre avec le Seigneur. Nous devons en particulier soigner la beauté des célébrations, non par esthétisme mais par conviction que la beauté échappe à l’organisation et au discours et peut acheminer vers Dieu. « La beauté, disait Jean-Paul II, est la clef du mystère et elle renvoie à la transcendance. » (Lettre aux Artistes, n° 16) C’est elle qui peut nous révéler la vraie beauté, celle qui rayonne du visage du Christ transfiguré. 3. Rappeler la dimension sociale de l’eucharistie La célébration eucharistique ne saurait être une parenthèse dans notre vie. Elle doit, au contraire, être un tremplin pour vivre avec plus de force encore au sein de notre vie quotidienne cet amour qui nous est gratuitement donné. On ne peut communier au Christ sans communier à sa passion pour les foules (cf. Mt 9, 35-38), à sa compassion pour ceux qui souffrent, à son action pour remettre l’homme debout après l’avoir recréé intérieurement par la guérison ou le pardon. Il en va, dit Jean-Paul II, de l’authenticité de la participation à l’eucharistie (cf. Jean-Paul II, Lettre apostolique Reste avec nous Seigneur, n° 28). C’est dans l’amour du Christ communiqué dans l’eucharistie que la bienheureuse Mère Teresa de Calcutta trouvait une source intarissable de partage à l’égard des mourants les plus misérables et abandonnés. Le synode souligne dans sa proposition 48
combien la dynamique eucharistique de don et de partage doit nous
rendre particulièrement attentifs au respect de la justice,
de la paix, de la sauvegarde des droits de l’homme et de
la création. Se réunir chaque dimanche, pour prendre
part au même Corps et au même Sang du Christ, impose
le devoir d’une lutte tenace contre toutes les forces de
marginalisation et d’injustice économique, sociale
et politique que subissent bien des hommes. Ceci nous invite à
une particulière vigilance. |
|||||
| La lettre d'infos |
| Agenda |
| Dialoguer... |
| Le message de l'évèque |
| Dossiers et débat |
| Le centre diocésain de documentation |
| Église de Digne |
| Écrivez-nous | |
| Plan du site | |
| Le site de A à Z | |
| Votre paroisse | |
| Mentions légales |
© 2002 Diocèse catholique de Digne, Riez et Sisteron - Réalisation Sudway Internet