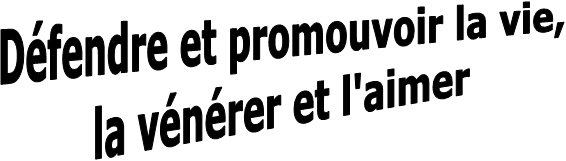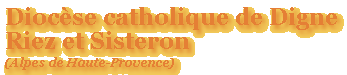
| |
||||
|
|
dialoguer... | |||
le message du vicaire généralaoût 2012 |
||||
|
Vous trouverez dans ce numéro d’ « Eglise de Digne » la déclaration de l’académie catholique de France (1), du 19 juin dernier, sur « la fin de vie » ainsi qu’un texte de Mgr Dagens, évêque d’Angoulême, "pour le respect de la vie humaine de son commencement à sa fin".La déclaration de l’académie sur la fin de vie est motivée par « les débats récents et plusieurs annonces publiques (qui) montrent l’urgente nécessité d’une parole de sagesse, audible, sur la fin de la vie humaine », laquelle est «une question angulaire de la vie sociale».Défendre la vie humaine n’est pas le seul apanage des croyants. «Défendre et promouvoir la vie, la vénérer et l’aimer, c’est là une tâche que Dieu confie à tout homme», nous rappelait le Pape Jean-Paul II dans son encyclique, « l’Evangile de la vie », en 1995 et qu’il serait opportun de lire ou de relire. L’Eglise croit que ce qu’elle dit sur la valeur et l’importance de la vie peut-être entendu et compris par tout homme usant de sa raison, qu’il soit croyant ou non. Dans notre société sécularisée il nous faut nous placer sur le terrain de la raison et de la sagesse philosophique, la seule qui puisse prétendre être reçue par tous. C’est ce que fait la déclaration de l’académie catholique : «C’est donc pour des motifs puisés dans la raison et la sagesse que la société doit préserver, à même sa législation, le sens transcendant de la vie. C’est en effet devant un choix de civilisation que nous sommes placés». C’est cette posture que décrivait le cardinal Ratzinger en l’an 2000 : «il est important que nous ne vivions pas seulement à l’intérieur de nos certitudes et de nos identités mais que nous nous exposions réellement aux questions des autres. C’est avec cette disponibilité et cette franchise que, dans la rencontre, nous essayons de faire comprendre ce qui nous semble à nous raisonnable ou, mieux encore nécessaire pour l’homme».L’interdit de porter atteinte à la vie est un interdit fondateur. C’est par son respect que la vie en société fût rendue possible et c’est aussi une condition de survie de l’humanité. L’autre je ne le choisis pas. Il s’ « impose » à moi. Ce n’est pas à moi de décider s’il est digne ou non de vivre. La dignité, d’ailleurs, elle ne se perd jamais. C’est une réalité qui appartient à l’être même de l’homme. Nous sommes dignes de par notre appartenance à l’humanité. La dignité ne dépend ni de l’état physique, ni de l’état mental de la personne, ni de sa situation économique ou sociale, ni de son niveau culturel. Cette dignité est fondamentalement inaliénable. La dignité est une réalité morale qui qualifie l’être humain et implique des devoirs à son égard. Le premier étant le respect inconditionnel de sa vie !Refuser de porter atteinte à la vie d’autrui ne nous condamne pas pour autant à rester indifférents ou impuissants face à sa souffrance. Quand il n’y a plus rien à faire pour guérir, tout reste à faire pour continuer à prendre soin de la personne; notamment l’empêcher de souffrir. L’Eglise s’oppose tout autant à l’obstination déraisonnable (acharnement thérapeutique) qu’à l’euthanasie ! C’est le chemin proposé par les soins palliatifs. Là où ils sont réellement mis en œuvre, les demandes d’euthanasie reculent. Ils ajoutent aux soins traditionnels du corps les soins permettant de traiter la douleur, d’apaiser les peurs, de restaurer, si besoin est, l’estime et la dignité de soi. Ils prennent en compte la personne et ses besoins dans sa globalité : besoins corporels, psychologiques, moraux, spirituels. Selon la Société Française d’accompagnement et de soins palliatifs ils considèrent le malade comme un être vivant et sa mort comme un processus normal. Ils ne hâtent ni ne retardent le décès. Leur but est de préserver la meilleure qualité possible de vie jusqu’à la mort.Voilà ce qu’il nous faut défendre et promouvoir dans les débats actuels touchant la vie humaine. Personnellement, en ces domaines, je m’inspire beaucoup de ce que j’ai entendu un jour dans une conférence publique du cardinal Louis-Marie Billé, archevêque de Lyon : «Les positions que prend l’Eglise dans un certain nombre de domaines touchant la vie, l’amour ou la mort, paraissent à ce point en décalage par rapport à l’opinion majoritaire que des chrétiens seraient tentés de réagir sur le mode : «Si seulement l’Eglise cessait de prêcher la morale, on pourrait enfin annoncer l’Evangile». Mais ce n’est évidemment pas si simple. Comment les disciples du Fils de Dieu fait homme se désintéresseraient-ils de l’homme, de sa vie, de son avenir ? Comment ne se préoccuperaient-ils pas de l’humanité de l’homme, de sa manière de se comporter on non en être humain ?... Nous n’avons certes pas à faire comme si en tout domaine il nous fallait forcément prendre le contre-pied de notre société. Mais il y a des moments où il faut savoir dire : «Attention…» Proposer la Foi en France au XXIème siècle implique que devant certains comportements, certaines opinions, certaines législations, on sache dire : «Attention…» Cela n’exclut ni la patience, ni le temps de l’accompagnement, ni le respect dû au cheminement de la conscience, cela exclut encore moins la miséricorde, mais cela appelle la clarté, la liberté intérieure, la charité pastorale, le sens vrai des personnes».Père Christophe Disdier-Chave, vicaire général(1) Cette académie a été fondée en 2008 « sur la base d’un constat et d’une exigence qui concernent la place et la reconnaissance dans l’espace public, de la production intellectuelle attachée au christianisme, au catholicisme en particulier ». Sa mission est de « représenter l’excellence disciplinaire dans une instance de conviction catholique. Elle réalise une jonction entre un exercice de rationalité et une détermination croyante, entre « critique » et « conviction ». Elle souhaite « faire avancer la réflexion sur des thèmes choisis, d’actualité intellectuelle ou sociale ». |
||||
|
|
||||
© 2002 Diocèse catholique de Digne, Riez et Sisteron - Réalisation Sudway Internet