VOIR LES BILLETS SPIRITUELS DU PERE THIERRY CAZES
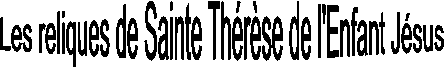
par Mgr Bernard Lagoutte, Recteur de la Basilique de Lisieux
La source du mouvement de vénération des reliques de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte Face a commencé au cimetière de Lisieux peu de temps après sa mort, le 30 septembre 1897. Au Carmel, après le décès des sœurs, une notice nécrologique était rédigée et envoyée aux Amis du monastère. Celle de Thérèse de l'Enfant-Jésus fut composée à partir des trois manuscrits autobiographiques qu'elle avait rédigés par obéissance. Son succès entraîna la première édition de ‘‘l'Histoire d'une âme’’, parue le 30 septembre 1898, à 2000 exemplaires, suivie d'une seconde édition en mai 1899 ; 6000 exemplaires en 1900. Les traductions suivirent, d'abord en anglais, en 1901, puis dans les quatre années suivantes, en huit langues. Très vite, les lecteurs de ‘‘l'Histoire d'une âme’’ viennent à Lisieux en pèlerinage sur la tombe de Thérèse. Ils écrivent au Carmel pour demander des reliques. Le mouvement va grandissant : un cortège de pèlerins ne cesse de se déplacer chaque jour, montant depuis la gare avec un relais continuel de fiacres vers la tombe, jusque sur les hauteurs de la ville. Des miracles y ont lieu, dont la guérison, le 26 mai 1908, d'une petite fille aveugle, âgée de 4 ans, Reine Fouquet, d'un milieu modeste, que sa mère était allée porter, la veille, sur la tombe. Ce miracle fait beaucoup de bruit. Les pèlerinages sur la tombe sont alors de plus en plus nombreux ; on y prie les bras en croix, on y laisse des lettres, des photographies ; on apporte des fleurs, on dépose des ex-votos : béquilles, cannes, appareils en tous genres (cf. Guide du pèlerin, Descouvemont, p. 44), on allume des cierges... De grands pèlerinages s'organisent. Le corps de Thérèse est exhumé au cimetière de Lisieux le 6 septembre 1910, en présence de l'évêque et de quelques centaines de personnes. Les restes sont déposés dans un cercueil de plomb et transférés dans un autre caveau. Une deuxième exhumation a lieu les 9-10 août 1917. Le 26 mars 1923, a lieu la translation solennelle du cercueil depuis le cimetière jusqu'à la chapelle du Carmel. La béatification de Thérèse aura lieu à Rome le 29 avril 1923. La canonisation a lieu à Rome le 17 mai 1925. A Lisieux, le 30 septembre 1925, le légat du Pape, le cardinal Vico, vient s'agenouiller devant la châsse entrouverte où repose le corps de Thérèse, pour y déposer une rose d'or dans la main du gisant, réalisé en 1920 par le moine Marie-Bernard, de la Trappe de Soligny. Mais comment expliquer cet "ouragan de gloire" qui, en un quart de siècle, fait connaître au monde entier cette jeune fille morte à 24 ans et 8 mois ?
Les reliques de Sainte Thérèse à travers le monde.
Partout, avec des manifestations diverses, à travers le reliquaire, c'est Thérèse qui est accueillie. Des milliers de kilomètres sont parcourus. Que cherchent-elles ces foules qui viennent de partout, non seulement catholiques, mais aussi venant de diverses Églises chrétiennes, de personnes appartenant à diverses religions (notamment l'Islam) ? Qui cherchent-elles ? "L'outil marketing médiatique" (comme le nomme un professionnel du tourisme) est pourtant bien pauvre, malgré la beauté du coffret offert par le Brésil et sa coque protectrice en plexiglas. Les foules manifestent un enthousiasme bon enfant mais n'ont pas une attitude magique. Elles touchent le reliquaire, le fêtent tantôt dans un recueillement silencieux, tantôt avec les signes de la fête, la joie, les fleurs, les applaudissements, les feux d'artifice, les chants, les orchestres, mais elles manifestent surtout prière, vénération, émotion. Elles viennent participer à l'Eucharistie, à la louange. Elles accomplissent les démarches pénitentielles, reçoivent le sacrement de la Réconciliation, vivent de longs moments de prière ... Elles cherchent à connaître Thérèse, à lire ses œuvres, à se procurer des images et des médailles qui la représentent. La vénération des reliques est certainement une expérience du croyant devant le sacré (une musulmane au Liban : " c'est une bénédiction de Dieu "). Elle établit une communication avec Dieu. L'important est donc d'éclairer ce qu'elles signifient.
Pour une catéchèse des reliques, où plutôt une annonce de l'Evangile autour des reliques.
Les reliques nous renvoient à Thérèse. Chercher à comprendre Thérèse, c'est se mettre à l'écoute de la façon dont elle a vécu la foi. Sa vie est un témoignage, son message est éclairant, ses attitudes sont libérantes, son discernement est plein d'équilibre. Mais en vénérant les reliques, le pèlerin ne vient pas seulement "se rappeler", il vient rencontrer Thérèse elle-même. Il dit vivre avec elle une expérience personnelle, unique, décisive souvent pour sa vie. D'une certaine manière le passé de Thérèse ne l'intéresse que parce qu'elle est là "dans le présent", dans l'aujourd'hui, et que cette présence figure ce que le pèlerin sera demain. C'est pourquoi une catéchèse avant, pendant et après le passage des reliques est indispensable, car la passion de Thérèse est de faire aimer Jésus. L'actualité de Thérèse crée un espace qui nous met devant le sens de notre propre actualité: elle ouvre sur la présence du Ressuscité aujourd'hui. Thérèse ne peut être comprise qu'en se mettant avec elle à l'école de Jésus.
Le point de départ de la catéchèse est de poser la question du "sens" des reliques.
Éviter deux risques « in-sensés »
D'abord le parti-pris "rationaliste" : la vénération des reliques est une conduite archaïque, qui a conduit dans l'histoire des religions, à des absurdités (cf. le livre de Calvin). Les centres de pèlerinage se sont bagarrés pour avoir les reliques, ils en ont créés, ils en ont fait le commerce, etc ... L'homme, écrasé par sa condition, par la peur de la souffrance et de la mort, a besoin de protester contre ce qui l'écrase. Il se réfugie dans des conduites magiques, qui le protègent et lui permettent de vivre. La science aujourd'hui éclaire sur toutes ces attitudes qui sont produites par la puissance de l'inconscient. Beaucoup de phénomènes merveilleux qui se sont déroulés dans le passé, ont trouvé des explications scientifiques. Ceux qui ne sont pas expliqués aujourd'hui le seront demain. Ce parti-pris, au point de départ, refuse de considérer les faits en eux-mêmes. A priori, il voit dans les reliques supercherie naïveté, exploitation, faiblesse de l'esprit humain. L'attitude opposée est de faire abstraction de tout esprit critique. "Les reliques, ça marche", c'est un "talisman" qui protège; le surnaturel est vu comme une force radioactive, qui, sans qu'on la voit, agit. Faire un certain nombre de démarches, ne pas en rater, et le résultat suit. Les médailles, le reliquaire, les prières en sont les passages obligés. Pour être plus sûr, il faut y joindre saint Benoît ou quelques autres thaumaturges patentés. L'histoire concrète de Thérèse, son idéal aujourd'hui sont bien loin.
Entre les deux, il y a pourtant un chemin « sensé» (plein de sens)
C'est celui de l'itinéraire spirituel: proposer le témoignage de Thérèse, les différentes étapes de sa vie, les questions, les découvertes, les sources, le sens qu'elle a donné à sa vie. C'est la proposition de la foi. Thérèse n'enseigne pas, ne développe pas des concepts; elle vit une expérience spirituelle (elle n'en parle que pour répondre à des demandes qui lui sont imposées: Ms A et C, ou suggérées: Ms B). Elle n'écrit pas pour avoir des disciples, mais elle pense que son chemin peut aider "beaucoup d'âmes" à trouver le leur. Ce que Thérèse nous apporte est moins une pensée théologique en elle-même que de nous offrir les moyens de traduire ce que nous vivons dans une expérience spirituelle. Le dernier texte qu'elle a écrit (au dos d'une image, le 25 août 1897) la résume: "Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit... Je l'aime ! ... car Il n'est qu'Amour et Miséricorde!". Quand on interroge les pèlerins, c'est le cœur de ce message qui les touche, quels que soient leur âge, leur culture, leur pays et même leur religion. "Dieu Amour" est à la base de tout, même lorsque "la nuit de la foi" peut envahir la conscience du croyant. Parler d'expérience spirituelle, c'est parler de vie "selon l'Esprit". Celui qui a agi dans la vie concrète de Thérèse, dans sa personne, Celui-là se donne à nous, quand nous nous ouvrons à Sa présence, en réponse à l'appel que provoque en nous la vénération des reliques. La rencontre de Thérèse nous rend possible, si nous le voulons, la rencontre de Celui qui a été l'Amour de sa vie. Les manifestations autour des reliques surprennent, elles semblent appartenir à la "religion populaire" (pourquoi cette expression est-elle affectée d'un cœfficient restrictif ?). La religion du "peuple de Dieu" ne fait-elle pas partie de cette "théologie en action" qu'aime le Pape Jean-Paul II ? C'est-à-dire qu'elle est "langage sur Dieu, sur le rapport entre Dieu et l'homme. La liturgie ouvre bien à cette catéchèse car elle est un chemin symbolique, parlant à tous les sens, et pas seulement à l'intellect. Dans tout ce qui est organisé autour des reliques, la liturgie est un temps fort, centré sur les sacrements de l'Église du Christ, avec la Parole de Dieu, et les sacrements (baptisés, confirmés, réconciliés, eucharistiés ... ). Elle produit dans le cœur ce que Paul appelle les signes de l'Esprit: paix, joie, réconfort, réconciliation, capacité de porter l'épreuve". Dans les différents pays où sont passées les reliques, il y a un même constat: les mouvements de conversion (la "metanoïa"), c'est-à-dire dépassement de ce qu'on est, de ce qu'on pense, de ce qu'on vit, vers une confiance, non plus fondée sur la seule raison humaine, mais sur ce en quoi la raison se fonde (le sens donné par la foi à notre véritable aventure humaine). C'est l'ouverture à une expérience personnelle de la transcendance (hors des seules possibilités humaines), qui surgit dans le concret de l'existence (l'immanence) : le Ressuscité, qui a été au cœur de la vie de Thérèse, est au cœur de la vie du croyant.
Les lieux de pèlerinage sont souvent les catalyseurs qui permettent cette expérience. Tout cela était dans ma vie, mais les signes deviennent parlants. "Tu nous as fait pour Toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en Toi". A Lisieux, les différents lieux thérésiens (les Buissonnets, la Cathédrale Saint-Pierre, le Carmel, la Basilique) sont souvent les vecteurs de ces moments-là. Il est possible "d'expérimenter" les signes (les sacrements) de la foi et de rencontrer, à travers Thérèse, Celui qui a été au cœur de sa vie.
Thérèse, Docteur de l'Église, nous offre toute une palette de moyens pour développer cette catéchèse :
- la place qu'elle donne aux sacrements
- la Parole de Dieu, dont elle a une approche exceptionnelle.
- le sens de sa vocation dans l'Église.
- les faits de sa vie qui témoignent de son lien avec le Ressuscité
- sa vie simple et cachée ...
Faire venir les reliques dans un pays suppose :
- une action en amont: présenter la vie, le message et la symbolique que développe Thérèse.
- une catéchèse adaptée, au moment où "Thérèse" est là : célébrations collectives, temps de prière, de vénération, contacts individuels (dialogue, sacrement de la réconciliation, etc...).
- une action en aval pour poursuivre ce qui a été fait et être attentif à ce qui pousse, après le temps des semailles.
Le grand "acteur", c'est l'Esprit Saint, c'est lui qui fait qu'une vie prend sa couleur spirituelle.
(Ainsi les reliques, temps fort de souvenir, ouvrent à un avenir).