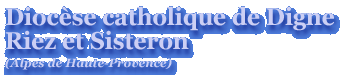Cette évocation des seize premières
années de la vie de Marie Silve exprime une conviction
qui, en 2006, se traduit dans un devoir de mémoire
de la part des habitants de Saint-Pons, de la vallée
de Seyne-les-Alpes et du département des Alpes-de-Haute-Provence
et du diocèse de Digne. Le rayonnement ultérieur
de Marie Silve n’aura pas aboli cet enracinement local
et familial même si son désir de discrétion
aura fait que, même à Saint-Pons ou à
Seyne-les-Alpes, Marie Silve aura justifié cette appellation
qui sera le titre d’un article de Jean Guitton paru
dans la presse nationale après le décès
de Marie Silve : « Une femme inconnue », dont
l’académicien parle avec admiration.
Le sens d’une adresse postale.
Lorsque, en 1936 ou encore en 1966, les membres du mouvement
instauré en 1916 à partir d’une école
de Fours puis de Notre-Dame du Laus, voudront rejoindre le
lieu d’origine de la pensée qui s’exprime
dans les publications « aux Davidées »
ou « École et pensée moderne »,
ils auront comme interlocutrice et comme adresse : «
Melle Silve à Saint-Pons, par Seyne les Alpes –
Basses Alpes ». Le mouvement créé
en 1916 n’a pas de « présidente »
(discrétion oblige !) mais le rôle de la «
correspondante » n’en est que plus important.
Marie Silve est donc retournée à
son pays natal assez vite. Depuis Saint-Laurent de Fours,
d’où elle a élargi en peu de temps l’horizon
de ses projets, elle rêve d’exercer sa fonction
d’institutrice dans son pays natal. Dès 1917
ce souhait apparaît dans la correspondance avec son
frère mobilisé sur le front de l’Est.
Dans le cadre de la commémoration d’un quatre-vingt-dixième
anniversaire, les propos des habitants actuels de Saint-Pons
de Seyne-les-Alpes disant : « J’ai été
son élève pendant quatre ans…cinq ans »,
prennent un relief particulier.
Les traditions familiales et les exigences
de l’enseignement public.
Si l’évocation de l’enfance est à
souligner, c’est parce que c’est dans la famille
et le pays de l’enfance et, en l’occurrence, dans
la paroisse, que l’on reçoit une tradition morale
et religieuse. Or entre 1894 et 1910 la séparation
de l’Église et de l’État, le 9 décembre
1905, a interpellé, entre autres effets, les convictions
religieuses.
Les premiers mots de la loi étant «
La république garantit la liberté de conscience »,
voilà que les chrétiens de paroisses très
pratiquantes, pour qui la foi chrétienne allait de
soi, s’entendent dire qu’il y a une liberté
de croire et la liberté de ne pas croire. Or, au moment
où, à l’âge de seize ans Marie Silve
entre à l’école normale il y a déjà
vingt-sept ans que Jules Ferry a défini la laïcité
de l’école : « La loi du 28 mars se caractérise
par deux dispositions qui se complètent sans se contredire
: d’une part, elle met en dehors du programme obligatoire
l’enseignement de tout dogme particulier, d’autre
part elle y place au premier rang l’enseignement moral
et civique. L’instruction religieuse appartient aux
familles et à l’église, l’instruction
morale à l’école ». À
partir de ce texte nous pouvons mieux apprécier l’importance
et la difficulté du projet de Marie Silve.
2/ 1910-1913. À l’école
normale : les défis à relever se précisent.
Malgré le fait que quelques anciennes
normaliennes aient abandonné toute pratique religieuse
dès la sortie de l’école, Marie Silve
entre à l’école normale sans trop d’appréhension.
En fait, c’est une réalité
positive qui va lui faire se poser quelques questions fort
préoccupantes : Marie Silve admire la directrice de
l’école. Elle se souvient : « Sa parole
très simple mais ‘inspirée’ nous
saisissait toujours, nous faisait vivre un idéal d’où
s’effaçaient les intérêts personnels.
Elle nous donnait vraiment le désir du don total de
nous-mêmes…. Son enseignement nous encourageait
à retenir le souci constant de former en nous des habitudes
de vie morale et de progrès spirituel… »
En résumé, la directrice de l’école
normale donnait raison à Jules Ferry (invitant à
dissocier la morale de la foi) et Marie Silve reconnaît
:« Une certaine indifférence nous gagnait, sans
trouble et sans inquiétude. Mais en troisième
année, avec l’influence plus profonde de notre
directrice dans des cours de pédagogie, M. B et moi
tout particulièrement, ne pouvions nous empêcher
de remettre en question la foi de nos familles…. Cette
religion, transmise par nos familles est-elle la vérité
puisque notre directrice qui a tant de valeur morale, paraît
s’en passer complètement ?… Cependant,
nous ne pouvions nous résoudre à désespérer
nos familles, bien que nous ayons perdu le sentiment de notre
foi. » (Marie Silve, Les Davidées,
page 46). Mais elle ajoute plus loin : « Ce qui nous
avait été si souvent et si fortement inculqué
sur le respect des droits de la raison et de son autonomie,
nous paraissait pleinement d’accord avec la doctrine
de l’Église sur la liberté de l’acte
de foi : la vérité ne peut être imposée
à la raison malgré elle et doit être librement
acceptée. »
3/ 1913-1916 : Un tournant dans
la vie de Marie Silve,
au détour d’une lecture
En octobre 1913, Marie Silve arrive à
Fours. Quelques lignes tirées du témoignage
que, non sans peine, l’académicien Jean Guitton
obtiendra d’elle en 1966, nous décrivent le contexte
dans lequel les questions posées précédemment
vont susciter des projets concrets et recueillir l’adhésion
de nombreuses institutrices, avec, comme étape décisive,
la retraite à Notre-Dame du Laus en septembre 1916.
Voici donc, de manière résumée par nécessité,
quelques aspects essentiels de cette période décisive
de la vie de Marie Silve. Les citations textuelles sont donc
tirées du témoignage écrit de Marie Silve.
La situation des quatre institutrices
du vallon de Fours :
« Dans ces postes à la population affable mais
isolée, à mille sept cents mètres d’altitude,
rude et déshéritée, où les jeunes
institutrices avant nous ne faisaient que passer, demandant
des congés, parfois pour fatigues nerveuses, nous devions
vivre toutes les années de guerre. »
Une autre phrase complète ce qui précède
et indique l’état d’esprit de Marie Silve
:
« La providence continuait à veiller sur nous.
Dès les premiers jours de la guerre, un ordre formel
nous enjoignait de passer nos vacances au milieu des populations
afin de les encourager et de les aider. »
Vie communautaire :
« En dehors de la garde des petits enfants, nous vivions
en communauté, au petit chef-lieu de la commune, dans
mon école, la plus grande et au centre du vallon. »
Ces circonstances très particulières vont donc
favoriser des échanges très fructueux d’opinions
puis de projets concrets auxquels la personnalité de
Marie Silve va donner une suite.
L’abbé Signoret et sa
bibliothèque
« Nommé avant le 15 août (1914 ou 1915
?) l’abbé Signoret nous prêta l’Histoire
d’une âme de sainte Thérèse,
dont le style nous déçut un peu ; des études
très encourageantes sur le renouveau catholique dans
les grandes écoles ; quelques romans et le livre de
Bazin : Davidée Birot. »
On devine que le nom donné par Marie
Silve au groupe des institutrices chrétiennes de l’enseignement
public « Les Davidées » a quelque
rapport avec le roman de René Bazin. C’est ce
qu’il faut préciser.
Lorsque la fiction littéraire
devient l’inspiratrice d’un grand projet.
Lorsque Marie Silve lit une première fois, puis relit
crayon en main le roman de René Bazin, elle le fait
avec l’état d’esprit qu’Emmanuel
Mounier discernera plus tard :
« Ce que trouvèrent ces lectrices dans l’ouvrage
de Bazin, ce fut, au premier contact, un peu de leur histoire,
de leurs besoins, de leur problème. » C’est
ce que Marie Silve souligne de son côté : «
N’importe qui pouvait admirer dans le livre de René
Bazin un très beau caractère d’institutrice.
C’est sans doute la raison pour laquelle cet ouvrage
se trouvait alors dans beaucoup de bibliothèques pédagogiques. »
« Davidée nous invitait à
une patience vigilante, aimante, confiante, excitante pour
les enfants. On la devine, cherchant à tout voir, tout
savoir, à tout redonner dans l’amour. »
« Davidée Birot était vraiment la sœur
de notre âme par son amour des enfants et de la vérité.
Elle ne nous a pas fait retrouver la foi, qui est un don de
Dieu, elle nous a conduites vers la recherche des raisons
de croire. »
La correspondance en attendant le «
bulletin de liaison ».
En 1916, dans le contexte tragique de la bataille de Verdun,
Marie Silve signale : « Une correspondance volumineuse
et fréquente s’établissait d’une
école à l’autre à travers le département. »
Nous remarquons ainsi que les questions et
projets qui ont été d’abord problème
de conscience de Marie Silve, puis sujet d’échange
entre institutrices du vallon de Fours, devenaient pour beaucoup,
une communauté de pensée. À celle-ci
il fallait offrir l’occasion d’un temps fort en
vue d’une prise de conscience plus précise des
enjeux de ce soutien mutuel. Ce sera chose faite en septembre.
Septembre 1916 : La rencontre dont
le quatre-vingt-dixième anniversaire se célèbre
en 2006
Marie Silve en indique le projet : « Le désir
d’une réunion plus complète pour nous
entretenir du projet d’un petit bulletin de liaison,
le désir bien vif aussi de vivre quelques journées
de prière, nous amenèrent au Laus en septembre
1916. »
Un imprévu les y attendait sous la forme
d’un groupe de la Drôme qui, vérification
faite, était venu à Notre-Dame du Laus avec
les mêmes intentions et qui était conduit par
Melle Thivolle, directrice honoraire du cours complémentaire
de Crest qui avait demandé la prédication d’une
retraite pour une dizaine de ses anciennes élèves.
Melle Thivolle était très écoutée
par Marie Silve (qui en rapporte les propos) et par les institutrices
bas-alpines et en retour elle entra avec détermination
dans la perspective du bulletin de liaison.
En rapportant, plus tard, le souvenir de cette
première retraite, Marie Silve anticipe sur notre chronologie
en ajoutant :
« Les deux retraites suivantes ressemblèrent
à la première avec cette différence qu’en
1918 Mlle Thivolle, très fatiguée (elle devait
mourir le 2 octobre) nous entretint peu souvent et peu longuement….. »…
« Que de belles et bonnes retraites ont suivi celle-la
réunissant de nombreuses amies venues de toutes les
provinces de France ! Que de grâces d’illumination
et de force versées dans nos humbles et grandes vies
! »
Décembre 1916 – Le premier
bulletin
Il sera encore question du bulletin plus loin lorsque cette
publication deviendra sujet de débat…jusqu’à
la Chambre des députés.
Mais ici il faut bien situer dans la chronologie sa création
; pour cela nous ne pouvons faire mieux que citer Marie Silve
puis René Bazin admiratif.
Marie Silve :
« La premier bulletin parut donc en décembre
1916. Il eût assez vite (après les quatre pages
du projet initial) douze, puis vingt et quarante pages.
En 1925, il comptait déjà plus de deux mille
cinq cents abonnés. Mais au début, nous ne pouvions
prévoir un mouvement national, c’est pourquoi
nous l’avons intitulé Aux Davidées.
Ce titre signifiait que nos pages s’adressaient, en
même temps qu’aux catholiques, aux intelligences
inquiètes comme Davidée Birot et adonnées
comme elle à la recherche de la vérité.
Ce nom fit fortune. Il s’est d’abord appliqué
à un petit groupe des Basses-Alpes, puis à toute
institutrice allant à la messe, puis à tout
professeur catholique de l’enseignement public. De nom
propre, il était devenu nom commun, puis indifféremment
féminin et masculin. Déjà, il commençait
à désigner les universitaires qui, sans être
catholiques, avaient des croyances spiritualistes. »
René Bazin à son sujet :
Marie Silve raconte : « Il reçut les deux premiers
numéros et nous écrivit : 'J’ai été
surpris autant qu’ému en recevant votre lettre
et les numéros du bulletin. Lorsque j’ai écrit
Davidée Birot j’ai voulu rendre hommage
à tant de jeunes filles et de jeunes femmes qui, élevées
plus ou moins en dehors de l’idée religieuse
et la connaissant mal, y aspirent cependant par la bonne volonté
qui est en elles… »
4/ 1917-1926 : Développement,
suspicions, louanges et critiques
Le bulletin suscite des réactions
négatives
Ce fut le cas dès le départ, c’est-à-dire
à propos de la première forme de cette publication,
à savoir « quatre pages polycopiées pour
se dire bonjour ».
Marie Silve note : « Ce furent les temps héroïques,
car les chefs mirent tout en œuvre pour arrêter.
Malgré les foudres disciplinaires que l’on brandissait
au-dessus de leur tête, nulle ne fléchit et,
parce que le mouvement répondait à un besoin
profond des êtres, il se répandait avec une rapidité
extraordinaire. On ne peut révoquer des centaines d’institutrices. »
(N.B. : En rappelant ces souvenirs Marie Silve cite une ancienne
Davidée, devenu Carmélite en Corée du
Sud).
Entre deux thèses contradictoires,
que faire ?
De quoi s’agit-il ? De deux genres de discours : celui
de l’État et celui de l’Église ;
dans les deux cas on dit aux Davidées :« ‘Vous
n’êtes pas à votre place. »
L’État, par la voix des inspecteurs
ou des directeurs, disait alors :« ‘Vous avez
accepté le contrat de la laïcité. Ce contrat
vous permet de garder votre religion intérieure, vos
pratiques personnelles. Mais il ne vous permet pas d’être
prosélytes d’une religion, encore moins de vous
associer visiblement, d’avoir des réunions, un
bulletin... »
Or certains représentants de l’Église
aboutissaient à la même conclusion (« Vous
n’êtes pas à votre place. »)
à partir d’arguments opposés : «
L’Eglise n’admet en thèse, en principe,
en idéal et en droit qu’une école qui
est l’école pleinement catholique. L’école
neutre, même la meilleure est insuffisante...vous n’êtes
pas à votre place…. Vous privez l’école
chrétienne de votre concours… venez chez nous,
douces brebis égarées. »
Cependant à propos de l’Église
catholique, il faut noter que les neveux de Marie Silve conservent
le cadre qui représente Pie XI, déclarant le
6 décembre 1922 :
« À nos très chères filles, les
institutrices ‘Davidées’ que groupe le
but, aussi noble et saint que bienfaisant, de développer
leur connaissance de la religion, leur fidélité
à la pratique, leur piété et leur zèle
professionnel. De tout cœur, nous accordons la Bénédiction
Apostolique. » Pius ppXI’’
1926. Jean Guitton : première
(mais pas la dernière) rencontre avec les Davidées.
Avant de recevoir la lettre de Marie Silve qui le priait de
venir au Laus pour la session de septembre 1926, Jean Guitton
avait entendu parler des Davidées par René Bazin
et par André Aymard, doyen de la Sorbonne : le premier
lui avait raconté comment le roman Davidée
Birot avait donné naissance à une association
d’institutrices laïques qui avaient pris le nom
de « Davidées ». André Aymard,
doyen de la Sorbonne lui avait dit :
« J’ai passé mes dernières vacances
à Seyne, dans un coin perdu des Alpes. Il y a là
un petit groupe de personnes fort loyales d’ailleurs,
qui tentent de concilier la laïcité et la foi.
Toi qui t’intéresses au catholicisme et à
la laïcité tu dois connaître cette curiosité (!) ».
À propos de Jean Guitton, il faut —
faute de pouvoir détailler — signaler, bien sûr,
son ouvrage Les Davidées dans lequel il a
inclus le témoignage de Marie Silve et la façon
dont il a réalisé son intention de 1926 : «
J’amenai mes amis à faire connaissance avec ce
milieu de vie, persuadé qu’ils feraient comme
moi l’expérience d’une activité
joyeuse, efficace, reposante. Et Jean Guitton cite vingt-deux
noms et un vingt-troisième ; celui qui fut le plus
séduit fut sans doute Emmanuel Mounier dont l'œuvre
fut, d’après lui, fortement influencée
par Marie Silve.
5/ 1928-1976 :
Avec des noms de personnes (Cardinal Saliège, Marceau
Pivert, Edouard Herriot, etc…) et des noms de lieux
: Les Tilleuls à Toulouse, Paris, etc…
N.B : Pour l’histoire de ces quarante ans, la présentation
chronologique permet de souligner la diversité des
événements qui se sont succédés.
Chacun mériterait d’amples développements.
1928. Le cardinal et l’autonomie
des laïcs dans l’Église
Parmi les critiques formulées à l’égard
des Davidées, il y avait celle qu’on pourrait
résumer ainsi : « Vous ne pouvez pas être
vraiment laïques car vous recevez vos directives des
évêques et du Pape. »
Sans doute, Marie Silve bénéficia
des encouragements de l’évêque de Digne,
Mgr Castellan et de l’évêque de Gap, Mgr
Saliège qui, devenu archevêque de Toulouse y
favorisa leur implantation avec la maison des « Tilleuls ».
Ces évêques leur ordonnèrent de demeurer
pleinement indépendantes, totalement laïques,
fidèlement paroissiales, sans aucune obéissance
ni affiliation, afin de pouvoir répondre à leurs
chefs qu’elles ne relevaient que de leur conscience
et de leur foi, tout en entretenant de bonnes relations avec
leur curé, leur évêque et le pape.
Du 3 octobre 1928 : une lettre que
René Bazin adresse à Jean Guitton pour
lui demander de témoigner de la « grandeur singulière
de ces jeunes institutrices de la campagne ». Et
René Bazin insiste : « Notez vos impressions,
leurs paroles, et cette absence de crainte, cette simplicité
redoutable qu’on n’a pas à ce point sans
une grâce et sans une mission. »
7 Juin 1930 : Intervention de M. Marceau
Pivert au congrès de la Ligue de l’enseignement.
Il plaint les Davidées. « Ô pauvres petites
Davidées, rêveuses innocentes, embrigadées
dans une armée d’assassins et de fanatiques... »;
et M. Pivert demande que des dossiers soient constitués
pour écarter de la carrière universitaire «
tous ceux qui participent à l’entreprise d’intolérance
spirituelle ». Marie Silve apprend que le rapport
de M. Pivert fut largement diffusé.
3 juillet 1930. À la chambre
des députés.
Le « rapport Pivert » y provoque une interpellation.
Edouard Herriot intervient : « La laïcité
n’est pas un dogme. Ce n’est pas une anti-religion.
Au nom de cette laïcité, c’est nous qui
devrions intervenir si l’on voulait porter atteinte
à votre liberté de croyance et à votre
liberté de culte. »
Extensions – Développement
en plusieurs directions.
Marie Silve raconte :
Les sessions d’une semaine environ, y compris les retraites,
nous paraissaient trop brèves :