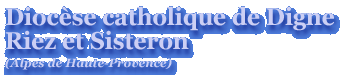|
Jean-Paul II au service
de la Paix
Le 13 janvier 2003, dans son discours de vœux aux ambassadeurs
accrédités près de lui au Vatican, Jean-Paul
II a rappelé sa position de toujours : « Oui
à la Vie ! Non à la guerre ! … La guerre
est toujours une défaite de l'humanité »
« Je suis personnellement impressionné
par le sentiment de peur qui habite souvent le cœur de
nos contemporains. Le terrorisme sournois qui peut frapper
à tout instant et partout ; le problème non
résolu du Moyen-Orient. avec la Terre sainte et l'Irak
(...) . Ce sont autant de fléaux qui menacent la survie
de l'humanité. la sérénité des
personnes et la sécurité des sociétés.
Mais tout peut changer. Cela dépend de chacun de nous.
Chacun peut développer en lui le potentiel de fol de
probité, de.respect d'autrui, de dévouement
au service des autres. Cela dépend aussi, bien évidemment,
des responsables politiques, appelés à servir
le bien commun.
D'abord, un « Oui à la Vie
» !
Respecter la vie et les vies : tout commence là puisque
le plus fondamental des droits humains est bien le droit à
la vie. L'avortement, l'euthanasie ou le clonage humain, par
exemple, risquent de réduire la personne humaine à
un simple objet : la vie et la mort sur commande en quelque
sorte ! Le combat pour la paix est toujours un combat pour
la vie!
Ensuite le respect du droit !
Aujourd'hui les hommes politiques ont à leur disposition
des textes et des institutions d'une grande pertinence. Il
suffit de les mettre en pratique. Le monde serait totalement
différent si l'on commençait par appliquer sincèrement
les accords signés !
Enfin le devoir de solidarité
:
Dans un monde surabondamment informé, mais qui paradoxalement
communique si difficilement et où les conditions d'existence
sont scandaleusement inégales, il est important de
ne rien négliger afin que tous se sentent responsables
de la croissance et du bonheur de tous. (...) Voilà
pourquoi des choix s'imposent pour que l'homme ait encore
un avenir. Pour cela, les peuples de la terre et leurs dirigeants
doivent avoir parfois le courage de dire «non ».
« Non à la mort »
! C'est-à-dire non à tout ce qui attente à
l'incomparable dignité de tous les êtres humains,
à commencer par celle des enfants à naître.
(...) Non à tout ce qui affaiblit la famille, cellule
fondamentale de la société. Non à tout
ce qui détruit chez l'enfant le sens de l'effort, le
respect de soi et de l'autre, le sens du service.
« Non à l'égoïsme
» I C'est-à-dire à tout ce qui pousse
l'homme à se protéger dans le cocon d'une classe
sociale privilégiée ou d'un confort culturel
qui exclut autrui. La façon de vivre de ceux qui jouissent
du bien-être, leur manière de consommer, doivent
être revues à la lumière des répercussions
sur les autres pays. Que l'on songe, par exemple, au problème
de l'eau (…) L'égoïsme, c'est aussi l'indifférence
des nations nanties par rapport aux pays laissés pour
compte. Tous les peuples ont le droit de recevoir une part.
équitable des biens de ce monde et du savoir faire
des pays les plus capables. Comment ne pas penser ici par
exemple, à l'accès de tous aux médicaments
génériques, nécessaire pour soutenir
la lutte contre les pandémies actuelles ?(...)
« Non à la guerre » !
Elle n'est jamais une fatalité. Elle est toujours une
défaite de l'humanité. Le droit international,
le dialogue loyal, la solidarité entre États,
l'exercice si noble de la diplomatie, sont les moyens dignes
de l'homme et des nations pour résoudre leurs différends.
(…) La guerre n'est jamais un moyen comme un autre que
l'on peut choisir d'utiliser pour régler des différends
entre nations. Comme le rappellent la charte de l'Organisation
des Nations unies et le droit international on ne peut s'y
résoudre, même s'il s'agit d'assurer le bien
commun , qu'à la dernière extrémité
et selon les conditions très strictes, sans négliger
les conséquences pour les populations civiles durant
et après les opérations. II est donc possible
de changer le cours des événements dès
lors que prévalent la bonne volonté, la confiance
en l'autre, la mise en œuvre des engagements pris et
la coopération entre partenaires responsables. (…)
Pour éviter de tomber dans le chaos deux exigences
me semblent s'imposer. D'abord retrouver, au sein des États
et entre les États la valeur primordiale de la loi
naturelle, qui a inspiré jadis le droit des gens et
les premiers penseurs du droit international. Même si
certains remettent aujourd'hui en question sa validité,
je suis convaincu que ses principes généraux
et universels sont toujours capables de faire mieux percevoir
l'unité du genre humain et de favoriser le perfectionnement
de la conscience des gouvernants comme des gouvernés.
Ensuite l'action persévérante d'hommes d'état
probes et désintéressés. En effet, l'indispensable
compétence professionnelle des responsables politiques
ne peut être légitimée que par l'attachement
à de fortes convictions éthiques. Comment pourrait-on
prétendre traiter des affaires du monde sans référence
à cet ensemble de principes qui sont à la base
de œ « bien commun universel » dont l'encyclique
"Pacem in terris" du Pape Jean XXIII a si bien parlé
? Il sera toujours possible à un dirigeant logique
avec ses convictions de se refuser à des situations
d'injustice ou à des déviances institutionnelles
ou d'y mettre fin. Nous retrouvons là, je crois, ce
que l'on appelle couramment aujourd'hui la "bonne gouvernance"
(…)
II est évident que, pour un croyant,
s'ajoutent à ces motivations celles que lui donne la
foi en un Dieu créateur et père de tous les
hommes, qui lui confie la gestion de la terre et le devoir
de l'amour fraternel. C'est dire combien l'État a tout
intérêt à veiller à ce que la liberté
religieuse, droit naturel - c'est à dire à la
fois individuel et social -, soit effectivement garantie à
tous.(...) »
|