
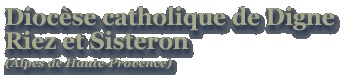

Recherchez votre paroissse
| |
||||||||||||||||
|
|
découvrir... |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Au Moyen-Âge, Gréoux avait deux églises, il
semblerait que la première ait été Saint-Pierre
aux Liens, située à l'emplacement de l'ancienne agglomération
romaine, près des thermes. En effet. depuis des temps immémoriaux,
cet endroit était un lieu de culte antique, rattaché
aux résurgences des eaux tenues pour sacrées. Le nom
de Gréoux viendrait d'ailleurs du nom de la déesse
Grysélis nymphe des eaux curatives. La deuxième, qui est l'église actuelle, était
construite dans le bourg qui, par suite des invasions diverses,
s'était blotti autour du château pour sa protection.
Le portail semble être du treizième siècle,
la porte aux très longs claveaux est surmonté d'un
vaste oculus. La porte latérale est certainement le portail
primitif. En entrant, on est surpris de voir la nef aussi vaste,
on est séduit par les proportions harmonieuses de ce vaisseau
en plein cintre, renforcé de doubleaux, que l'extérieur
ne laisse pas soupçonner. Le décapage des murs a révélé
l'hétérogénéité des constructions.
Les trois travées précédant le chœur présentent
un berceau en grès tendre, les deux travées basses
des moellons moins soignés (agrandissement postérieur).
Le chœur moins élevé que la nef porte une croisée d'ogives de style gothique, la clé est sculptée aux armes de l'Agneau Pascal. Au Moyen-Âge, des chapelles latérales furent construites. Elles on été transformées en bas-côté par le percement des murs latéraux (voir l'inégalité des arcs). Les deuxième, troisième, quatrième travées remonteraient aux quatorzième et quinzième siècles. Leur voûte est gothique. Dans le parement de la deuxième on peut observer un fût de colonne antique en remploi et deux piliers polygonaux dont un est surmonté d'un chapiteau à crochets. La clé pendante de la quatrième conserve les armes très effacées d'un prélat. La chapelle de la Vierge, mieux articulée à la nef,
semble dater du seizième siècle, elle forme l'amorce
d'un faux transept. La voûte est gothique. Le bénitier
en marbre est l'ancienne cuve baptismale, elle date de 1880 environ.
|
||||||||||||||||
| La lettre d'infos |
| Agenda |
| Le
secteur pastoral de Gréoux-les-Bains |
| Écrivez-nous | |
| Plan du site | |
| Le site de A à Z | |
| Votre paroisse | |
| Mentions légales |
© 2002 Diocèse catholique de Digne, Riez et Sisteron - Réalisation Sudway Internet