
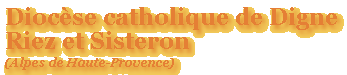
| |
||||
|
|
dialoguer... | |||
le message du vicaire général |
||||
|
Bioéthiqu’info Quelle éthique pour la bioéthique ? Alors que viennent de s’ouvrir dans notre pays les Etats généraux de la bioéthique avril 2009 . voir dossier de mai |
||||
|
En France, nous allons beaucoup entendre parler de bioéthique dans les semaines et les mois à venir car viennent de s’ouvrir dans notre pays les Etats généraux de la bioéthique qui précédent la révision de la loi bioéthique de 2004 qui interviendra au cours du premier trimestre 2010. La bioéthique concerne l’homme dès avant sa conception, avec toutes les techniques d’AMP et jusqu’au terme de sa vie terrestre, à propos du bien mourir, du mourir dans la dignité. Elle concerne donc chacun de nous, nos proches, nos amis. Elle concerne aussi l’Eglise. Cette Eglise qui, comme le disait le Pape Paul VI, est experte en humanité. Cette Eglise appelée à être aux écoutes des joies et des espoirs, des tristesses et des angoisses des hommes de ce temps comme nous le rappelle le Concile Vatican II. Vous me permettrez de débuter par une citation ; cette citation, de celui qui était alors préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le Cardinal Joseph Ratzinger lors d’un débat public avec le philosophe athée Paolo Flores d’Arcais : « Nous autres croyants pensons avoir quelque chose à dire au monde, aux autres, nous pensons que la question de Dieu n’est pas quelque chose de privé, ce n’est pas une question entre nous, à l’intérieur d’un club qui a ses intérêts et qui joue son jeu. Nous sommes au contraire convaincus que l’homme a besoin de connaître Dieu, nous sommes convaincus qu’en Jésus est apparue la vérité, et la vérité n’est pas la propriété de tel ou tel, elle doit être partagée, elle doit être connue. C’est pourquoi nous sommes convaincus que, justement, à ce moment de l’histoire, un moment de crise de la religiosité, de crise aussi des grandes cultures, il est important que nous ne vivions pas seulement à l’intérieur de nos certitudes et de nos identités mais que nous nous exposions réellement aux questions des autres. C’est avec cette disponibilité et cette franchise que, dans la rencontre, nous essayons de faire comprendre ce qui nous semble à nous raisonnable ou, mieux encore nécessaire pour l’homme ».
L’Eglise catholique souhaite, en s’exposant réellement et sincèrement aux questions des autres, leur partager avec conviction, respect et humilité quelques convictions qui lui semblent raisonnables, nécessaires devant les découvertes scientifiques et ce qu’elles impliquent pour la vie de l’homme et de la société. « Qui dit dialogue, dit recherche pour trouver les meilleures raisons, et écoute des élans profonds du cœur. Le cœur et la raison, le désir et la réflexion, s’unissent pour écouter et parler, pour dialoguer. Le dialogue est d’autant plus nécessaire que les questions soulevées par les sciences biomédicales sont complexes et que les enjeux sont majeurs : Quelle société voulons-nous ? Quelle conception de l’homme sommes-nous en train de nous forger ? » (Mgr Pierre d’Ornellas). Les positions éthiques de l’Eglise sont prises en conformité avec ce qu’elle perçoit de l’homme. Ces positions ne sont pas là pour contraindre, opprimer ou étouffer la liberté, la soif de bonheur de l’homme, mais elles sont au service de sa croissance en humanité pour qu’il soit toujours plus et toujours mieux homme.
I. La naissance de la bioéthique
Depuis une cinquantaine d’années on a assisté au développement fulgurant des sciences médicales et biologiques. 2 révolutions se sont succédées :
- La révolution thérapeutique : Au lendemain de la seconde guerre mondiale, on assiste au développement foudroyant de la pharmacopée (vaccins, antibiotiques, neuroleptiques), de la radiothérapie, de la réanimation. Tout cela provoque une véritable révolution modifiant fondamentalement l’évolution de maladies jadis fatales. On a assisté également aux premières audaces chirurgicales, aux premières tentatives et réussites de greffes d’organes dans les années 60… - Révolution biologique illustrée par la molécule d’ADN (1953) : l’hélice de Crick et Watson. Pièce essentielle du vivant. Grâce à elle on découvre les lois simples qui président à la formation de la vie qui donnera naissance à l’AMP dans les années 70.
Ces deux révolutions s’entrechoquent et se potentialisent. Elles transforment le destin des hommes. Jusque dans les années 60, l’optimisme béat est de rigueur. L’éthique médicale ne suscité guère de débats. Les milieux intellectuels s’en désintéressent, à la fois par excès de confiance dans le progrès et par insouciance. Dans les années 70 sont révélées de scandaleuses affaires d’expérimentation sur des êtres humains dans l’Occident civilisé et notamment dans ce pays qui se pensait le champion des droits de l’homme, les USA. Ces affaires font ressurgir le spectre de ce qui s’était passé dans les camps de concentration de l’Allemagne hitlérienne concernant l’expérimentation humaine : les expériences scandaleuses des médecins nazis qui n’ont permis aucun progrès valable. Elles furent à la fois barbares et absurdes. Des inquiétudes se font jour relatives aux conditions mêmes de la recherche, de l’expérimentation des nouveaux pouvoirs. A quelles conditions les nouveaux pouvoirs sont-ils susceptibles de servir l’homme sans jamais l’asservir ? Cette question a donné naissance à la bioéthique. Nous sommes partagés entre les pathologies diverses dont nous pouvons ou dont nos proches peuvent souffrir et l’espérance de thérapies et aussi inquiets par certaines découvertes ou possibilités scientifiques. La bioéthique est apparue dès que l’homme a marqué un temps d’arrêt, de réflexion pour s’interroger sur le caractère éthique de telle ou telle technique touchant la vie humaine : d’où le nom de bioéthique.
«Nous avons cru quelque temps que la raison suffirait pour nous servir de guide. Une raison sans défaillance ni dogmatisme. Or voilà que le succès même de la science est en train de nous donner tort. La médecine et la biologie modernes cherchent des raisons que la seule raison ne parvient pas toujours à saisir.» F. Mitterrand. 2.12.1983 lors de l’inauguration de CCNE.
Sciences et techniques sont de précieux instruments, et l’Eglise les encourage, mais pour bien les utiliser il faut une certaine idée de l’homme. Ce sens la science ne le donne pas. En elle-même elle est neutre. Elle fait ce qu’elle peut techniquement faire. Et «c’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser» (Montesquieu, l’esprit des lois). Pour ne pas abuser de son pouvoir la science doit accepter que ce qu’elle peut faire soit apprécier par la philosophie, l’anthropologie, le droit, la foi. « Science sans conscience n’est que ruine de l’homme » (Rabelais. Toutes ces disciplines sont la conscience de la science).
II. Les lois de bioéthique de 1994 La France est le premier pays européen à s’être dotée de lois de bioéthique dans le domaine des sciences de la vie, avec le souci de trouver "un point d'équilibre entre la protection des droits fondamentaux de la personne et la non-entrave aux progrès de la recherche". Ces lois, promulguées en juillet 1994, sont au nombre de trois : • la loi du 1er juillet 1994 relative au traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé • la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain ; • la loi du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.
La révision des lois de bioéthique de 1994, comme elles le prévoyaient, est intervenue le 6 août 2004 car l'importance des progrès médicaux et scientifiques réalisés depuis 1994 ainsi que l'évolution de la société justifient que soient rediscutés les choix qu'il convient de retenir pour permettre à la fois une ouverture maîtrisée de la recherche et le respect des grandes règles éthiques qui fondent l'organisation de notre société III. Les principales dispositions de la loi de 2004 à la veille de la révision de 2010 Le clonage, reproductif ou thérapeutique, est interdit. Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. Le clonage reproductif constitue désormais un "crime contre l’espèce humaine", puni de 30 ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d’euros d’amende.
La recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires est interdite. Par dérogation, les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires, pour une période limitée à cinq ans, "lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques". Ne peuvent être concernés que les "embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l'objet d'un projet parental" (embryons dits "surnuméraires").
Par dérogation, "le diagnostic biologique [préimplantatoire] effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro peut également être autorisé, à titre expérimental", pour guérir un enfant atteint d’une maladie génétique incurable grâce à la naissance d’un enfant indemne (bébés dits "du double espoir" ou "bébés-médicaments").
Le cercle des personnes pouvant procéder à un don d’organe pour une greffe est élargi. Outre le père et la mère du receveur, "peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur son conjoint, ses frères ou sœurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère", et "toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le receveur".
En ce qui concerne le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain, 3 principes sont actuellement posés : consentement préalable, anonymat du don et gratuité.
Ne peuvent recourir à l’Aide Médicale à la Procréation (AMP) qu’un homme et une femme formant un couple mariés ou pouvant apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans, en âge de procréer. Le recours à l’AMP est destiné à remédier à l’infertilité dont le caractère pathologique a été diagnostiqué ou afin d’éviter la transmission d’une maladie génétique. La gestation pour autrui est interdite.
La loi de bioéthique sera réexaminée par le Parlement dans un délai de cinq ans suivant son entrée en vigueur. Les travaux préparatoires ont démarré avec les états généraux de la bioéthique. vont se tenir début 2009. La préparation des états généraux a été confiée à un comité de pilotage présidé par le député M. Jean Léonetti. Des personnalités du monde médical, universitaire, religieux, des philosophes, des psychiatres, des sociologues sont auditionnés. Depuis le 16 février un site internet (www.etatsgenerauxdelabioethique.fr ) est accessible. On peut envoyer une contribution écrite à ces états généraux. Le point d’orgue des états généraux en juin : 3 forums citoyens : 9 juin à Marseille (cellules souches adultes et embryonnaires, DPN et DPI), le deuxième sur l’AMP à Rennes le 11 juin, le troisième à Strasbourg sur les prélèvements d’organes et la médecine prédictive qui seront l’occasion d’un débat tripartite entre des jurés tirés au sort parmi la population, qui auront bénéficié d’une formation, des grands témoins qui répondront à leurs questions, et un public autorisé à intervenir. La synthèse aura lieu à Paris le 23 juin en présence du Président Sarkozy.
Sujets concernés par la révision : 7 - Recherche sur l’embryon. - Prélèvement et greffes d’organes, de tissus et de cellules. - Les modalités d’expression du consentement dans les protocoles de recherche. - Le principe d’indisponibilité du corps humain. - l’AMP qui pose elle-même la question de l’anonymat du don et de la gestation pour autrui. - Le développement de la médecine prédictive (La médecine prédictive est une expression popularisée par le professeur Jacques Ruffié, dans son livre Naissance de la médecine prédictive en 1993). La médecine prédictive désigne les capacités nouvelles de la médecine, et notamment de la génétique de prévoir, parfois très longtemps à l'avance, les affections qui frapperont le patient. - l’extension du recours au DPN et au DPI. Père Christophe Disdier-Chave, vicaire général
|
||||
© 2002 Diocèse catholique de Digne, Riez et Sisteron - Réalisation Sudway Internet