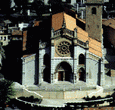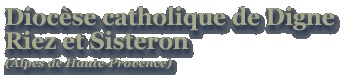

| |
||||||||||
|
|
 |
découvrir... |
||||||||
|
C'est l'évêque Antoine de Guiramand qui fit bâtir cette église entre son château (à l'emplacement de l'actuelle prison) et la Tour de l'Horloge. Les travaux, confiés à un maçon de Barcelonnette, Antoine Brollion, furent entrepris en 1490 et ne furent achevés qu'une dizaine d'années plus tard. Bien que dans son état actuel l'église soit plus un monument du dix-neuvième siècle que de la fin du quinzième siècle, elle porte cependant encore témoignage d'un implantation de l'art gothique en Haute-Provence. Cliquez sur les vignettes pour voir l'image agrandie Pourquoi Saint-Jérôme ? Parce qu'une relique de ce saint avait été confiée à l'évêque Antoine de Guiramand. En ce temps des débuts de l'imprimerie où l'on éditait la traduction latine de la Bible par saint Jérôme, celui-ci jouissait d'une grande popularité. Orientée nord-sud pour répondre à la configuration du rocher, l'église était, à l'origine, de petites dimensions. Des chapelles latérales lui furent ajoutées au dix-septième siècle, mais c'est surtout au siècle dernier qu'elle fut remaniée et agrandie. La Révolution ayant fermé les nombreux couvents de Digne, dont les chapelles servaient d'églises de quartier, elle était devenue trop petite pour contenir les fidèles. Déjà sous la Restauration Mgr de Miollis avait envisagé son agrandissement et son embellissement. Ce fut son successeur, Mgr Sibour (plus tard archevêque de Paris) qui prit l'initiative des travaux. Décidés en 1843 et déclarés d'utilité publique le 17 janvier 1845, ceux-ci furent réalisés de 1846 à 1862 sur des plans établis par l'architecte parisien Antoine Bailly. Deux architectes de Digne, les frères Raymond, furent successivement chargés de surveiller ces travaux confiés d'abord à l'entrepreneur dignois Pascal Arnaud, jusqu'en 1851, puis à Maurin, le même architecte qui aurait construit la Major à Marseille. On utilisa de la pierre de Baudinard (sur la rive gauche du Verdon), de Forcalquier, de Manosque et, plus près de Digne, des Dourbes et de Marcoux. Quant au tuf nécessaire à la construction des voûtes, il fut amené du domaine de Saint-Benoît, aux portes de Digne. La nef fut alors allongée d'une travée et l'on édifia une nouvelle façade dans un style néo-gothique qui se voulait à la manière du treizième siècle. On construisit un parvis et un escalier monumental et, pour donner plus d'élan aux voûtes et éviter un encombrement d'escaliers, on abaissa le sol de 2,50 m à l'intérieur de l'église. On profita de ces travaux pour ajouter deux chapelles latérales à l'est de manière à avoir une église symétrique. À l'ouest, en effet, une enfilade de chapelles ouvrait sur le bas-côté et le doublait, alors qu'à l'est n'avait été construite qu'une seule chapelle, au dix-septième siècle, contre le mur du clocher, au sud de celui-ci, et dans son alignement (en raison de la configuration du sol et de l'existence d'un puits, le puits de Saint-Jérôme). On fit donc une chapelle à l'emplacement de ce puits, après l'avoir recouvert, entre le clocher et la sacristie; et une autre au sud de celle qui existait déjà. L'allongement de la nef entraîna aussi le prolongement des chapelles de part et d'autre de l'église. Église épiscopale durant plusieurs siècles,
Saint-Jérôme a été classée |
||||||||||
|
|
||||||||||
| La lettre d'infos |
| Agenda |
| le
secteur de la Bléone |
| La
cathédrale Notre-Dame-du-Bourg |
| La
cocathédrale Saint-Jérôme |
| Écrivez-nous | |
| Plan du site | |
| Le site de A à Z | |
| Votre paroisse | |
| Mentions légales |
© 2002 Diocèse catholique de Digne, Riez et Sisteron - Réalisation Sudway Internet