
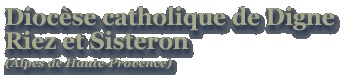

Recherchez votre paroissse
| |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
 |
découvrir... |
|||||||||||||||||||||||
|
L'église Saint-Pierre Cliquez sur les vignettes pour voir l'image agrandie dans une nouvelle fenêtre.
On parie de la fondation de Barcelonnette, en 1232, par le comte de Provence, Raymond Béranger V. Ce n'est peut-être qu'une reconstruc-tion d'une précédente ville qu'aurait emportée une crue de l'Ubaye. On peut faire l'hypothèse que celle-ci était déjà une ville de plan orthogonal, église en haut du damier (le plus loin des colères du torrent), que la reconstruction se fit sur un tracé, toujours orthogonal mais infléchi d'une quinzaine de degrés pour éloigner le bas de la ville de l'Ubaye, mais que les fondations de la première église, encore solidement en place et possédant une valeur symbolique forte, ont été utilisées pour le nouvel édifice. Celui-ci fut achevé en 1240. Restaurée puis remaniée au dix septième siècle, après l'incendie général de la ville, cette ancienne église de Barcelonnette dédiée à saint Pierre était dans la lignée des églises médiévales de la vallée : au départ, une nef unique, orientée, qu'avaient développée ensuite latéralement des chapelles particulières, et même, tardivement, un grand auvent au sud, sur la place, qui abritait occasionnellement le marché aux grains. Le clocher carré, lui aussi dans la tradi-tion de la vallée, vit en 1860 sa flèche remplacée par un campanile (cage à cloche en fer forgé), entouré de quatre pyramides et portant haut (35 mètres) une vierge en métal doré. Mais Barcelonnette du début du vingtième siècle, en pleine fièvre de l'émigration au Mexique, juge la vénérable église trop petite et en trop mauvais état : en 1912, on décide la reconstruc-tion de l'église. Le chanoine Pellissier, vicaire puis curé de la paroisse de 1893 à 1943, en est la cheville ouvrière, aidé par un comité créé à cet effet. Le maître de l'ouvrage et l'architecte Bouhant ont été très exigeants dans le choix des matériaux et la façon. Ils désiraient que rien ne fut médiocre dans la structure et l'ornementation. Il fallait un édifice vaste (1000 mètres carrés), simple, robuste et adapté au climat. Pour avoir plus de place, la nouvelle église fut tournée vers le nord, débordant au-delà de l'ancien rempart. Seul le clocher du précédent édifice fut conservé. Le dessin de la nouvelle façade trouve son inspiration dans l'art roman (tympan avec le Christ en gloire et les quatre vivants de l'Apocalypse identifiés par la tradition chrétienne aux quatre évangélistes). La toiture à deux grandes pentes était capable de supporter les plus fortes neiges. L'espace intérieur est remarquablement ample et aéré, en même temps qu'est affirmée la puissance de la pierre : large nef centrale et deux nefs latérales qui se développent sur six travées. Les voûtes reposent sur douze colonnes peu massives et de facture différente (marbre de Maurin, pierre de Serenne...). Des chapiteaux non figuratifs ornent le sommet des piliers. Un vaste chœur surélevé occupe une abside et la première travée de l'église. Enfin, une tribune occupe la dernière travée de la nef centrale et porte les orgues qui épousent la forme de la rosace. Au fond de l'église, côté ouest, ornant le mur des fonts baptismaux, se trouve une peinture de Moïse faisant jaillir l'eau du rocher. À droite des fonts baptismaux, est suspendu un tableau de Notre-Dame de Guadalupe, vénérée au Mexique. La première pierre, bénie en 1924 est encastrée
à la base du pilier gauche du chœur; elle porte en latin
l'inscription suivante: Plusieurs éléments remarquables du décor sont
à retenir. La grande mosaïque de la demi-coupole de
l'abside, emprunt à la tradition byzantine. Parmi les différents autels présents, l'autel dédié
à saint Joseph provient de l'ancienne église où
il était placé face à la porte des hommes.
Entièrement en bois, il est surmonté d un vaste retable
sculpté et doré. ----------------------------------------------------- En moins de cent cinquante ans (1793-1934), Barcelonnette a perdu
ses quatre anciennes églises, et n'en a renouvelé
qu'une seule : l'église paroissiale Saint-Pierre. Les églises
suivantes étaient présentes sur le plan de Barcelonnette
de 1677 établi à la demande du duc de Savoie: -------------------------------------------------- Église Saint-Pierre : Le tombeau du maître-autel
est sculpté à la manière d'un sarcophage arlésien.
Le tombeau de l'autel du retable baroque vient de la chapelle Saint-Maurice. — La chaire, venant de la chapelle des Dominicains, est également
baroque. Le chien tenant dans sa gueule un flambeau et l'étoile
font allusion à un rêve que la mère de Dominique
aurait eu pendant sa grossesse, annonçant ce Domini conis,
« chien du Seigneur » que serait son fils, chien de
garde de l'Église contre les hérétiques. La
devise, FAVCE ET FACE, « par la voix et par la lumière
», est une belle illustration sonore et lumineuse de l'image
du chien en même temps que du but premier des Ce texte est tiré de : Patrimoine religieux de la vallée de l'Ubaye, |
|||||||||||||||||||||||||
| La lettre d'infos |
| Agenda |
| Le patrimoine religieux |
| Les secteurs paroissiaux |
| Les paroisses et les saints patrons |
| Écrivez-nous | |
| Plan du site | |
| Le site de A à Z | |
| Votre paroisse | |
| Mentions légales |
© 2002 Diocèse catholique de Digne, Riez et Sisteron - Réalisation Sudway Internet













