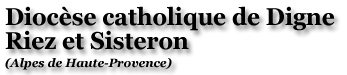Le mystère de l'Eucharistie
Nous entrons maintenant dans le deuxième temps de la célébration de l'Eucharistie.
Temps de la Parole: première table. Temps d'écoute, d'attention, de méditation et d'ouverture du cœur pour entrer plus profondément dans une relation intime avec Dieu et nous enraciner dans la connaissance du mystère divin.
La liturgie de la Parole est un dialogue entre Dieu et son peuple assemblé.
Nous écoutons mais nous ne sommes pas spectateurs car nous sommes invités à y répondre. Nous ne répondons pas chacun avec nos propres mots mais en reprenant à notre compte une prière qui nous précède. En effet toute liturgie où l'un des deux partenaires serait muet ne serait pas une liturgie chrétienne. Le dialogue que nous entretenons signifie en réalité la présence du Christ dans sa Parole proclamée. C'est ce que nous disons quand nous acclamons l'Évangile : «Louange à toi Seigneur Jésus».
La très belle introduction de la présentation générale du missel romain (PGMR) fait bien saisir que la liturgie de la Parole ne se réduit pas à une «avant-messe» : «dans les lectures, que l'homélie, explique, Dieu adresse la Parole à son peuple, il découvre le mystère de la rédemption et du salut et il présente une nourriture spirituelle; et le Christ Lui-même est là, présent par sa parole, au milieu des fidèles. Cette Parole divine, le peuple la fait sienne, par ses chants, et il y adhère par la profession de foi ; nourri par elle, il supplie, avec la prière universelle pour les besoins de toute l'Église et pour le salut du monde entier». (PGMR 33/55)
La liturgie de la Parole fait partie intégrante de l'Eucharistie. C'est en effet Dieu qui annonce à son peuple son dessein. Et ce dessein se réalise dans l'action Eucharistique du Christ. «La proclamation de la Parole introduit dans ce que l'Eucharistie va donner à vivre, et ranime la foi nécessaire à ce passage». (cf Paul De Clerck, L'intelligence de la liturgie).
Pour réaliser ce projet, le concile Vatican II a demandé « d'ouvrir plus largement les trésors bibliques pour que, dans un nombre déterminé d'année, on lise au peuple la partie la plus importante des Saintes Écritures». (Constitution sur la Liturgie de Vatican II n° 51).
C'est ainsi que nous disposons maintenant de quatre lectionnaires : celui des dimanches, de la semaine, des fêtes de saints et des sacrements. Le lectionnaire dominical s'étend sur trois ans : il est constitué par la lecture des Évangiles de Matthieu, Marc et Luc (année A,B,C) ..
La première lecture est choisie en fonction de l'Évangile. La deuxième lecture est tirée de Saint Paul (ou Saint Jacques en année B) selon le principe de la lecture semi-continue. Entre les deux premières lectures sont insérés quelques versets d'un psaume qui offre généralement un écho lyrique à la Parole proclamée. Si le psaume n'est pas chanté, ce qui est regrettable, il faut du moins trouver le ton poétique pour le proclamer.
«La dignité de la Parole de Dieu requiert qu'il existe dans l'église un lieu qui favorise l'annonce de cette Parole et vers lequel, pendant la liturgie de la Parole, se tourne spontanément l'attention des fidèles ... Il ne convient guère que le commentateur, le chantre ou le chef de chœur monte à l'ambon». (PGMR 272/309).
Une grande vénération est réservée au livre des Évangiles qui est porté processionnellement par le diacre pendant que l'on chante l'Alléluia: Il est encensé avant la lecture et embrassé après la proclamation.
Tout cet ensemble rituel est destiné à bien faire saisir que «le Christ est présent dans sa Parole, car c'est Lui qui parle tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures». (Sacrosanctum Concilium n°7).
Les lectures ont été choisies par l'Église et nous sont données comme le don de Dieu, c'est pourquoi nous ne pouvons les changer lorsque nous préparons une célébration liturgique.
Pierre LEOUFFRE
et Philippe MICHEL
|