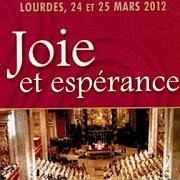( voir les billets des années passées) janvier - février - mars - avril - mai - juin - juillet - août - septembre lire également: L'ouverture solennelle du XXIe Concile œcuménique
Pour la 6ème édition de son jeu intergénérationnel sur Internet, le diocèse d'Evry a choisi pour thème le concile Vatican II.
|
|
UNE DELEGATION DIOCESAINE A LOURDES les 24-25 mars 2012 A Lourdes, invitation est faite aux diocèses de France de venir avec une délégation d'une trentaine de membres pour constituer une assemblée de 2500 personnes. Pendant cette journée et demie auront lieu des interventions d'évêques et des témoignages de chrétiens sur ce que le Concile leur a fait vivre, des temps d'échanges et de prière. Le tout s'articulera autour de 3 thématiques : « Le Christ au centre » (Constitution dogmatique Dei Verbum), « L'Eglise » (Constitution dogmatique Lumen Gentium) et « L'homme » (Constitution pastorale Gaudium et Spes). Trois thématiques donc pour recueillir ce que le Concile Vatican II a apporté à notre Eglise aujourd'hui, à notre conscience chrétienne, pour voir comment il a contribué à approfondir la doctrine sur le Christ, sur l'Eglise et sur l'Homme. |
|
« Le Père éternel par la disposition absolument libre et mystérieuse de sa sagesse et de sa bonté a créé l'univers ; il a décidé d'élever les hommes à la communion de sa vie divine ; après leur chute en Adam, il ne les a pas abandonnés, leur apportant sans cesse les secours salutaires, en considération du Christ rédempteur, "qui est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création" (Col 1,15). Tous ceux qu'il a choisis, le Père, avant tous les siècles, les "a distingués et prédestinés à reproduire l'image de son Fils pour qu'il soit le premier-né parmi une multitude de frères" (Rm 8,29). Et tous ceux qui croient au Christ, il a voulu les appeler à former la sainte Église qui, annoncée en figure dès l'origine du monde, merveilleusement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'ancienne Alliance, établie enfin dans ces temps qui sont les derniers, s'est manifestée grâce à l'effusion de l'Esprit-Saint et, au terme des siècles, se consommera dans la gloire. Alors, comme on peut le lire dans les saints Pères, tous les justes depuis Adam, "depuis Abel le juste jusqu'au dernier élu" se trouveront rassemblés auprès du Père dans l'Église universelle. » Célébrer les cinquante ans du concile est pour nos communautés l’occasion d’approfondir ce qui fait l’essence de l’Église : la communion. Nous l’avons célébré dans la nuit pascale. L’Alléluia est le chant de communion par excellence, communion du Christ dans la mort et la résurrection avec toute l’humanité même celle qui l’a précédé, communion entre nous, communion de vie avec celles et ceux qui nous précédent auprès du Père et que nous avons aimés, communion dans l’histoire avec tous les justes depuis Adam, communion qui transcende toutes frontières y compris la frontière si effroyable de la mort. Les justes depuis Adam c'est-à-dire celles et ceux justifiés par le Père, ajustés dans l’Esprit Saint à son amour. Évêque du diocèse de Rome. Vicaire de Jésus-Christ (réservé au pape depuis le xiiie siècle). Successeur du prince des apôtres. Chef suprême de l'Église. Souverain Pontife de l'Église universelle. Primat d'Italie. Archevêque métropolite de la Province romaine. Souverain de l'État de la Cité du Vatican. Serviteur des serviteurs de Dieu. Patriarche d'Occident (titre abandonné par Benoît XVI en 2006, qui n'a toutefois pas supprimé le patriarcat d'Occident, dont il est titulaire en tant que pape) |
|
|
Je terminai le billet spirituel du mois d’avril par la notion de mission. Dans quelques jours, nous célébrerons liturgiquement le mystère de Pentecôte. L’un des projets de Jean XXIII est que l’Église s’inscrive dans la mission du Christ. « Vénérables frères, voilà ce que se propose le IIe Concile œcuménique du Vatican. En unissant les forces majeures de l'Église, et en travaillant à ce que l'annonce du salut soit accueillie plus favorablement par les hommes, il prépare en quelque sorte et il aplanit la voie menant à l'unité du genre humain, fondement nécessaire pour faire que la cité terrestre soit à l'image de la cité céleste « qui a pour roi la vérité, pour loi la charité et pour mesure l'éternité ». (Saint Augustin, Ep. CXXXVIII, 3.) » Cette mission du Christ s’enracine dans sa communion avec le Père. Le principe de cette communion intime est l’Esprit-Saint. La communion dans l’Église qui est simultanément un envoi dans le monde (la mission) s’enracine donc dans la communion trinitaire et la mission même du Christ-Jésus. Nous ne pouvons pas délier communion et mission dans la vie de l’Église comme dans notre propre vie. La mission nous permet d’approfondir la communion, et la communion est le socle sur lequel nous nous appuyons pour partir en mission. Le programme de cette communion nous est donné dans ce passage du concile, il est enraciné dans le commandement du Christ : « Se souvenant de la parole du Seigneur: "En ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres" (Jn 13,35), les chrétiens ne peuvent pas former de souhait plus vif que celui de rendre service aux hommes de leur temps, avec une générosité toujours plus grande et plus efficace. Aussi, dociles à l'Évangile et bénéficiant de sa force, unis à tous ceux qui aiment et pratiquent la justice, ils ont à accomplir sur cette terre une tâche immense, dont ils devront rendre compte à celui qui jugera tous les hommes au dernier jour. Ce ne sont pas ceux qui disent "Seigneur, Seigneur !" qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté du Père et qui, courageusement, agissent. Car la volonté du Père est qu'en tout homme nous reconnaissions le Christ notre frère et que nous nous aimions chacun pour de bon, en action et en parole, rendant ainsi témoignage à la vérité. » La communion entre nous oblige une pratique de la volonté du Père, laquelle est de nous aimer les uns les autres à l’image de l’amour trinitaire. Mais cette volonté du Père nous invite aussi à reconnaître en l’autre la présence du Christ, présence agissante, effective. Il ne s’agit pas de vivre la communion pour éviter les conflits, pour se sentir plus en harmonie mais pour confesser la présence réelle du Christ ressuscité en l’autre, ce qui scelle une fraternité universelle. Et cette communion de fraternités s’exprime dans la communion des saints car elle est tendue vers cette vie continuée au-delà de la mort, dans le monde de la résurrection. Le concile continue ainsi : « Elle est aussi que nous partagions avec les autres le mystère d'amour du Père céleste. C'est de cette manière que les hommes répandus sur toute la terre seront provoqués à une ferme espérance, don de l'Esprit, afin d'être finalement admis dans la paix et le bonheur suprêmes, dans la patrie qui resplendit de la gloire du Seigneur. » Christian de Chergé exprime cette communion profonde en écrivant une lettre à la fille d’un de ses amis qui lui demande d’être son parrain de baptême. « Dans le pays où je vis, j’ai ainsi une multitude de filleuls (…/…). Ces filleuls ne partagent pas la foi au Christ que tu vas accueillir au baptême, mais mon espérance sait que toute leur vie religieuse est déjà voulue et guidée par l’Esprit du Père, et auprès d’eux j’aime à désirer déjà la joie que nous aurons à reconnaître ensemble le Christ. Au fond, le baptême de l’espérance, ici, c’est la mort… et que ce mot ne te fasse pas peur puisqu’il s’agit de l’ultime naissance. Être chenille et aimer en tous ses frères le papillon en devenir… et cela sans frontière ni dans l’espace ni dans le temps. Je peux donc être ton parrain d’espérance mais… il te faut accepter que j’aie une multitude de filleuls. » Nous percevons combien la mission ne peut être désarticulée de cette communion d’amour du frère. Elle n’est donc pas une technique élaborée pour multiplier les adeptes et encore moins une espèce de propagande pour bien vendre une espèce de concept religieux. La mission n’est donc jamais une réussite personnelle et encore moins une grande braderie ou un vide-grenier. Ni la communion ecclésiale ni le Christ ne sont des produits commerciaux. La mission est toujours un élan spirituel intérieur venant du cœur de la communauté vers le monde. Cet élan doit demeurer une réponse à l’amour du Christ qui donne sa vie pour l’humanité. Paul peut donc s’écrier pour lui-même et pour l’Église : « Annoncer l'Évangile en effet n'est pas pour moi un titre de gloire; c'est une nécessité qui m'incombe. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile! » « L'Esprit incite le groupe des croyants à se constituer en «communauté», en Église. Après la première annonce de Pierre, le jour de la Pentecôte, et les conversions qui ont suivi, la première communauté se forme (cf. Ac2, 42-47; 4, 32-35). L'un des objectifs centraux de la mission, en effet, est de réunir le peuple pour écouter l'Évangile, pour la communion fraternelle, pour la prière et l'eucharistie. Vivre la «communion fraternelle» (koinonia), cela signifie n'avoir «qu'un cœur et qu'une âme» (Ac 4, 32), en instaurant la communion à tous les points de vue: humain, spirituel et matériel. De fait, la vraie communauté chrétienne s'engage à distribuer les biens terrestres pour qu'il n'y ait pas d'indigents et pour que tous puissent avoir accès à ces biens «selon les besoins de chacun» (Ac 2, 45; 4, 35). Les premières communautés, où régnaient «l'allégresse et la simplicité de cœur» (Ac 2, 46), étaient dynamiques, ouvertes et missionnaires: elles «avaient la faveur de tout le peuple» (Ac 2, 47). Avant même d'être une action, la mission est un témoignage et un rayonnement. » Dans ce passage, Jean-Paul II articule communion et mission appuyées sur la triple dimension de la vie du Christ : l’enseignement (écouter l’évangile, que nous traduisons aujourd’hui par la catéchèse), la liturgie (vivre la prière commune, l’eucharistie, les sacrements) et la charité (la communion fraternelle et particulièrement avec les plus pauvres). Trois dimensions qui définissent une communauté vivante, une communion missionnaire, une communauté dont la mission est d’abord témoignage (martyre) et rayonnement au-delà d’elle-même. La communion et la mission ne sont pas pour la communauté mais toujours mouvement vers les autres. Elles ne viennent pas de la communauté mais sont toujours des dons du Christ et des dons de vie dans l’Esprit. Les 24 et 25 mars derniers, les évêques de France ont invité à Lourdes des délégations de chaque diocèse de France pour commémorer cet événement du concile. Faire mémoire dans l’Église ne se simplifie jamais à un simple souvenir aussi fort soit-il. Faire mémoire dans l’Église rend présent et rend vivant. Ainsi, la démarche des évêques de France est celle-ci : « Dans son discours d'ouverture il [Bienheureux Jean XXIII] dit : « Les lumières de ce concile seront pour l'Église une source d'enrichissement spirituel. Après avoir puisé en lui de nouvelles énergies, elle regardera sans crainte vers l'avenir, (...). Nous devons nous mettre joyeusement, sans crainte, au travail qu'exige notre époque, en poursuivant la route sur laquelle l'Église marche depuis près de vingt siècles ». Ainsi peut-on affirmer que fêter le concile en 2012, cinquante ans après son ouverture, ne sera pas d’abord la célébration d'un événement du passé mais davantage l'occasion d'exprimer, à sa lumière, notre joie d'être disciples du Christ aujourd'hui, de pouvoir en témoigner et de regarder l'avenir sans crainte. Le concile, en nous tournant vers le monde que nous devons accueillir et aimer, nous invite et nous aide à le rejoindre pour lui annoncer le Christ. Le pape Benoît XVI insiste sur ce point en nous proposant d'inscrire notre témoignage dans la perspective d'une nouvelle évangélisation. Cet élan missionnaire est celui de nos paroisses, services et mouvements : « aller vers les personnes», « cheminer avec elles» et « leur annoncer le Christ». » D’ailleurs le livret que le diocèse nous propose de travailler en groupe ne s’y trompe pas. Les questions posées ne sont pas tellement de l’ordre de l’analyse sociologique d’un événement qui aurait marqué ou non dans les années 60. Les questions sont d’abord enracinées dans la vie du monde de cette époque avec les divers bouleversements du siècle dernier (ils ont été très nombreux) et elles nous projettent dans nos vies personnelle, humaine, ecclésiale actuelles. Entrons en communion en vue de la mission dans le mystère de Pâques et de Pentecôte car nous sommes greffés au mystère de la vie même du Christ. « C'est ainsi que par le baptême les hommes sont greffés sur le mystère pascal du Christ : morts avec lui, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui; ils reçoivent l'esprit d'adoption des fils "dans lequel nous crions : Abba, Père" Rm 8,15, et ils deviennent ainsi ces vrais adorateurs que cherche le Père. Semblablement, chaque fois qu'ils mangent la Cène du Seigneur, ils annoncent sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi le jour même de la Pentecôte où l'Église apparut au monde, "ceux qui accueillirent la parole" de Pierre "furent baptisés". "Et ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle dans la fraction du pain et aux prières ... louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple" Ac 2,41-47. Jamais, dans la suite, l'Église n'omit de se réunir pour célébrer le mystère pascal; en lisant "dans toutes les Écritures ce qui le concernait" Lc 24,17, en célébrant l'eucharistie dans laquelle "sont rendus présents la victoire et le triomphe de sa mort" et en rendant en même temps grâces "à Dieu pour son don ineffable" 2Co 9,15 dans le Christ Jésus "pour la louange de sa gloire" Ep 1,12 par la vertu de l'Esprit-Saint. » Discours d’ouverture du Concile Vatican II,Discours de S. S. Jean XXIII à l'issue de la cérémonie du 11 octobre 1962 Concile Vatican II, constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes n°93 Concile Vatican II, constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes n°93 Encyclique Redemptoris Missio, Bienheureux Jean-Paul II, Sur la valeur permanente du précepte missionnaire, 1990, n°26 Vous pouvez consulter de nombreuses photos et documents à propos de cet événement vécu par plusieurs fidèles laïcs et ordonnés de notre diocèse sur le site du diocèse : http://catho04.cef.fr/
|
|
|
« Dans ces jeunes églises, la vie du peuple de Dieu doit acquérir sa maturité dans tous les domaines de la vie chrétienne, qui doit être renouvelée selon les dispositions de ce Concile; les assemblées de fidèles deviennent de jour en jour plus consciemment des communautés de foi, de liturgie et de charité; par leur activité civile et apostolique les laïcs travaillent à instaurer dans la cité un ordre de charité et de justice ; les moyens de communication sociale sont employés de manière opportune et prudente grâce à une vie vraiment chrétienne, les familles deviennent des séminaires d'apostolat des laïcs et de vocations sacerdotales et religieuses. La foi enfin est enseignée au moyen d'une catéchèse adaptée, elle est célébrée dans une liturgie conforme au génie du peuple, et, par une législation canonique convenable, elle passe dans les institutions honorables et dans les coutumes locales. » Stéphane Ligier, prêtre « « Le texte national pour l'orientation de la catéchèse en France et les propositions pour l'organisation de l'action catéchétique en France », publiés le 7 novembre 2006 portent sur la responsabilité catéchétique de l'Église et s'adressent à tous ceux qui se sentent concernés par cette mission essentielle d'éducation de la foi à tous les âges » source internet : http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/publications/revue-des-services-nationaux/service-national-de-la-catechese-et-du-catechumenat.html « Le Texte national pour la catéchèse en France est une réflexion fondamentale répondant à la recommandation du Directoire général de la catéchèse - publié en 1997 et norme pour l'Église universelle - de mettre en œuvre des orientations adaptées à la situation de chaque pays. Ce texte a été voté par l'assemblée plénière de novembre 2005 et a reçu, le 7 octobre 2006, la recognitio - l'approbation - du Saint-Siège. » source internet : http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/publications/revue-des-services-nationaux/service-national-de-la-catechese-et-du-catechumenat.html Après notamment ce texte : « Proposer la foi dans la société actuelle, Lettre aux catholiques de France » Rapport rédigé par Mgr Claude Dagens pour la Conférence des évêques de France, 1996 |
|
|
« Tout apostolat trouve dans la charité son origine et sa force, mais certaines œuvres sont par nature aptes à devenir une expression particulièrement parlante de cette charité: le Christ a voulu qu'elles soient le signe de sa mission messianique (cf. Mt 11,4-5). Stéphane Ligier, prêtre Fête de la solidarité, 17 septembre 2011, photos : http://www.catho04.fr/diaconia2013/11-09-17/index.html La première vidéo a été projetée lors de la journée de la solidarité : « Rencontres, entre fragilités et espérance » à voir sur internet : http://vimeo.com/30183526; la seconde a été projetée le 3 avril 2012 lors de la journée de récollection, vous pouvez consulter l’article à : http://www.catho04.fr/evenement/12-04-03-messe-chrismale/ et voir la vidéo : « le souci de l’Autre » à http://www.youtube.com/watch?v=Exoh4kP-AeE; ces deux vidéos ont été réalisées par l’association « les films de la calade ». Chasteté entendu dans un sens plus large que continence sexuelle. Il s’agit d’une chasteté où l’autre reste vraiment un autre que moi-même dans sa pleine liberté sans utiliser ses fragilités pour lui mettre la main dessus et le manipuler au grès de mes désirs, de mes besoins, de mes envies. Une chasteté qui combat en moi le sentiment de toute puissance. Rassemblement des 27 et 28 septembre 2008 à Sisteron, textes et photos sur http://www.catho04.fr/ecclesia/
|
|
« La Vierge Marie en effet, qui, lors de l'Annonciation faite par l'ange, reçut le Verbe de Dieu à la fois dans son cœur et dans son corps, et présenta au monde la vie, est reconnue et honorée comme la véritable Mère de Dieu et du Rédempteur. Rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils, unie à lui par un lien étroit et indissoluble, elle reçoit cette immense charge et dignité d'être la Mère du Fils de Dieu, et, par conséquent, la fille de prédilection du Père et le sanctuaire du Saint-Esprit, don d'une grâce exceptionnelle qui la met bien loin au-dessus de toutes les créatures dans le ciel et sur la terre. Mais elle se trouve aussi, comme descendante d'Adam, réunie à l'ensemble de l'humanité qui a besoin de salut ; bien mieux, elle est vraiment "Mère des membres du Christ"... ayant coopéré par sa charité à la naissance dans l'Église des fidèles qui sont les membres de ce Chef". C'est pourquoi encore elle est saluée comme un membre suréminent et absolument unique de l'Église, modèle et exemplaire admirables pour celle-ci dans la foi et dans la charité, objet de la part de l'Église catholique, instruite par l'Esprit-Saint, d'un sentiment filial de piété, comme il convient pour une mère très aimante. » L’une des grandes particularités de ce concile est de ne pas avoir produit de texte autonome concernant la Vierge Marie à une époque pourtant où de nombreux courants catholiques réclamaient le titre de médiatrice pour Marie. Cette demande n’a pas été honorée pour au moins deux raisons. La première par respect des autres confessions chrétiennes et la seconde est que le terme de médiation ou médiateur a été réservé à la fonction et à la personne de Jésus-Christ. « Mais à présent, le Christ a obtenu un ministère d'autant plus élevé que meilleure est l'alliance dont il est le médiateur, et fondée sur de meilleures promesses. » Jésus-Christ est donc l’unique médiateur entre son Père et l’humanité mais aussi entre les hommes. Son ministère est en forme de croix, une médiation transversale qui nous révèle Dieu en alliance paternelle et une médiation horizontale qui nous révèle une fraternité universelle. Le mystère de Noël que nous célébrons dans quelques jours et que nous méditons depuis le premier dimanche de l’Avent est porteur de cette vie du Christ en forme de croix. Sa mère, Marie reçut par le message de l’ange cette vie en elle du médiateur. À Noël, nous accueillons par Marie la Terre-Promise tellement désirée. Le dialogue fut alimenté sur l’opportunité de faire un texte autonome à propos de Marie. Finalement la décision fut prise de placer un chapitre entier au sein du schéma sur l’Église à propos de la Vierge. Mais là aussi la discussion fut vive pour considérer la place de ce chapitre, voici d’ailleurs l’une des interventions du futur Jean-Paul II à ce propos : « Puisque le schéma sur la Bienheureuse Vierge-Marie, mère, doit être considéré, selon le vote de la majorité du Concile, comme un chapitre du schéma De Ecclesia , il convient de trouver sa juste place dans ce schéma. Et il semble que ce lieu ne se situe pas à la fin. Si le chapitre sur la Bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église était placé comme le chapitre VI de tout le schéma, la doctrine qu'il contient paraitrait être quelque chose d'ajoutée, et peut-être artificiellement annexée à la doctrine de ce schéma. Or, le but de la décision de transférer la doctrine de la Bienheureuse Vierge-Marie, Mère de l'Église, dans le schéma De Ecclesia a été de montrer le lien intime de cette doctrine et la totalité de celle de l'Église, à savoir l'ecclésiologie catholique complète. En effet, Marie ne peut pas être réellement connue et comprise comme mère de l'Église sinon quand on explique la nature même de l'Église, surtout sous son aspect christologique, c'est-à-dire quand l'Église est présentée comme le corps mystique du Christ. Une telle relation Mère-du-Christ avec l'Église sous son aspect maternel suppose que cette doctrine occupe un autre lieu que le dernier. » Nous comprenons la critique du jeune évêque de Cracovie , éviter une espèce de placage artificiel du visage de Marie à propos de la théologie sur l’Église (l’ecclésiologie). Le chapitre VIII de Lumen-Gentium évite cet écueil en articulant finement la place de Marie à la fois Mère du Christ, donc Mère-de-Dieu et Mère-de-l’Église. « La bienheureuse Vierge, de par le don et la charge de sa maternité qui l'unissent à son fils, le Rédempteur, et de par les grâces et les fonctions singulières qui sont les siennes, se trouve également en intime union avec l'Église: de l'Église, selon l'enseignement de saint Ambroise, la Mère-de-Dieu est le modèle dans l'ordre de la foi, de la charité et de la parfaite union au Christ. » Nous savons combien Jean-Paul II avait une dévotion mariale profonde mais ce n’est pas pour cette unique raison qu’il terminait systématiquement ces textes par plusieurs paragraphes à propos de Marie. Il désirait orienter le regard de l’Église vers la vocation de la Vierge, comme le fait l’évangéliste Luc. Certains spécialistes pensent que lorsque saint Luc pense à sa communauté, il évoque Marie pour lui indiquer le chemin de l’Évangile . « À la veille du troisième millénaire, toute l'Église est invitée à vivre plus intensément le mystère du Christ, en collaborant dans l'action de grâce à l'œuvre du salut. Elle le fait avec Marie et comme Marie, sa mère et son modèle. Marie est le modèle de l'amour maternel dont doivent être animés tous ceux qui, associés à la mission apostolique de l'Église, travaillent à la régénération des hommes. C'est pourquoi, " soutenue par la présence du Christ (...), l'Église marche au cours du temps vers la consommation des siècles et va à la rencontre du Seigneur qui vient; mais sur ce chemin (...), elle progresse en suivant l'itinéraire accompli par la Vierge Marie ". » Si je propose ce passage de l’encyclique Rédemptoris-Missio de Jean-Paul II, c’est que l’œcuménisme appartient à la mission de l’Église. Non pas que l’Église doive transformer protestants, orthodoxes, anglicans en fervents catholiques romains mais la mission est intimement liée à l’unité et à la communion. Comment pouvons-nous témoigner d’un Dieu-Communion en lui-même et avec l’humanité, si nous-mêmes nous vivons dans la division , les querelles intestines, la suspicion, l’indifférence, la méfiance, et même l’hostilité mutuelle des autres chrétiens ? « Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. » L’œcuménisme nous interpelle pour éviter de confondre unité et uniformité et communion vitale dans la diversité. La dévotion à la Vierge-Marie est l’un des lieux de dialogue œcuménique très fécond. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la séparation entre catholiques et protestants ne se joue pas sur le fait que les premiers croiraient en la Vierge-Marie et les seconds s’y refuseraient. Les dévotions mariales sont très différentes d’une Église à l’autre et il est certain qu’elles sont fortement développées chez les catholiques et les orthodoxes avec des expressions différentes, peu apparentes dans les Églises de la Réforme et pratiquement inexistantes dans les communautés évangéliques. Ces différences de dévotions sont l’occasion d’échanges profonds à propos de questions dogmatiques : la conception virginale de Jésus, l’Immaculée-Conception, l’Assomption , Marie-Mère-de-Dieu … En cette année de la foi, dans notre diocèse, nous pourrions intensifier le dialogue œcuménique avec l’Église réformée, les nombreuses communautés évangéliques, la communauté mennonite à Lurs, l’aumônerie protestante de la prison, la communauté orthodoxe de Manosque, la communauté du Moulin à Valernes, les communautés adventistes et j’en oublie sûrement. Ne soyons pas naïfs, ces approches de la personne de Marie ne sont pas qu’intellectuelles pour théologiens désœuvrés. Elles touchent à l’existentiel des chrétiens car Marie est comme l’icône de l’Église-du-Christ. La manière donc de se situer d’une communauté par rapport à Marie dit sa manière de se situer comme Église dans le « paysage chrétien » et dans notre monde. « Cependant, tout comme dans le ciel où elle est déjà glorifiée corps et âme, la Mère de Jésus représente et inaugure l'Église en son achèvement dans le siècle futur, de même sur cette terre, en attendant la venue du jour du Seigneur (cf. 2P 3,10), elle brille déjà comme un signe d'espérance assurée et de consolation devant le peuple de Dieu en pèlerinage. Le saint Concile trouve une grande joie et consolation au fait que, parmi nos frères séparés, il n'en manque pas qui rendent à la Mère du Seigneur et Sauveur l'honneur qui lui est dû, chez les Orientaux en particulier, lesquels vont, d'un élan fervent et d'une âme toute dévouée, vers la Mère-de-Dieu toujours Vierge pour lui rendre leur culte. Que tous les chrétiens adressent à la Mère-de-Dieu et des hommes d'instantes supplications, afin qu'après avoir assisté de ses prières l'Église naissante, maintenant encore, exaltée dans le ciel au-dessus de tous les bienheureux et des anges, elle continue d'intercéder près de son Fils dans la communion de tous les saints, jusqu'à ce que toutes les familles des peuples, qu'ils soient déjà marqués du beau nom de chrétiens ou qu'ils ignorent encore leur Sauveur, soient enfin heureusement rassemblés dans la paix et la concorde en un seul peuple de Dieu à la gloire de la Très-Sainte et indivisible Trinité. » Stéphane Ligier, prêtre Le texte final : Lumen-Gentium, comptera huit chapitres dont le dernier s’intitule : « La Bienheureuse Vierge-Marie, Mère-de-Dieu dans le mystère du Christ et de l’Église » Interventions de Karol Wojtyla au concile Vatican II, Mgr Dominique Lebrun, éd. parole et silence, p.57-58, 2012 Jean-Paul II écrira une encyclique à propos de Marie : Rédemptoris-Mater donné le 25 mars 1987, en la solennité de l'Annonciation du Seigneur et d’autres textes, particulièrement une très belle lettre apostolique sur la vocation de la femme : Mulieri-Dignitatem, donné le 15 août 1988, en la solennité de l'Assomption de la Bienheureuse-Vierge-Marie. Vous pouvez retrouver ces différents textes : http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/index_fr.htm « Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. » Luc 2,19, traduction Bible-de-Jérusalem Lettre encyclique de Jean-Paul II, la mission du Rédempteur, Redemptoris-Missio, n° 92,7/12/1990, XXVe anniversaire du décret conciliaire Ad-Gentes. Le 21 novembre 1964 le Concile adopte le décret sur l'œcuménisme par 2137 voix pour sur 2148. Il se nomme : Unitatis-Redintegratio, en effet il commence ainsi : « Promouvoir la restauration de l'unité entre tous les chrétiens est l'un des buts principaux du saint Concile œcuménique de Vatican II. Une seule et unique Église a été instituée par le Christ Seigneur. Et pourtant plusieurs communions chrétiennes se présentent aux hommes comme le véritable héritage de Jésus-Christ. Tous certes confessent qu'ils sont les disciples du Seigneur, mais ils ont des attitudes différentes. Ils suivent des chemins divers, comme si le Christ lui-même était partagé. Il est certain qu'une telle division s'oppose ouvertement à la volonté du Christ. Elle est pour le monde un objet de scandale et elle fait obstacle à la plus sainte des causes: la prédication de l'Évangile à toute créature. » n°1 Diabolon signifie celui qui désunit. Le sumbolos (symbole) est pour nous le Christ, celui qui unit l’humanité avec son Père et les hommes entre eux. La prière du Christ pour l’unité, Abbé Paul Couturier (1881-1953, prêtre du diocèse de Lyon et grand promoteur de l’unité des chrétiens, à n’en pas douter le Concile a bénéficié de son travail œcuménique) Expression d’ailleurs maladroite qui signifie sûrement : « croire en la virginité de Marie » car bien entendu aucun chrétien ne croit en Marie comme l’on croit en Dieu et aucun chrétien ne refuse le fait que Marie soit bien la mère de Jésus-Christ. Le travail passionné et passionnant du Groupe-des-Dombs composé de théologiens des différentes Églises demeure pertinent, notamment « Marie dans le dessein de Dieu et la communion des saints, Groupe-des-Dombes, 195 p., 1999, éd. Bayard. Site : http://www.groupedesdombes.org/
|
|