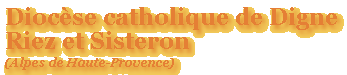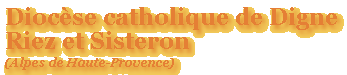Dons et greffes d’organes,
la position de l’Église catholique
« Une forme éloquente de fraternité,
acte d’une grande générosité,
acte de grand amour, l’amour qui donne la vie aux
autres » ;
« Parmi les nombreux résultats remarquables
de la médecine moderne, les avancées dans
les domaines de l’immunologie et de la technologie
chirurgicale ont rendu possible l’usage thérapeutique
de transplantations d’organes et de tissus. C’est
à coup sûr un motif de satisfaction que de
nombreuses personnes malades qui, récemment encore,
ne pouvaient qu’attendre la mort ou au mieux espérer
une existence pénible et restreinte, puissent maintenant
se rétablir plus ou moins totalement grâce
au remplacement d’un organe malade par le don d’un
organe sain ». C’est par ces paroles que le
pape Jean-Paul II accueillait les participants d’un
congrès international sur les transplantations d’organes
à Rome le 20 juin 1991.
En 1995 dans un important texte de son pontificat, l’encyclique,
« L’Évangile de la vie », sur la
valeur et l’inviolabilité de la vie humaine
du sein maternel au terme naturel de sa vie terrestre, il
notait : « L’héroïsme au quotidien,
fait de petits ou de grands gestes de partage qui enrichissent
une authentique culture de la vie. Parmi ces gestes, il
faut particulièrement apprécier le don d’organes,
accompli sous une forme éthiquement acceptable, qui
permet à des malades parfois privés d’espoir
de nouvelles perspectives de santé et même
de vie. » (n°86).
Les évêques de France en octobre 1993 dans
un document intitulé : « Solidarité
et respect des personnes dans les greffes de tissus et d’organes
» rappelaient que l’Église catholique
accepte le principe des prélèvements et des
greffes et voit dans le don librement consenti de tissus
ou d’organes, un geste de solidarité et de
fraternité.
De même, en janvier 1996, la commission sociale de
l’épiscopat français, lançait
un appel intitulé : « Le don d’organes
: une forme éloquente de fraternité. ».
En lançant cet appel, la commission sociale ne cherchait
pas à faire pression sur les consciences mais la
mort pouvant frapper de manière inopinée,
bien avant une vieillesse avancée, nous-mêmes
ou nos proches, les évêques nous rappellent
que la mort peut, au-delà de la douleur légitime
qu’elle inspire, être l’occasion, par
le don d’organes, d’un acte de solidarité
de très grande valeur. Cet appel des évêques
nous invite à une réflexion personnelle, à
des échanges en famille et à l’intérieur
des communautés paroissiales et autres sur la possibilité
d’un don d’organes. C’est une réflexion
de ce type que nous avons ce soir.
L’Église catholique accepte les prélèvements
et les greffes de tissus (cornée, valve cardiaque,
os, peau..) et d’organes (cœur, foie reins..)
humains. La présente communication ne porte pas sur
le don du sang, tissu facile à recueillir et rapidement
renouvelé après le prélèvement,
ni sur celui des cellules reproductrices (sperme et ovules)
porteuses de l’identité d’un nouvel être
et qui posent d’autres questions éthiques spécifiques
que je n’aborderai pas ici car tel n’est pas
le sujet.Le prélèvement et la greffe de tissus
embryonnaires ou fœtaux posent des problèmes
spécifiques qui ne seront pas non plus abordés
ici.
Sur le plan théorique il n’y a jamais eu d’objection
de principe aux prélèvements de tissus et
d’organes. Le pape Pie XII, dès 1956, approuva
le prélèvement et la greffe de cornées
au bénéfice d’aveugles ou de personnes
menacées de cécité. Depuis lors, comme
nous l’avons vu, les autorités ecclésiales
ont toujours soutenu, voire encouragé, cette pratique,
du don d’organes.
L’Église catholique se retrouve bien dans les
dispositions de la loi du 29 juillet 1994, relative à
la bioéthique, modifiée le 6 août 2004
concernant le don et l’utilisation des éléments
et produits du corps humain.
Dans l’anthropologie chrétienne c'est-à-dire,
dans la vision chrétienne de l’homme, l’être
humain est un être donné : nous ne nous sommes
pas faits nous-mêmes, la vie nous l’avons reçue
d’autres, d’un Autre. Pour rester fidèles
à notre nature d’être donné, l’homme
est appelé à faire de sa vie un don : le don
d’organe est une des modalités possibles de
ce don. Nous sommes mis au défi d’aimer notre
prochain ; avec l’avènement des transplantations
d’organes, l’homme a trouvé une manière
nouvelle de se donner, de donner une part de lui-même
pour que d’autres puissent continuer à vivre.
Le don d’organes n’est il pas une manière
nouvelle, originale, d’aimer et comme nous y invite
Jésus d’aimer jusqu’au bout ? Pour les
chrétiens, le don de lui-même qu’a fait
Jésus est le point de référence essentiel
et l’inspiration de cet amour qui peut nous pousser,
non pas nous obliger, à donner un ou plusieurs de
nos organes, « manifestation de généreuse
solidarité extrêmement éloquente dans
une société qui est devenue utilitariste à
l’extrême et moins sensible au don généreux.
» (Jean-Paul II).
Pour le pape, toute transplantation d’organes tire
son origine dans une décision d’une grande
valeur éthique : la décision d’offrir
sans récompense une partie de son corps pour la santé
et le bien être d’une autre personne. C’est
précisément ici que réside la noblesse
de ce geste, un geste qui est une véritable acte
d’amour. Il ne s’agit pas seulement de donner
quelque chose qui nous appartient, mais de donner quelque
chose de nous même, car, en raison de son union substantielle
avec une âme spirituelle, le corps humain ne peut
pas être considéré seulement comme un
ensemble de tissus, d’organes et de fonction mais
il est partie constitutive de la personne qui se manifeste
et s’exprime à travers lui.
L’Église catholique nous invite à nous
réjouir de ce que la médecine ait trouvé
dans la transplantation d’organes une nouvelle manière
de servir la famille humaine mais la transplantation d’organes
pose aussi des questions de nature éthique, légale
et sociale. L’altruisme, les possibilités scientifiques
ne sont pas les seuls critères d’appréciation
en ce domaine.
Je voudrais ici, très brièvement, donner
les exigences éthiques que l’Église
catholique a toujours rappelées concernant les dons
de tissus et d’organes et les greffes :
I. Le don d’organes :
Il faut distinguer le don de tissus ou d’organes fait
par une personne vivante et les prélèvements
d‘organes sur une personne décédée
:
Les donneurs vivants :
Depuis les débuts des techniques de prélèvement
et de greffe, la France a fait le choix d’éviter
de s’adresser aux donneurs vivants. La législation
française est très restrictive en ce qui concerne
les prélèvements sur les personnes vivantes.
Dans la perspective chrétienne, plusieurs conditions
sont requises pour faire un don d’organe de son vivant.
D’abord, il doit s’agir d’un vrai don,
c'est-à-dire qu’il doit être gratuit,
le donneur doit être capable d’apporter librement
son consentement après une information suffisante
sur les bénéfices attendus pour le receveur
et les conséquences sur le donneur. Aucune pression,
aucun chantage d’ordre affectif ne doit peser sur
sa décision Celui-ci doit être capable d’apporter
personnellement son consentement ce qui exclut de réaliser
des prélèvements qui provoqueraient une mutilation,
sur des enfants et des personnes juridiquement incapables,
le don ne doit pas nuire à la vie du donneur et il
doit pouvoir poursuivre décemment un service professionnel
normal, le bénéfice attendu par le receveur
doit être en juste proportion avec les dommages encourus
par le donneur, et ne pouvoir être obtenu par d’autres
moyens thérapeutiques.
Les prélèvements sur les personnes
décédées :
Pour prélever un ou des organes sur une personne
décédée, la mort doit au préalable
avoir été dûment constatée. Depuis
1968, la plupart des pays ont adopté un critère
neurologique de la mort, celui de la cessation irréversible
de toute fonction cérébrale (mort cérébrale
) : « On explique la validité de ce critère
en reconnaissant que cette partie centrale du système
neurocérébral commande toutes les fonctions
vitales ainsi que leur unité qui est essentielle
à l’existence d’une personne humaine
» (Olivier de Dinechin), à cela doivent correspondre
des signes cliniques complémentaires et observables
: électro-encéphalogramme plat, la nullité
de l’électro-encéphalogramme devant
être constatée à plusieurs moments différents
comme l’exige la législation française,
arrêt des mouvements oculaires…
La perspective de procéder à des prélèvements
ne doit pas bien sûr conduire à un arrêt
prématuré des traitements : « Le respect
dû à la vie humaine interdit absolument de
la sacrifier, directement et positivement, fût-ce
au bénéfice d’un autre être humain
qu’on croirait avoir des raisons de privilégier.
», affirmait Jean-Paul II. La plus élémentaire
sagesse impose que les médecins qui sont appelés
à constater le décès de la personne
n’appartiennent pas à l’équipe
qui réalisera le prélèvement d’organes.
Les prélèvements doivent être réalisés
d’une manière qui témoigne du respect
dû au corps du défunt, et résulter d’un
don fait librement dans un esprit de solidarité avec
ceux qui souffrent. Jean-Paul II demande à ce que
la transplantation soit le résultat d’ «
une décision antérieure, explicite, libre
et consciente, de la part du donneur ou de quelqu’un
qui représente légitimement le donneur, généralement
les parents les plus proches. » ; Pie XII recommandait
un accord exprès ou tacite, de « ceux à
qui incombe le soin du défunt, les proches parents
d’abord. »
Les évêques de France affirment qu’ «
Il serait inhumain de procéder à des prélèvements
en cas d’opposition, d’expression d’une
profonde répugnance ou d’intense désarroi
de la famille, ou à son insu. »
La loi française va dans ce sens : tout en maintenant
l’idée de la loi Caillavet de 1976 selon laquelle
tout citoyen qui n’avait pas manifesté son
avis de son vivant était présumé consentant,
elle prévoit que le prélèvement peut
être effectué dès lors que la personne
concernée n’a pas fait connaître, de
son vivant, le refus d’un tel prélèvement.
Ce refus peut être exprimé par tout moyen,
notamment par l’indication de sa volonté sur
un registre national automatisé. Si le médecin
n’a pas directement connaissance de la volonté
du défunt, il doit s’efforcer de recueillir
auprès de ses proches l’opposition au don d’organes
éventuellement exprimée de son vivant par
le défunt. Les proches sont informés de leur
droit à connaître les prélèvements
effectués. Le médecin doit donc se renseigner
auprès des proches sur ce qu’aurait éventuellement
souhaitée la personne décédée
: art. L 1232-1 du Code de la santé publique.
Le père Dinechin rappelle que le corps d’une
personne décédée ne tombe pas ipso
facto dans le domaine public : il existe toujours pour ses
proches et il garde à leurs yeux une signification
qu’il importe de respecter.
II. Les greffes :
Un mot seulement sur les greffes : il n’est pas toujours
évident d’envisager l’idée de
vivre en portant dans son corps un organe qui vient d’une
autre personne vivante ou défunte, il y a toujours
possibilité de rejet du greffon, il y a un sentiment
de dette sinon de culpabilité envers le donneur,
il n’est pas toujours bien supporté de vivre
« grâce » à la mort d’un
autre c’est pourquoi aucun malade n’est obligé
de recourir à un moyen thérapeutique qu’il
lui imposerait une charge qu’il trouverait extrême
pour lui-même ou pour autrui. Mais, dans bien des
cas la greffe de tissus ou d’organes représente
un bienfait pour la vie et la santé du receveur.
C’est pourquoi l’Église catholique invite
l’opinion publique et chacun en particulier à
consentir au don de tissus ou d’organes post-mortem,
dans un esprit de solidarité avec ceux qui souffrent.
Tout greffon cependant ne peut être reçu que
comme un don et jamais comme un dû. Les malades peuvent
seulement exiger que la répartition se fasse selon
des règles claires et équitables et non pas
en fonction du rang social, de la fortune personnelle, des
liens affectifs noués avec le médecin, de
l’origine ethnique des habitants de notre pays.
Prélèvements et greffes peuvent devenir une
des manifestations de la fraternité et de la solidarité
humaines s’ils procèdent de dons librement
consentis, et où ils sont réalisés
dans un plein respect de toutes les personnes concernées.
L’Église catholique rappelle :