
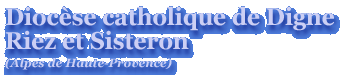

Recherchez votre paroisse
| |
||||
|
|
 |
Le diocèse de Bafia | vivre... | |
|
Entre le 2 février et le 5 mars 2004, dans le cadre des relations et collaborations inspirées par le jumelage entre les deux diocèses, des déplacements ont eu lieu dans le sens Digne-Bafia, en attendant la visite en retour, de Mgr Jean-Marie Bala, en juin 2004. C'est avec beaucoup d'intérêt qu'on va pouvoir trouver ici le compte rendu que Mr Jean Conrad, directeur de l'enseignement catholique nous fait de sa visite. |
||||
|
Neuf rangées de trois bancs derrière
d'étroits bureaux. Quatre élèves par banc.
Cela fait cent huit. J'ai compté cent huit élèves
dans la première classe visitée, une classe de sixième
dans un collège à l'excellente réputation,
à Bafia, bourgade de la Province du Centre au Cameroun,
à deux heures de route de Yaoundé, dans la savane
où coule le Mbam, affluent du Sanaga. Deux professeurs
se sont partagés les élèves d'un collègue
absent. Ce qui ramène tout de même l'effectif habituel
à plus de soixante cinq enfants par classe. Les enfants et les jeunes sont attentifs à l'enseignement et appliqués. L'école est vécue par ceux qui peuvent y aller comme la promesse d'une promotion sociale espérée. Les maîtres sont majoritairement des hommes, la plupart des femmes ayant en charge la vie domestique et les cultures vivrières. Les maîtres sont respectés. Ils s'expriment sans devoir hausser le ton et font un grand usage du tableau et de la craie. L'on parle français mais l'on se salue, ici ou là, en anglais. Le bilinguisme est courant, en sus des dialectes locaux habituels. L'uniforme, très répandu, confère à l'ensemble une unité impressionnante. Il évite les surenchères et querelles vestimentaires, manifeste l'appartenance à un établissement qui procure souvent tissu et patron aux familles, et témoigne de la fierté de le fréquenter. Les maximes ou les mots affichés sur les murs, sur autant de panneaux édifiants, incitent à une morale commune: « Travail - Succès - Éclat » ou « Enthousiasme - Réussite - Volonté » ou ceci encore, vu dans une classe de CE : « Monsieur Basile ne connaît pas le marabout. La vraie magie c'est le travail. Il faut prier Dieu. » Et l'on prie souvent, en effet... Les murs des écoles sont en parpaings, en briques de terre, ou en boue séchée. Les charpentes sont recouvertes de tôle ou d'aluminium. La poussière en saison sèche et les précipitations en saison des pluies endommagent très vite des locaux trop exigus. Il faut entretenir, réparer et bâtir pour satisfaire les demandes d'inscription de plus en plus nombreuses. Une simple classe coûte un million et demi de francs CFA, soit environ deux mille euros, tandis que les familles payent autour de sept mille cinq cent francs CFA pour une année de scolarité. Ce sont là les seules ressources pour financer les charges pédagogiques, immobilières et de fonctionnement. L'État ne donne rien à l'école catholique qui accueille pourtant près de la moitié des enfants scolarisés. La qualité éducative et le succès aux examens sont les premiers ingrédients de son succès et la stratégie retenue, pour augmenter la demande d'inscription et les ressources indispensables à un bon fonctionnement est celle de l'excellence en tous domaines : instruction, éducation, gestion, morale. Il y a, en filigrane de ce choix exigeant, non seulement la conscience de contribuer utilement au développement par l'éducation, mais aussi celle, qui lui est d'ailleurs liée, d'une responsabilité particulière de la formation humaine globale de ceux qui, un jour prochain, seront les cadres et dirigeants du pays. Les journées scolaires sont organisées en trois séquences de deux heures, de 7 h 30 à 14 h 30 au plus tard, coupées par deux longues récréations. Les élèves et les maîtres rentrent l'après-midi chez eux, dans un rayon d'une dizaine de kilomètres. Ils vont, travailler aux champs, avec leur machette et leur houe, jusqu'à la nuit qui tombe vite à quelques degrés au nord de l'équateur. Ils vont et viennent à pied, sac au dos ou sur la tête. Les élèves sont pour la plupart démunis des fournitures scolaires élémentaires : cahiers, crayons. Ils apprennent à ne pas gaspiller le peu qu'ils ont. Les livres sont rares, anciens et toujours chers. Faute de moyens le matériel pédagogique est insuffisant et non actualisé. Ce manque est douloureusement ressenti. Il est en partie comblé par l'ingéniosité, le travail en équipe, le partage d'expériences ou la construction à plusieurs de séquences de cours qui sont des aides précieuses à l'invention pédagogique. La bonne volonté, la disponibilité et l'acharnement au travail y réussissent des prouesses. La demande de rencontres pédagogiques et de formation est importante. Pour parler de son métier. Pour renforcer ses compétences et en acquérir de nouvelles. Pour trouver aussi les moyens d'un développement durable, par delà toute aide ponctuelle venue de l'extérieur. Pour dire aussi le sens et la force de son engagement dans un enseignement catholique vécu intensément par la plupart comme une mission d'Église. Mais le déplacement coûte cher lorsqu'il faut prendre l'autobus ou le taxi pour rejoindre le siège diocésain et se nourrir hors de chez soi. Les maîtres ne sont rémunérés qu'à partir des ressources versées par les familles, centralisées au secrétariat pour l'Éducation. Ils ne peuvent quelquefois être payés que neuf mois sur douze, sur une base mensuelle qui se situe pour la plupart d'entre eux entre quarante mille et soixante dix mille francs CFA, soit au mieux une centaine d'euros. S'ils comparent leur situation à celle qu'ils imaginent de leurs collègues occidentaux, ils peuvent exprimer un sentiment de frustration parfois tempéré par ce qu'ils devinent lucidement de la dégénérescence occidentale du lien social. Mais le mythe de l'eldorado européen résiste encore à tous les démentis. L'on m'a souvent demande comment venir en France et y travailler. Ils attendent beaucoup les uns des autres dans un contexte où la solidarité n'est pas un vain mot. Mais ils attendent aussi beaucoup de ceux qui, ailleurs, ont infiniment plus de richesses matérielles qu'eux et pourraient en partager un peu. L'équipe renouvelée du secrétariat à l'Éducation, l'équivalent de la direction diocésaine, doit gérer le fonctionnement matériel des écoles, l'emploi des personnels et le projet éducatif de l'enseignement catholique articulé cette année autour des « sept facteurs de la réussite » proposés par Mgr Bala, évêque de Bafia. Chacun de ces facteurs importe et ils doivent être optimisés simultanément : l'affectif, l'éthique, l'économique, le social, le psychologique, le pédagogique, le spirituel. Nous avons travaillé ensemble, avec une centaine de chefs d'établissements et d'enseignants, à la mise en œuvre concrète de ces facteurs par les maîtres, les élèves, les familles et le secrétariat à l'Éducation. La clarté des questions posées, la précision des réponses apportées et la franchise des échanges ont forcé mon admiration. La joie aussi, celle qui naît de la rencontre et des paroles offertes, de l'enthousiasme partagé et d'un sens très aiguisé de l'accueil, de la relation et de la fête. Le diocèse de Digne et le diocèse de Bafia sont
jumelés. L'Enseignement catholique d'Aix-Digne et celui
de Bafia ont beaucoup à se dire et à partager dans
une démarche de connaissance mutuelle et de réciprocité
des échanges qui devrait ne pas s'en tenir au volet matériel.
De nombreux ponts restent à construire entre les personnes,
entre les établissements et entre les diocèses pour
un surcroît d'humanité dont nous ne serions certainement
pas, à terme, les moindre bénéficiaires.
C'est l'une de nos manières de vivre aujourd'hui notre
très profond attachement aux relations internationales
et à l'ouverture à l'universel. Jean Conrad, Direction Diocésain de l'Enseignement
Catholique
|
||||
| La lettre d'infos |
| Agenda |
| Écrivez-nous | |
| Plan du site | |
| Le site de A à Z | |
| Votre paroisse | |
| Mentions légales |
© 2002 Diocèse catholique de Digne, Riez et Sisteron - Réalisation Sudway Internet