
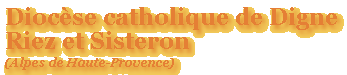
| |
||||
|
|
 |
dialoguer... | ||
| Billet spirituel LETTRES DE SAINTE THERESE DE LISIEUX |
||||
|
| ||||
| octobre 2009 lire également: janvier - février - mars - avril - juin - juillet - aout - septembre - octobre - novembre billets spirituels de 2008: Bernadette |
||||
| LETTRES DE SAINTE THERESE DE LISIEUX (10)
Le postulat (suite)
Lettres 46 à 80 (9 avril 1888 – 10 janvier 1889)
Sœur Agnès de Jésus (74, 76)
Jésus ne saurait refuser les «piqûres d’épingles» que mendie Thérèse. Six mois plus tard elle écrit à Agnès : « Jésus me crible de piqûres d’épingles. » (L.74)
« La pauvre petite balle n’en peut plus, de toutes parts elle a de tout petits trous qui la font souffrir que si elle n’en avait qu’un grand ! Rien auprès de Jésus, sécheresse !... sommeil !... Mais au moins c’est le silence !... le silence fait du bien à l’âme… » Pour la première fois Thérèse parle des religieuses en des termes inattendus : « Les créatures, oh ! les créatures… Celles qui m’entourent sont bien bonnes, mais il y a je ne sais quoi qui me repousse !... Je ne puis vous faire d’explication, comprenez votre petite âme. » Thérèse a sans doute un gros besoin d’affection et les sœurs plus âgées ne la dorlotent pas, à moins qu’elle n’ait entendu des propos blessants ou… que la vie communautaire soit éprouvante… très éprouvante.
Thérèse réclamait des piqûres d’épingles. Elle les obtient et se plaint. « Comprenez !... Quand c’est le doux ami qui pique lui-même sa balle, la souffrance n’est que douceur, sa main est si douce ! Mais les créatures ! » Thérèse n’envisageait pas que les piqûres pouvaient venir des autres. Ce qu’elle appelait « piqûres d’épingles » était une expérience toute intérieure.
Qu’en est-il alors de l’amour qui se démontre par le non attachement aux choses sensibles ? Thérèse comprend que les piqûres intérieures (« C’est le doux ami qui pique lui-même ») et extérieures (« s’il ne pique pas directement sa petite balle, c’est bien lui qui conduit la main qui la pique ») sont l’œuvre du Bien-aimé. Alors, la plainte cesse. « Je suis heureuse de souffrir ce que Jésus veut que je souffre. » Thérèse progresse dans le renoncement au signe sensible : « Puisque Jésus veut dormir pourquoi l’en empêcherais-je ? » Elle évoque certainement le récit de la barque ballotée par la tempête avec à son bord les disciples effrayés et Jésus assoupit. Mais plus encore le Cantique des cantiques : « N’éveillez pas, ne réveillez pas mon amour, avant l’heure de son bon plaisir. »
Dans un accent de total sincérité elle met à nu son désir le plus profond : « Je veux être indifférente aux choses de la terre, que m’importe toutes les beautés créées, je serais malheureuse en les possédant, mon cœur serait si vide !... C’est incroyable comme mon cœur me paraît grand quand je considère tous les trésors de la terre, puisque je vois que tous réunis ne pourraient le contenter. » Rien en ce monde ne peut contenter son cœur. C’est donc qu’il est plus vaste que le monde. Mais « quand je considère Jésus comme il me paraît petit. » Son cœur est trop étroit pour aimer comme elle le voudrait. Elle le veut plus grand et plus large : « Je voudrais tant l’aimer !...L’aimer plus qu’il n’a jamais été aimé !... » L’aimer d’un amour exclusif. Thérèse souhaite aussi « essuyer les petites larmes » de Jésus dues à la conduite des pécheurs. Un mouchoir n’essuie pas le divin visage. Pour que les pleurs cessent il faudrait que les pécheurs se détournent de leur méchanceté. « Je voudrais convertir tous les pécheurs de la terre et sauver toutes les âmes du purgatoire ! »
Quelle véhémence ! Agnès « va rire. » Thérèse est sérieuse. « Je sais que c’est une folie mais pourtant je voudrais qu’il en soit ainsi afin que Jésus n’ait pas une seule larme à verser. » Tous les efforts entrepris pour la conversion des pécheurs doivent échapper au regard du monde pour n’être connus que de Jésus seul. « Priez pour que le petit grain de sable devienne un atome visible seulement aux yeux de Jésus. »
La prise d’habit était fixée au 9 janvier et Thérèse s’en réjouissait. L’échéance est reculée d’un jour. « Jésus a sans doute trouvé que la date du 9 était trop ravissante, il ne veut rien de ravissant pour sa petite balle. » (L. 76). Cette déception est vite dépassée à l’école de saint Jean de la Croix qui apprend à « mortifier… la joie » c’est-à-dire à purifier « cette passion » afin qu’elle ne détourne pas de l’unique nécessaire, Dieu. « Jésus seul est ravissant dans toute la force du terme, et il veut montrer à sa petite balle qu’elle se tromperait en cherchant autre part une ombre de beauté qu’elle prendrait pour la beauté même. » Thérèse s’applique avec des mots d’une grande simplicité l’enseignement austère du saint Docteur : « Toute la beauté des créatures, comparées à l’infinie beauté de Dieu, est une souveraine laideur… L’âme attachée à la beauté d’une créature, quelle qu’elle soit, contracte aux yeux de Dieu une souveraine laideur. Or une âme entachée de laideur ne peut se transformer en la beauté qui est Dieu, parce que la laideur est incompatible avec la beauté. » Il ne faut pas borner le sens de « créature » aux êtres humains. Ce terme s’adapte à toute réalité de ce monde y compris au fameux « 9 janvier » attendu avec impatience. Le déplacement de la date permet à Thérèse de retirer sa joie de l’événement pour la placer en Dieu. «Elle se tromperait en cherchant autre part une ombre de beauté (9 janvier) qu’elle prendrait pour la beauté même (Dieu). » Jésus « est bon » de lui permettre de ne s’attacher « à AUCUNE chose créée. »
Pourquoi cette privation de joie (9 janvier remis à une date ultérieure) est-elle la manifestation de la bonté de Jésus pour elle ? Thérèse se connaît bien. Elle n’est pas un colosse taillé dans le bronze. « Jésus sait bien que si il me donnait seulement une ombre de bonheur, je m’y attacherais avec toute l’énergie, toute la force de mon cœur. » Elle n’écrit pas « une once » mais « une ombre ». Tout bonheur qui n’est pas la possession du Bien-aîmé n’est qu’une ombre. Pour saisir ce qu’elle tente de formuler prenons un exemple. Le pèlerin parcourt le désert pour atteindre une terre plantureuse. La chaleur l’accable. En chemin, il voit une oasis. Il s’y arrête pour reprendre des forces. Quel délice ! Ombre, repos, nourriture et rafraîchissement. La tentation est d’oublier que ce n’est qu’une étape. On y trouve un tel confort qu’on s’y installe. Ainsi l’étape est confondue avec le terme du voyage. Thérèse est capable de courir après les oasis. Jésus l’en détourne pour qu’elle n’y plante pas sa tente. « Cette ombre il me la refuse, il aime mieux me laisser dans les ténèbres que de me donner une fausse lueur qui ne serait pas lui ! » Ces « ténèbres » intérieures lui barrent l’accès aux ombres de bonheur. « Puisque je ne puis trouver aucune créature qui me contente, je veux tout donner à Jésus, je ne veux pas donner à la créature seulement un atome de mon amour. » Thérèse sait ce qu’elle lâche sans encore saisir celui qu’elle désire : « Puisse Jésus me donner toujours de comprendre que lui seul est le bonheur parfait même quand lui-même paraît absent ! »
Elle résume assez bien la situation en écrivant « J’ai été privée de toute consolation ; je remercie Jésus qui trouve cela bon pour mon âme, et puis, peut-être que si il me consolait je m’arrêterais à ces douceurs, mais il veut que tout soit pour lui !... Eh bien, tout sera pour lui, tout, même quand je ne sentirai rien à pouvoir lui offrir. » Thérèse n’a rien à offrir à Jésus. Vraiment ? Et ce « rien » qu’en fait-elle ? « Je lui donnerai ce rien ! »
Dans l’article précédent, nous présentions les conseils de saint Jean de la Croix pour se détacher rapidement du sensible et s’attacher à Dieu. Il ajoutait : « On y trouvera très promptement beaucoup de plaisirs et de consolations. » Nous nous demandions si Thérèse vérifierait cet enseignement ? Elle nous donne un premier élément de réponse: « Si Jésus ne me donne pas de consolation, il me donne une paix si grande qu’elle me fait plus de bien !... » La paix est une consolation plus fine que celles que recherchaient Thérèse.
Il faut le rappeler sans cesse : Thérèse a tout juste 16 ans. Thierry Cazes |
||||
© 2002 Diocèse catholique de Digne, Riez et Sisteron - Réalisation Sudway Internet