
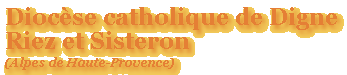
| |
||||
|
|
 |
dialoguer... | ||
| Billet spirituel LETTRES DE SAINTE THERESE DE LISIEUX |
||||
|
| ||||
| novembre 2009 lire également: janvier - février - mars - avril - juin - juillet - aout - septembre - octobre - novembre billets spirituels de 2008: Bernadette |
||||
| LETTRES DE SAINTE THERESE DE LISIEUX
(11)
Le postulat (fin) Lettres 46 à 80 (9 avril 1888 – 10 janvier 1889)
Sœur Agnès de Jésus (56,78)
Thérèse avait confié à sa sœur qu’elle était dans l’obscurité. Agnès a certainement mis un bémol à la notion de nuit qui, au Carmel, réfère explicitement au langage de la mystique. Qu’une si jeune postulante traduise son expérience en des termes qui naviguent entre la nuit des sens et la nuit de l’esprit, lui semble prématuré. Thérèse persiste et signe : «L’agneau se trompe en croyant que le jouet de Jésus n’est pas dans les ténèbres, il y est plongé. » Agnès ne récuse pas son témoignage. Elle discute sa formulation. Elle essaie de la déplacer et surtout de la ré-enchanter. Thérèse est dans l’obscurité et pourtant, de son propre aveu, elle n’a jamais autant aimé Jésus et discerne clairement une grande paix en elle. C’est pourquoi Agnès substitue à l’obscurité thérésienne l’expression plus nuancée et plus adaptée de ténèbres lumineuses. Thérèse convient de la justesse des mots à la condition de ne pas réduire le premier terme : « Peut-être, et l’agnelet en convient, ces ténèbres sont-elles lumineuses mais malgré tout ce sont des ténèbres. » Au cœur de ces ténèbres se niche un trésor, « une force et une paix très grande ». Un être est-il vraiment dans l’obscurité quand il « espère être comme Jésus veut» ? Tout dépend du point de vue de l’observateur. Thérèse est dans la lumière quand elle atteste la force, la paix et son désir de se conformer à la volonté de Jésus « voilà sa joie ». L’obscurité est épaisse quand elle constate qu’en dehors de Jésus « tout est triste ». En distinguant deux approches nous affaiblissons ses propos. Le discours rationnel manque la cible car il distingue pour mieux comprendre. Thérèse lui préfère le paradoxe qui unit les contraires : « Si vous saviez combien ma joie est grande de n’en avoir aucune pour faire plaisir à Jésus ! » La joie n’est pas un concept mais une réalité : « c’est de la joie raffinée. » Cette joie très particulière est étrangère à nos pauvres joies humaines. Thérèse perçoit une joie « nullement sentie ».
La peur de perdre Agnès encadre cette lettre. « L’agnelet (Thérèse) a bien peur que Jésus fasse pousser des ailes à l’agneau (Agnès). » Un agneau ailé c’est un agneau près à prendre son envol. « Cela sent la Patrie ! »
Thérèse avait déjà rêvé de la mort de sa sœur : « J’ai rêvé que l’agneau s’envolait bientôt dans sa patrie, mais j’espère qu’il restera encore un peu dans l’exil pour guider le pauvre agnelet. » (L.56). La pensée de la mort transfigurée est très présente : « Leur cœur (Agnès et Thérèse) qui n’est jamais rassasié sur la terre ira s’abreuver à la source même de l’amour, oh ! le doux festin. Quelle joie de voir Dieu ; d’être jugé par celui que nous aurons aimé par-dessus toutes choses. » Ce vif désir ne l’empêche pas de supplier « l’agneau de ne pas encore bondir vers le Ciel. » Ce n’est pas la mort d’Agnès que redoute Thérèse puisque mourir c’est « bondir vers le ciel ». Ce qui l’inquiète c’est que sa sœur la devance et la laisse orpheline. « Ne mourrez pas encore tout de suite, attendez que l’agnelet ait des ailes pour vous suivre. » (L.78)
A sœur Marthe de Jésus (80) Ce n’est pas une lettre mais la dédicace écrite au verso d’une image le jour de sa prise d’habit. Sœur Marthe est une postulante entrée au Carmel un peu après Thérèse. La prise d’habit est vécue comme des fiançailles. Il n’est pas rare qu’une religieuse se confie alors à la prière de ses proches. « Demandez à Jésus que je devienne une grande sainte… » Nous aurions dit « une sainte ». Thérèse désire être « une grande sainte ». Pour la première fois elle signe : « Sœur Thérèse de l’Enfant Jésus de la Sainte Face » +++++++++++
Nous avons parcouru très rapidement la période du postulat.
L’édition des Lettres distribue la Correspondance autour de sept périodes :
Le 30 septembre 1897 meurt Thérèse. La dernière lettre du recueil, qui en compte 266, est la dédicace d’une image adressée à l’abbé Bellière. Alors que la maladie a progressé et que la mort est annoncée, elle écrit : « Je ne puis craindre un Dieu qui s’est fait pour moi si petit… je l’aime !... car il n’est qu’amour et miséricorde ! »
Thierry Cazes
|
||||
© 2002 Diocèse catholique de Digne, Riez et Sisteron - Réalisation Sudway Internet